Tag Archives: wu-tang clan
Le rap et le cinéma, c’est une histoire qui dure. Depuis plus de trente ans, le second a infusé le premier par toutes les entrées créatives : la référence textuelle à un titre de film, à un personnage ou à une phrase particulière, le sample musical, l’extrait de dialogue, la répétition de scènes cultes, le visuel d’un clip… Rares aujourd’hui sont les albums à ne pas contenir au moins un échantillon de cinéma, peu importe sa forme. Et si ces références tiennent la plupart du temps du simple clin d’œil ou du bon mot (ou, parfois, du running gag), certains artistes ont pris le temps de décortiquer et de comprendre les œuvres qu’ils citent, d’en tirer la substantifique moelle pour soit les intégrer à leur univers, soit se fondre entièrement dans le leur. Généralement, cet exercice est réalisé à l’échelle d’un visuel qui annonce l’ambiance, d’un morceau thématique ou d’un clip plus chiadé que les autres. Mais il arrive que des albums entiers soient pensés et construits autour d’une référence cinématographique en particulier, travaillée pour donner au projet une certaine ambiance, une épaisseur visuelle, une autre dimension. Ce sont ces derniers que cet article, inscrit dans une série intitulée le contre-champ, va s’échiner à analyser. Après Liquid Swords et Shogun Assassin, plongée dans un autre grand classique du Wu-Tang Clan : Only Built 4 Cuban Linx…, premier solo de Raekwon largement influencé par le style John Woo et son magnum opus, le film culte The Killer.

LE FILM : THE KILLER (John Woo, Hong-Kong, 1989)
Lorsqu’il réalise The Killer en 1989, John Woo a déjà seize réalisations à son actif. Passé par la société de production Shaw Brothers puis par la Golden Harvest (la maison de Bruce Lee et de Jackie Chan, qui a importé aux États-Unis le cinéma hongkongais), il est rompu aux films d’action et d’arts martiaux. En 1983, il rejoint le réalisateur Tsui Hark chez Cinema City, qui lui permet de tourner son premier classique, Le Syndicat du crime. Avec cette histoire de frères ennemis, il donne naissance au sous-genre de l’heroic bloodshed, qui définit un film d’action à l’arme à feu, très violent et très stylisée, tournant autour des thèmes de la rédemption, de l’honneur et de la fraternité. Dans l’esprit occidental, si The Killer est donc le « premier », le film qui a révélé John Woo, il est en réalité une œuvre somme, celle où se rencontrent les grands thèmes d’un cinéaste fasciné par la violence visuelle du cinéma américain des années 70 et par la sobriété du polar à la française.
The Killer, c’est l’histoire de Ah Jong (interprété par Chow Yun-fat), un tueur à gage qui opère pour les Triades de Hong-Kong. Lors de la fusillade qui suit l’exécution d’un contrat, il blesse une chanteuse de nightclub, Jennie, rendue aveugle par un flash de bouche. Épris de sa victime collatérale, Ah Jong décide d’accepter un dernier job pour lui payer l’opération qui lui fera retrouver la vue, tout en étant traqué à la fois par l’inspecteur Li et ses commanditaires qui se retournent contre lui. Si pléthore de références viennent nourrir le film (la violence graphique de Scorsese, Leone et Peckinpah, l’esthétisation et certains motifs de Michael Mann dans Le Solitaire ou Le sixième sens) le pitch évoque surtout une matrice principale, à savoir Le Samouraï de Melville, sommet du polar français froid et épuré. Comme Jef Costello interprété par Alain Delon, Ah Jong (qui en version française est renommé… Jeff Chow), est un assassin solitaire, félin, élégant, quasi-mutique. Ils sont tous deux traqués, à la fois par leurs pairs et par les autorités. Leurs âmes tourmentées se ressourcent dans le calme (une église pour Ah Jong, son appartement pour Jef Costello). Ils cherchent la rédemption en sauvant une jeune femme (une chanteuse pour Ah Jong, une pianiste Jef Costello) rencontrée lors de l’exécution d’un contrat. Enfin, tous deux connaitront inévitablement une fin violente au bout de la route qu’ils se sont tracée à coup de flingues. Fort heureusement, ces nombreux emprunts et inspirations de John Woo ne prennent jamais le pas sur ce qui fait le sel de son cinéma : sa forme outrancière et son fond profondément chevaleresque.
The Killer, comme les autres grands films de John Woo, raconte avant tout une histoire de fraternité – au sens propre ou figuré de camaraderie virile. La relation entre le tueur et le policier, entre Chow Yun-fat et Danny Lee (qui joue l’inspecteur Li), est pétrie de respect et de considération. Loin des figures unilatérales de Jef Costello ou de Frank (Le Solitaire), dont les relations avec les autorités sont purement conflictuelles, Ah Jong devient pour son poursuivant un objet d’admiration. Li est fasciné par la noblesse de ses actions (en plus de vouloir rendre la vue à Jennie, lors de sa deuxième mission, Ah Jong se met en danger pour sauver une petite fille pendant une fusillade) qui entre en contradiction avec son métier d’assassin. Cette admiration lui sera rendue, et Ah Jong finira par voir en Li un véritable ami, un allié précieux qui pourra l’aider à échapper aux Triades et à pouvoir, enfin, se ranger.
Ces thèmes très orthodoxes, le respect, le code de l’honneur, le devoir, constituent le cœur du cinéma de John Woo. Mais ils n’auraient pas le même impact s’ils n’entraient pas en opposition avec une forme aussi démesurée. Mille fois copiée jusqu’à la parodie (y compris par John Woo lui-même dans certains de ses films américains), la mise en scène débridée de ses heroic bloodshed reste un modèle indépassé du genre. Gunfights orgiaques, chorégraphies délirantes, effets pyrotechniques à foison : jamais de tels accès de violence n’avaient été filmés avec autant de lyrisme et de poésie. La grâce des mouvements de caméra, l’irréalisme des cascades, la sécheresse des coupes, tout concourt à faire des fusillades de vrais ballets macabres. De ce point de vue, The Killer est un film en état de grâce constant, dont le rythme ultra-nerveux des scènes d’action ressort d’autant plus qu’il est tempéré par la quiétude des moments plus intimes, entre Ah Jong et Jennie ou Ah Jong et Li. C’est principalement cette dynamique qui inspirera nombre de cinéastes – Tarantino, Besson, Rodriguez, parmi d’autres. Mais au moment de produire le Only Built 4 Cuban Linx… de Raekwon, c’est autre chose que RZA, tête pensante du Wu-Tang Clan, a à l’esprit.

L’ALBUM : ONLY BUILT 4 CUBAN LINX… (Raekwon ft. Ghost Face Killer, 1995)
Après Method Man et Ol’ Dirty Bastard, Raekwon est le troisième membre du Wu-Tang a sortir, le 1er août 1995, son album solo produit par RZA. Alors que Tical et Return to the 36th Chamber : The Dirty Version, malgré des identités bien marquées, prolongent d’une certaine manière le son martial et dépouillé d’Enter the Wu-Tang (36 Chambers), Only Built 4 Cuban Linx… s’engage dans une autre direction. Plus cinématographique, plus narratif, plus dense, il relaie le kung-fu au second plan pour mettre en scène des histoires violentes de gangsters, de trafics de drogue, d’amitiés et de trahisons. Si l’influence du séminal Live and Let Die de Kool G Rap – qui n’a pas son pareil pour raconter des affaires de bandits – est bel et bien présente, OB4CL demeure un album pionnier du mafioso-rap. Juste après lui Jay-Z, AZ ou encore Nas s’inventeront eux-aussi des personnages et raconteront des histoires sordides de crime organisé, de contrats honorés entre deux flûtes de champagne et un trajet en limousine.
Sur OB4CL, les rappeurs présents ont tous de nouveaux alias : Raekwon est Lou Diamond, Ghostface Killah est Tony Starks, Inspektah Deck est Rollie Fingers, Masta Killah et GZA sont Noodle et Maximilian (un clin d’œil aux gangsters joués par Robert de Niro et James Wood dans Il était une fois en Amérique) … Même Nas, qui pourtant ne sortira It Was Written que l’année suivante, est déjà crédité en tant que Nas Escobar. Une manière d’ajouter à la texture cinématographique du disque, mais aussi un renvoi direct à The Killer dans lequel les deux protagonistes se surnomment Butthead et Numbnuts (Mickey Mouse et Dumbo en VF). Cette dualité entre Ah Jong et l’inspecteur Li, forcés de s’allier pour survivre, va servir de modèle à celle qui existe entre Raekwon et Ghostface Killah. Crédité en tant que featuring sur l’album, présent sur quatorze pistes, GKF est l’autre prodige de OB4CL, et la relation entre les deux MC’s constitue l’un des centres névralgiques du disque.
RZA a souvent raconté qu’il a souhaité mettre en avant deux rivaux, originaires de deux quartiers de New York – Stapleton pour GFK, Park Hill pour Raekwon – et qui avant l’aventure Wu ne se connaissaient qu’à travers lui. L’alchimie fonctionne à plein pot. C’est une harmonie magnétique sur « Criminology », une manière de se tirer vers le haut sur « Rainy Dayz », des réminiscences partagées sur « Can It Be All So Simple (Remix) ». Raekwon est la star, Ghostface le partner in crime idéal, et le duo renvoie la même énergie que celui du film : au-delà de leurs origines dissonantes, un amour fraternel, un profond respect empreint d’admiration et un but commun vient les réunir.
À l’origine de cette collaboration entre les deux artistes, RZA va prolonger la parallèle avec le film de John Woo et en infuser l’architecture de l’album. Comme il le fera avec Liquid Swords et Shogun Assassin, il choisit d’introduire OB4CL avec la musique qui introduit The Killer. Le vibraphone du thème principal, composé par Lowell Lo, distille immédiatement une atmosphère envoûtante, à la fois angoissante, onirique et mélancolique. Il reviendra plusieurs fois, comme une ritournelle, pour appuyer les récits criminels et introspectifs des interprètes. Tout comme Ah Jong, Lou Diamond arrive au bout de sa vie de bandit. Il compte se ranger, non sans réussir un dernier coup juteux avant de partir, et devra compter sur le soutien de son rival et acolyte pour y parvenir.
Sur « Striving for Perfection », Raekwon et Ghostface discutent de ce plan de sortie avec l’énergie du désespoir : « Yeah, word up, I’m tired of doing this shit ». Cette manière peu conventionnelle de se présenter installe une ambiance résolument sombre et sinistre, à l’image de l’église vide dans laquelle débute le film. En reprenant ces différents motifs, RZA va tisser une toile de fond passionnante, qui aura – chose assez peu commune pour être signalée – l’aval de John Woo lui-même. Ainsi raconte-t-il à XXL : « Mostly everything [of the spoken interludes] is from The Killer on that album, that or personal talking. I met John Woo that same year. He sent me a letter. He’s honored that we did it. I felt confident we could settle anything that came up. You can usually settle that shit. It’s part of the budget, man. But John Woo didn’t want nothing, never no money for that. We actually became friends, he took me and Ghost to lunch and dinner many times. He gave me a lot of mentoring in film1 ».

LES SAMPLES « We’re not supposed to trust anyone in our profession anyway »
The Killer est samplé à quatre reprises dans OB4CL. Cela peut paraître peu sur un album de dix-huit titres, mais le séquençage de RZA est suffisamment bien pensé pour rendre l’impression que le film y est omniprésent. Sur le thème principal de Lowell Lo, « Striving for Perfection » met en place des enjeux clairs dès le départ. Raekwon et Ghostface Killah y sont présentés comme deux bandits au bout du rouleau. Le projet : faire un dernier coup, un gros, pour sortir de New York, emmener sa famille loin d’ici et un jour pouvoir faire sauter ses petits-enfants sur ses genoux. Pendant cet échange de près de deux minutes, le thème principal de The Killer instaure, avec son vibraphone entêtant, une ambiance funèbre et anxiogène, mais aussi très aérienne, à la limite de l’imaginaire. C’est cette tonalité double, entre les baskets collées au bitume de la grosse pomme et les rêves de grandeurs, qui rend compte de l’état d’esprit de Lou Diamond et Tony Starks. Si le parallèle avec Ah Jong et ses velléités de retraite est évident, cet état d’esprit est aussi celui de Raekwon et de Ghostface : à ce moment de leur carrière, leur musique doit marcher coûte que coûte s’ils ne veulent pas rester des dealers de shit toute leur vie.
Ces multiples niveaux de lecture – réaliste, cinématographique, romanesque – se recoupent à d’autres moments du disque. Dans « Rainy Dayz », la chanteuse Blue Raspberry joue le rôle d’une femme de gangster, amoureuse et prisonnière d’un homme qu’elle reconnait de moins en moins, rongé par le grand banditisme et ses dangers. Sur un beat strident et atmosphérique de RZA, entrecoupé d’éclats de tonnerre et hanté par la pluie qui tombe à verse, Rae et Ghost narrent la décadence de la vie de rue tandis que le refrain met en évidence ses plus grands dommages collatéraux. Un échange extrait de The Killer rend explicite le parallèle avec Jenny, la chanteuse qui subit les affres du métier d’Ah Jong : « You sang beautifully just now / I sing for him and he isn’t here2 ». Comme elle, Blue Raspberry chante à perte l’absence d’un homme qui peu à peu devient fou, trop occuper à faire des affaires, à chercher sa voie hors de la criminalité tout en s’y enfonçant davantage un peu plus chaque jour. Là encore, c’est une situation qui résonne dans la vie des artistes, comme RZA l’explique, à XXL toujours : « This was too emotional and too real for me, too close to my personal situation. This was the life we was living, just talking and rapping and hoping. Record royalties take too long to come. We had a platinum album, but we waiting on the check to come fast, like babies wanting they food3».
Mais comme dit précédemment, le point névralgique d’OB4CL n’est pas tant le gangstérisme que l’amour qui unit les membres d’une grande famille. Un amour viril et fraternel digne du Parrain, dont la fragilité est à la hauteur de la force. Dans un milieu où les enjeux sont si élevés, les valeurs familiales ne tiennent pas toujours la dragée haute aux ambitions et les trahisons sont légion. À ce titre, la relation entre Raekwon et Ghostface apparait tout au long du disque comme une force pure et impérissable, pétrie de respect et d’admiration. Là, il faut s’attarder sur l’introduction d’« Incarcerated Scarfaces », l’un des rares solos de Raekwon, dédié aux proches et aux moins proches incarcérés. Un long monologue de l’inspecteur Li, en train de dresser un profil passionné de Ah Jong, fait démarrer le morceau : « He looks determined without being ruthless. Something heroic in his manners. There’s a courage about him, doesn’t look like a killer. Comes across so calm. Acts like he has a dream. Full of passion4 ». L’utilisation du singulier et du terme “killer” n’interdit pas de penser qu’il s’agit là d’un hommage direct de Raekwon à son acolyte Ghostface Killah.
Raekwon n’a d’ailleurs jamais caché l’amour véritable qu’il lui porte : « That’s my heart right there. We think so much alike. Like I’ll say something and he’ll be like, « Yo, I was just getting’ ready to say that, son5»», disait-il à Ego Trip, en 1995, au sujet de leur relation. Dans The Killer, l’inspecteur Li ne trahit jamais son amitié naissante avec Ah Jong. La tension qui monte avant leur face à face est en partie désamorcée par une scène au ton résolument humoristique, et très vite, leurs échanges ressemblent à ceux de deux vieux amis. Le doute sera plutôt instauré par l’homme qui fait parvenir à Ah Jong les contrats des Triades. Ainsi juste avant que « Incarcerated Scarfaces » ne débute, un second extrait est samplé à la suite du premier, sans coupure apparente alors qu’il s’agit dans le film de deux scènes différentes : « You don’t trust me huh ? / Well you know why / I do, we’re not supposed to trust anyone in our profession anyway6». Ce dialogue entre Ah Jong et son entremetteur s’impose comme une manière de rappeler que sur OB4CL, Rae et Ghostface sont aussi deux professionnels au travail dans un milieu où la méfiance reste de mise.
Le lien fraternel, quasi-romantique qui unit les deux protagonistes de l’album est donc, comme dans le film, immédiatement palpable et au-delà de toute suspicion. Mieux, il finira par s’étendre à l’ensemble de la Wu-family. « Wu-Gambinos » (en référence à l’une des cinq familles mafieuses de New York), posse cut énervé et point culminant du disque où chaque invité endosse son alias le temps d’un couplet dévastateur, est là pour rappeler que le Wu-Tang réussira ensemble ou ne réussira pas. L’introduction de cette seizième piste, qui contient le dernier sample de The Killer, vient faire écho aux tout premiers mots du disque : « And in our line of work, we need all the help we can get. Tony Wing’s the name. He works for a drug ring in Central America / Who wants to kill him ? / No information. Say yes or no / One-point-five million / All right, you’ll get what you want. Money is no object. They’re all clean. No serial numbers. Untraceable. And they’re explosive-heads bullets, your favorite / I felt like someone walk over my grave / You want to change your mind ?7 ».
Lorsque Rae et Ghost discutaient leur plan de sortie sur la musique envoûtante de Lowell Lo dans « Striving for Perfection », ils évoquaient l’idée d’un dernier coup qui rapporterait gros. Juste avant un final en apothéose (le diptyque céleste « Heaven & Hell » et « North Star (Jewels) », qui n’est pas sans évoquer les envols de colombes chers à John Woo), « Wu-Gambinos » est la concrétisation de cet ultime contrat. Un banger sauvage dont le beat sec et percutant, et les couplets surexcités de ses cinq interprètes armés jusqu’aux dents (« It’s the two holster, six-shots smoker », « Double-breasted, bulletproof vested, well protected »), n’est pas sans rappeler le gunfight apocalyptique qui clôt The Killer (« And watch your ass get thrown to a sea of fire and brimestone »). Cette image volcanique du feu et de la pierre n’est pas fortuite, tant c’est une fusion à plusieurs niveaux qui s’opère dans Only Built 4 Cuban Linx… Celle de Raekwon avec Ghostface Killah. Celle de RZA avec ses paroliers. Celle des paroliers avec leurs personnages fictifs. Et celle, bien sûr, d’un long-métrage et d’un long-playing. RZA l’avait sans doute compris avant les autres, lui qui signe dans le livret de l’album : « Special thanks to John Wu ».
1 « Pratiquement tous les interludes parlés viennent de The Killer sur cet album, ça ou des conversations personnelles. J’ai rencontré John Woo la même année. Il m’a envoyé une lettre. Il est honoré qu’on l’ait fait. J’étais certain qu’on pourrait régler tous les problèmes qui se poseraient. On peut, la plupart du temps. Ça fait partie du budget, mec. Mais John Woo ne voulait rien en échange, pas d’argent. Nous sommes même devenus amis, il nous a emmené, Ghost et moi, déjeuner et dîner de nombreuses fois. Il m’a donné beaucoup de mentorat dans le cinéma. »
2 « Vous venez de chanter merveilleusement / Je chante pour lui et il n’est pas là ».
3 « C’était trop émotionnel et trop réel pour moi, trop proche de ma situation personnelle. C’était la vie qu’on vivait, on parlait, on rappait et on espérait. Les royalties des disques mettent trop de temps à arriver. On avait un disque de platine, mais on attendait que le chèque arrive vite, comme des bébés qui réclament leur nourriture »
4 « Il a l’air déterminé sans être impitoyable. Quelque chose d’héroïque dans ses manières. Il y a du courage en lui, il n’a pas l’air d’un tueur. Il est si calme. Il agit comme s’il avait un rêve. Plein de passion »
5 « C’est mon cœur, juste là. On pense tellement pareil. Je dis quelque chose et il me dit : « Yo, je m’apprêtais à dire ça, fils » »
6 « Tu ne me fais pas confiance, hein ? / Tu sais pourquoi… / Je sais oui, on n’est pas censé faire confiance à qui que ce soit dans notre profession de toute façon…
7 « Et dans notre métier, on a besoin de toute l’aide possible. Son nom est Tony Wing. Il travaille pour un réseau de drogue en Amérique Centrale / Qui veut le tuer ? / Pas d’information. Dis oui ou non / Un million cinq cent mille / D’accord, tu auras ce que tu veux. L’argent n’est pas un problème. Ils sont tous clean. Pas de numéros de série. Intraçables. Et ce sont des balles à tête explosive, tes préférées / J’en ai des frissons / Tu veux changer d’avis ? »
Le rap et le cinéma, c’est une histoire qui dure. Depuis plus de trente ans, le second a infusé le premier par toutes les entrées créatives : la référence textuelle à un titre de film, à un personnage ou à une phrase particulière, le sample musical, l’extrait de dialogue, la répétition de scènes cultes, le visuel d’un clip… Rares aujourd’hui sont les albums à ne pas contenir au moins un échantillon de cinéma, peu importe sa forme. Et si ces références tiennent la plupart du temps du simple clin d’œil ou du bon mot (ou, parfois, du running gag), certains artistes ont pris le temps de décortiquer et de comprendre les œuvres qu’ils citent, d’en tirer la substantifique moelle pour soit les intégrer à leur univers, soit se fondre entièrement dans le leur. Généralement, cet exercice est réalisé à l’échelle d’un visuel qui annonce l’ambiance, d’un morceau thématique ou d’un clip plus chiadé que les autres. Mais il arrive que des albums entiers soient pensés et construits autour d’une référence cinématographique en particulier, travaillée pour donner au projet une certaine ambiance, une épaisseur visuelle, une autre dimension. Ce sont ces derniers que cet article, inscrit dans une série intitulée le contre-champ, va s’échiner à analyser. Cas d’école pour ce premier volet, avec l’album Liquid Swords de GZA et le film Shogun Assassin de Robert Houston.

Le film : Shogun Assassin (Robert Houston, USA-Japon, 1980)
Au départ il y a Lone Wolf and Cub, un manga écrit par Kazuo Koike et dessiné par Goseki Kojima, publié en 28 volumes entre septembre 1970 et avril 1976. Ce seinen raconte l’histoire d’un samouraï qui, trahi par le clan Yagyū qui convoite son poste privilégié de bourreau du Shogun (un terme signifiant « général » et désignant le plus souvent le dirigeant du Japon), est contraint de s’enfuir avec son fils de trois ans et d’engager une vengeance sanglante. Prisé pour sa violence graphique, sa narration enlevée et sa peinture âpre sans concession de l’ère Edo, le succès est retentissant et conduit rapidement à la mise en chantier d’une adaptation cinématographique. En 1972, Baby Cart : Le Sabre de la vengeance sort sur les écrans. Dirigé par Kenji Misumi (déjà connu pour avoir livré quelques-uns des meilleurs films de la saga Zatoichi, autre série B culte de samouraïs), ce premier volet impressionne par sa mise en scène expérimentale, entre le baroque des planches de manga et le classicisme des films de sabre de Kurosawa. Avec ses couleurs vibrantes, son montage hypnotique et ses plans pittoresques (une décapitation sauvage sur fond de soleil couchant, notamment, reste en mémoire), le film est un véritable enchantement macabre. Toujours en 1972, Kenji Misumi pousse le curseur encore plus loin dans Baby Cart : L’Enfant massacre qui multiplie les morts loufoques et les plans gores à base de geysers de sang, d’amputations et autres visages découpés dans la largeur. Au total, il réalisera quatre des six longs-métrages adaptés du manga Lone Wolf and Cub. La saga, que vient clôturer en 1974 le délirant Baby Cart : Le Paradis blanc de l’enfer et son body count à 3 chiffres, se révélera particulièrement influente jusqu’à l’international.
Évidemment, qui dit succès à l’étranger dit adaptation pour le marché américain, et les films de samouraïs ne dérogent pas à la règle. Ainsi Shogun Assassin voit le jour en 1980. Produit par David Weisman, distribué par Roger Corman (une légende de la série B qui a mis le pied à l’étrier de la quasi-totalité des actrices, acteurs et réalisateurs les plus influent.e.s du nouvel Hollywood) et réalisé par Robert Houston, Shogun Assassin est un remontage des deux premiers opus de Kenji Misumi, affublé d’un doublage anglais et d’une nouvelle bande originale. On y retrouve donc Ogami Itto, son landau de bois et son fils de trois ans, Daigorō, forcés de s’engager sur le chemin de la vengeance (« the Demon Way in Hell » tel qu’il est appelé dans le film) après la trahison du clan Yagyū et le meurtre de leur femme et mère. Le premier volet, dont seulement douze minutes sont réutilisées, sert de pitch tandis que le second volet constitue la structure principale de ce montage américain. Plus encore que dans la version japonaise, la construction du film rappelle que l’histoire est prétexte à un enchainement de scènes d’actions toutes plus violentes les unes que les autres. À la manière d’un jeu vidéo, des opposants de plus en plus forts défilent sur les routes empruntées par Itto et se font charcuter jusqu’à l’apparition du boss de fin, les Masters of Death, synonyme de combat épique.
Bien sûr, pour qui a vu la saga japonaise originale, Shogun Assassin tient plus de la curiosité qu’autre chose. Le doublage anglais est aussi soigné que kitsch, la narration resserrée ne sert pas l’intrigue et les considérations introspectives du personnage d’Itto, en pleine lutte intérieure avec les codes du Bushido, sont largement éludées. Le film est néanmoins d’une efficacité à toute épreuve et traite le matériau de base avec respect, n’hésitant pas à conserver les innovations formelles de Misumi au niveau de l’image, du son et du montage. En cela il constitue pour le public occidental une excellente porte d’entrée dans le genre série B de samouraï. Et surtout, difficile de nier son influence sur le cinéma de genre et la culture populaire – dont la saga s’est elle-même largement nourrie par ailleurs, empruntant régulièrement aux westerns de Leone ou aux films de la Shaw Brothers. Ainsi John Carpenter fera un clin d’œil aux trois Masters of Death dans Les aventures de Jack Burton dans les griffes du Mandarin. Quentin Tarantino reprendra de nombreux motifs du film dans Kill Bill (le sang projeté de la lame de l’épée sur le sol, le poing qui vient cogner le manche du sabre, les amputations et autres geysers de sang…), allant jusqu’à le faire visionner à ses personnages. Enfin, Shogun Assassin sera donc l’épine dorsale de Liquid Swords, le chef-d’œuvre de GZA.
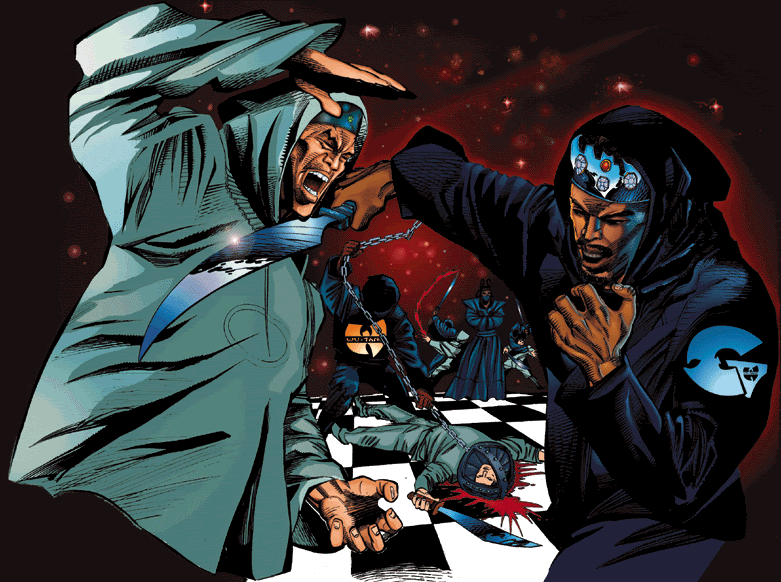
L’album : Liquid Swords (The Genius/GZA, 1995)
Produit d’une main de maitre par RZA, le grand manitou du Wu-Tang Clan (qui, surprise, réalisera plus tard la bande originale de Kill Bill), Liquid Swords est le second album de GZA sorti le 7 novembre 1995. Parmi les grands classiques parus dans la foulée du séminal Enter the Wu-Tang (36 Chambers), Liquid Swords est sans doute le disque le plus fondamentalement Wu. C’est à dire celui qui s’ancre le plus dans la tradition du groupe : arts martiaux, mysticisme, références cinématographiques, violence graphique, jeu d’échecs et commentaire social. Tical est l’album d’un fumeur invétéré ; OB4CL est l’album d’un parrain de la drogue, Ironman est l’album d’un soul crooner et Return to the 36 Chambers, malgré son titre, est l’album d’une rockstar. Liquid Swords, lui, est bien l’album d’un samouraï avec ses combats sanglants, ses auto-réflexions philosophiques et son regard acéré sur le monde environnant régi par une lutte des classes sans merci. Ces caractéristiques, qui sont aussi celles de beaucoup des grands films de sabre des années 60 et 70 (voir Sanjuro, Les Trois Samouraïs hors-la-loi ou encore les films de la saga Zatoichi), se retrouvent en filigrane tout au long des morceaux. « Duel of the Iron Mic », « Cold World », « Swordsman », « Living in the World Today », « Investigative Reports » : les titres parlent d’eux-mêmes, et pourraient tout à fait servir à nommer les chapitres des films de la saga Lone Wolf and Cub.
Il est difficile d’imaginer à quoi aurait ressemblé Liquid Swords sans Shogun Assassin. La production soul, noircie à la suie par RZA et l’écriture à la fois imagée, abyssale et brillamment interprétée de GZA suffiraient sans doute à assurer son statut de chef-d’œuvre. Mais le film de Robert Houston, omniprésent, l’emmène dans une autre dimension. C’est RZA qui eut l’idée, à la fin de l’enregistrement, d’utiliser Shogun Assassin comme une colonne vertébrale qui viendrait soutenir sa partition. Agissant comme un fil d’ariane dont on suit les saillies sinueuses de piste en piste, il confère à l’album une ambiance délétère unique en son genre. Choix intéressant, RZA ouvre le disque comme s’ouvre le film, traduisant une véritable ambition narrative qui participera largement à rendre les deux œuvres indissociables (et effectivement, il n’est pas aisé aujourd’hui de regarder Shogun Assassin sans penser à Liquid Swords, et vice-versa). Les différents extraits de dialogue qui suivront l’introduction, insérés de façon quasi-chronologique, vont dans ce sens et installent comme une intrigue parallèle : c’est bien l’impression d’écouter un conte étrange, cruel et sanglant, qui ressort de Liquid Swords.

Les samples « He cut off the heads of a hundred and thirty-one lords »
« When I was little, my father was famous. He was the greatest samurai in the Empire, and he was the Shogun’s decapitator…1 ». Une minute et vingt secondes. C’est une éternité, et le temps que dure l’introduction de Liquid Swords. Accompagnés de l’angoissant thème de W. Michael Lewis et Mark Lewis, « Legend of Lone Wolf », les mots de Daigorō, prononcés lentement – presque chuchotés – font tomber une chape de fumée épaisse et noire sur le premier morceau éponyme de l’album. Le ton est donné pour les douze titres à suivre, et les premières lignes parallèles se tracent entre le rappeur GZA et le samouraï Itto. Comme le personnage joué par Tomisaburō Wakayama, père et meurtrier sanguinaire trompé par ses pairs véreux, The Genius est à la fois un assassin sans pitié de wack MCs et un éveilleur de consciences (« I be the body dropper, the heartbeat stopper / Child educator plus head amputator »). Le parallèle est scellé par un nouvel extrait qui introduit le seconde piste, « Duel of the Iron Mic » : « Oh mad one, we see your trap. You can never escape your fate. Submit with honor to a duel with my son2 ». Comme Itto, GZA s’est engagé sur une voie tortueuse dont il ne peut s’écarter, mais qu’il compte parcourir avec panache.
Cette voie tortueuse, c’est une vie dure qui prend ses racines dans les ghettos des États-Unis, avec leurs trafics de drogue, leurs guerres des gangs et leurs morts violentes. Car si Liquid Swords baigne effectivement dans l’ambiance féroce et belliqueuse du japon militaire féodal de l’ère Edo, ce n’est que pour mieux retranscrire la réalité contemporaine des tours de Brooklyn telle qu’elle est décrite dans les lyrics de GZA. « Cold World » et son story-telling construit comme une spirale infernale de violence, est par exemple introduit par un autre sample de Shogun Assassin, cette fois-ci moins guerrier que philosophique : « I had a bad dream / Don’t be afraid, bad dreams are only dreams / What a time you chose to be born in3 ». Cette brusque incursion du réel, opérée par la voie cinématographique, tend à valider l’hypothèse d’une comparaison filée entre deux mondes qui se confondent par leur fureur et leur animosité, malgré les siècles et les kilomètres qui les séparent. Mais c’est encore l’extrait introduisant « 4th Chamber » (et sans doute le plus beau passage du film) qui demeure l’illustration la plus symbolique de ce parallèle. Un sabre dans la main gauche et un ballon dans la main droite, Itto demande à son jeune fils de choisir entre la vie à ses côtés (le sabre, symbole de la vengeance à mener) ou la mort aux côtés de sa mère (le ballon, symbole du jeu et donc de mort par le refus de la violence). « Choose the sword, and you will join me. Choose the ball, and you will join your mother in death. You don’t undertstand my words, but you must choose. So… Come boy. Choose life or death4 ». La scène est terrible, et l’écho qu’elle renvoi dans l’album l’est encore plus. Le choix du petit Daigorō – la vie par le sabre – est celui de toute une jeunesse désœuvrée, contrainte de mener une existence violente si elle veut pouvoir, in fine, simplement exister.
Avec son ambiance martiale, ses samples de baston à la pelle et l’émulation constante entre ses neuf membres, Enter the Wu-Tang (36 Chambers) tenait de la pure démonstration technique. Liquid Swords, tout inscrit dans cette veine orientale et guerrière, relève davantage d’une atmosphère ouatée et son approche est plus philosophique que militaire. En choisissant de structurer son album autour un chanbara (film de sabre) japonais plutôt que de réutiliser des films de kung-fu hongkongais (deux seulement sont brièvement cités : Dragon on Fire sur « Duel of the Iron Mic » et Shaolin vs Lama sur « Shadowboxin’ »), RZA modifie subtilement la portée du son Wu. Plus brutal, plus compact mais moins dans l’esbroufe. C’est autant une manière de coller aux écrits denses et référencés de GZA que de rendre justice à son style tranchant et définitif. « Most of our influence came from kung-fu movies. Sometimes there’s a lot of swinging, a lot of blocking. But in Japanese samurai movies, it’s one stroke kills. Bing, stroke ! Bing, stroke ! When it came time to incorporate a film into the Wu-Tang world, I chose this film to represent the GZA. His lyrics are straight to the point5 » raconte-t-il dans une interview pour Vanity Fair. Le dernier sample de Shogun Assassin, qui ferme « I Gotcha Back » peut ainsi être vu comme un hommage aux textes et au flow de GZA. « Your technique… is… magnificent. When cut across the neck, a sound like wailing winter wind is heard, they say. I’d always hoped to cut someone like that someday, to hear that sound… But to have it happen to my own neck is… ridiculous6 ». Cette mise aux nues de l’efficience pure est effectivement l’apanage des films de samouraï, dans lesquels les combats sont autrement plus expéditifs que les interminables duels des films de kung-fu. Un exemple séminal serait le duel final du Sanjuro de Kurosawa, attendu durant tout le film et pourtant expédié en un seul mouvement parfait, exquis de force et de dextérité. À la fin du film le personnage joué par Toshiro Mifune, dégouté de toutes les tueries auxquelles il a pris part, tient ces mots emprunts de bonté : « La meilleure épée doit rester dans son fourreau ». Il n’a, bien sûr, pas écouté Liquid Swords.
1 « Quand j’étais petit, mon père était célèbre. C’était le plus grand samouraï de l’Empire. Et c’était le bourreau du Shogun… »
2 « Oh fou, nous voyons ton piège. Tu ne pourras pas échapper à ton destin. Soumets-toi avec honneur à un duel avec mon fils »
3 « J’ai fait un mauvais rêve / N’aie pas peur, les mauvais rêves ne sont que des rêves / Quelle époque tu as choisi pour naître »
4 « Choisis l’épée, et tu me rejoindras. Choisis la balle, et tu rejoindras ta mère dans la mort. Tu ne comprends pas mes mots, mais tu dois choisir. Alors… Viens mon garçon. Choisis la vie ou la mort »
5 « L’essentiel de notre influence est venu des films de kung-fu. Parfois il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de blocages. Mais dans les films de samouraïs japonais, un coup suffit pour tuer. Bam, un coup ! Bam, un coup ! Quand il a fallu intégrer un film dans l’univers du Wu-Tang, j’ai choisi ce film pour représenter GZA. Ses textes vont droit au but »
6 « Ta technique… est… magnifique. Quand on te coupe en travers du cou, on entend un bruit comme celui du vent d’hiver qui gémit, qu’ils disent. J’ai toujours espéré arriver à couper quelqu’un comme ça un jour, pour entendre ce bruit… Mais que ça arrive à mon propre cou c’est… ridicule »
« I am the one and only Method Man, the master of the plan. »
Quand débute en 1993 l’épopée Shaolin et que le clan Wu–Tang débarque tout droit de la 36ème chambre, ses membres sont au nombre de neuf. De ce formidable essaim, une figure se démarque. Non pas qu’elle soit la seule car toutes, au détour d’une rime, d’un couplet ou d’un refrain passés à la postérité, auront déjà l’occasion de s’affirmer en tant qu’entité à part entière. Mais sur l’échiquier du Wu que déploie le roi RZA, Method Man est le seul fou à se voir offrir de poser sur un morceau avec son propre nom affiché sur l’étendard. Pièce de choix parmi les douze grands moments qui composent Enter the Wu, « Method Man » est autant un hymne à la débauche enfumée qu’une déclaration de guerre. Et le premier mouvement tactique de Prince Rakeem dans son plan de conquête du monde.
Le deuxième s’amorce dès l’année suivante. Poursuite logique des évènements, Method Man est le premier membre du groupe à sortir son album. En bonne tête pensante, RZA s’est alors débrouillé pour obtenir de Loud/RCA Records – label du groupe à l’époque – la possibilité de sortir chaque projet solo à venir librement chez d’autres maisons de disques, et garder la mainmise sur chacun d’eux. C’est ainsi que Tical, entièrement produit par RZA et paru chez Def Jam, ouvre en novembre 1994 la marche d’une première série de solos que fermera Ghostface avec la sortie d’Ironman en 1996.
Dans ce premier trauma post-36e chambre, il ne sera jamais question de dévier du chemin déjà tracé, mais plutôt de s’y enfoncer encapuché jusqu’aux yeux, les godasses pleines de boue sous la pleine lune et une pluie battante. Dans la crasse ambiante, les tâches de propre sont difficilement décelables. C’est à peine si l’on distinguera le sincère hommage à la gente féminine qu’est « All I Need » ou le chant entrainant de Blue Raspberry sur le tubesque « Release Yo’ Delf », seuls éléments qui tranchent avec la rudesse globale et la tradition killa bees dans laquelle s’inscrit Tical. Car si les préoccupations de Method Man – en premier plan la fumette et dérouiller du MC – sont omniprésentes, si sa voix rauque et son charisme éclaboussent l’album, l’univers du Wu-Tang y est aussi largement approfondi. Références multiples au premier opus du groupe, extraits cinématographiques kung-fuesques à foison et invités de marque se croisent pour frapper Tical du sceau de la chauve-souris. Exemple parfait avec « Meth vs Chef », sur lequel Raekwon vient donner la réplique à Johnny Blaze pour une joute verbale en forme de match de boxe particulièrement jouissive.
D’egotrips parfumés aux vapeurs d’herbes en chroniques urbaines d’un quotidien violent au pied des projects de Staten Island, les sommets s’enchainent sans possibilité de respirer autre chose qu’un air à la couleur verdâtre, pollué par toutes sortes de substances toxiques naturelles et industrielles. À tel point que la démence pointera à plusieurs reprises le bout de son nez, notamment le temps du supra-classique « Bring the Pain » et de son refrain imparable, d’un « Sub Crazy » aveuglément brutal ou du terrifiant « Mr. Sandman ». Posse-cut dans le pur style de l’école Wu-Tang, c’est un autre des points culminants de l’album, qui évoque volontiers une ruche d’abeilles tueuses malencontreusement bousculée d’où sortent, entre autres affiliés au clan, un Inspectah Deck à la verve affolante et un RZA littéralement possédé. Dans ces moments hallucinés, Tical fait immanquablement penser à Candyman, film horrifique paru en 1992, dont on est alors en droit de se demander s’il n’a pas eu une influence directe. Le métrage, qui en appelle aux légendes urbaines des ghettos et baigne dans un climat glauque proprement irréel, met en scène un boogeyman mystique des cités, armé d’un crochet de boucher et dont le corps est (dé)composé…d’abeilles !
« Dès le titre éponyme au beat ronflant et aux nappes stridentes, RZA plonge l’album dans une noirceur qui ne le quittera jamais. »
On disait le Rzarector possédé lors de son couplet sur « Mr. Sandman », il l’était tout autant au moment de produire l’intégralité de la mixture sonore de Tical. Dès le titre éponyme au beat ronflant et aux nappes stridentes sorties tout droit des enfers, il plonge l’album dans une noirceur qui ne le quittera jamais. Méconnaissables, les samples soul dont il est tant friand sont transformés en autant de ballades funèbres et brumeuses. Parfois terriblement oppressantes (« What the Blood Clot »), parfois empruntes d’un surréalisme éthéré (« Stimulation »), les ambiances s’entremêlent pour donner naissance à une atmosphère délétère unique, parsemée de cris d’outre-tombe et d’inspirations de fumées illicites, à pleins poumons forcément. Depuis l’inquiétante composition de « Bring the Pain » jusqu’au déchainement martial de « P.L.O. Style » en passant par le son crade et distordu de « Sub Crazy », RZA livre sans doute là l’œuvre la plus sale et lugubre de sa discographie.
Premier jet en solitaire – on l’a dit – de la maison de Shaolin, l’album n’aura cependant pas la résonance et la pérennité de projets aussi définitifs que Liquid Swords ou Only Built 4 Cuban Linx… Certes, Method Man est l’une des personnalités les plus en vue du groupe, comme le montrent rapidement ses excellentes collaborations extérieures (notamment avec la dualité sacrée Tupac et Biggie Small). C’est un monstre de charisme, une voix éraillée qui hypnotise comme peu et un beau bordel en prévision chaque fois qu’il attrape un micro. Mais il n’a pas l’habileté de Raekwon pour raconter des histoires, ni la densité d’écriture de GZA. Il n’a pas non plus la folie furieuse d’Ol’ Dirty Bastard, ni la versatilité de Ghostface Killah. Ainsi Tical se réclame d’une substance différente, plus vaporeuse même si bel et bien consistante. Un disque à part dans la mythologie dont il fait partie, au pouvoir de fascination aussi puissant que celui qu’aurait une plantation de 36 hectares de weed en face de son auteur. Pour beaucoup pourtant, il restera le plus faible de cette première fournée solo. C’est dire comme l’armée du Wu allait fumer la planète les deux années suivantes.
« Wu-Tang Clan forever, no we don’t die, we just multiply forever, and ever, and ever… »
En voilà une surprise qu’elle est bonne ! On a beau associer le nom de Ghostface Killah à d’excellents souvenirs, le considérer comme l’un des meilleurs storytellers du genre, on ne va pas se mentir : on le croyait condamné à sortir des albums jamais complètement convaincants parce que trop inégaux, accrocheurs sur le moment mais à la durée de vie limitée. Et voilà que Twelve Reasons to Die vient démentir cette prédiction. Comme le remarque justement Anthony Fantano dans sa chronique vidéo, ce nouvel opus rappelle Fishscale : Ghostface y joue à peu près le même personnage de boss du crime. Mais alors que Fishscale n’était encore qu’une collection de morceaux, Twelve Reasons to Die propose un récit unitaire. Sur ce plan au moins, là où son prédécesseur avait plus ou moins échoué, celui-ci réussit… peut-être pas totalement, mais on n’en est vraiment pas loin.
Pourquoi ne paraît-il pas complètement abouti, cet album aussi théâtral (le rôle des chœurs à l’antique, qui plantent le décor d’emblée) que cinématographique, nourri de films d’horreur de série B, de westerns spaghetti et de thrillers mafieux (l’histoire est censée de dérouler dans l’Italie de la fin des années 1960), et qui est en plus le pendant d’un comic book à son image ? À la limite pas tellement à cause du manque de complexité de l’intrigue, histoire de vengeance entre gangsters assez banale même si elle est post-mortem et passe par une phase de « vinylification » des cendres de Tony Starks alias Ghostface Killah. C’est surtout que la narration n’est pas toujours très bien distribuée. Les douze plages ne correspondent pas exactement à autant d’actes ou de chapitres bien distincts, d’où des redondances. On regrette d’ailleurs que les transitions entre les morceaux ne soient pas plus travaillées : certaines coupures sont regrettables, comme entre la réverb’ de la voix de Cappadonna sur ’The Center of Attraction’ (« She’s a set up chick !« ) et le début de « Enemies All Around Me ». Des réserves qui n’empêchent pas Twelve Reasons to Die de valoir sérieusement le détour.
Ghostface, c’est le genre de gars qui a besoin d’être cadré, sinon il se disperse. Ce cadre c’est, d’un côté, RZA, concepteur, narrateur et producteur exécutif, accessoirement proche de Tarantino, seul réalisateur nommément cité dans l’album ; de l’autre le compositeur Adrian Younge, compositeur de bandes originales remarquées avec son groupe Venice Dawn. Ses compositions, dans lesquelles on peut sentir aussi bien l’influence de la Blaxploitation que celle d’Ennio Morricone, créent une ambiance propice au conte. Faisant la part belle au clavier et aux cordes, ornées d’arrangements aussi simples qu’efficaces (mention spéciale à l’entrée en scène de la cloche et des cuivres au milieu du deuxième couplet de l’excellent « The Rise of the Ghostface Killah » et aux scratches qui suivent, hommage direct à feu ODB), elles possèdent deux atouts. D’une part, elles jouent abondamment sur la panoramique – à écouter au casque pour en profiter pleinement ! De l’autre, elles créent des variations dans les morceaux pour accompagner la narration. Après une ouverture venteuse-pluvieuse, « The Center of Attraction », dans lequel Cappadonna essaie en vain d’avertir son patron aveuglé par l’amour que sa chère et tendre est en réalité une traîtresse au service de ses ennemis jurés, est ainsi fait de variations sonores qui traduisent le désaccord entre les interlocuteurs et les états d’âme du personnage principal.
Mais c’est peut-être le dernier morceau rappé, « The Sure Shot » et ses deux parties, qui constitue le sommet du disque. Dans ce morceau plus encore que dans d’autres, le protagoniste change son flow selon les couplets : d’abord véloce pour accompagner les emballements de la batterie, il l’adoucit ensuite pour se caler sur le ralentissement du tempo, avant de mettre dans sa voix une pointe de repentir dans le couplet final. Immédiatement brillant quand les BPM s’accélèrent (« Blood on the Cobblestones », « The Rise of the Ghostface Killah », « Murder Spree » qui passe en revue diverses façons de tuer ou de mourir), Dennis Coles paraît, à la première écoute, moins à l’aise sur d’autres passages, dont son premier couplet sur « Beware of the Stare ». Cependant, outre les changements de ton les plus nets comme sur le soliloque implorant du deuxième couplet de « Enemies All Around Me », les inflexions qu’il donne à sa voix et son phrasé se manifestent plus clairement à mesure des écoutes. Nombreux, les comparses invités sont aussi convaincants et complémentaires, les prestations de Killa Sin et du toujours précis Inspectah Deck étant particulièrement notables.
En définitive, alors que certains membres du Wu-Tang ont plus ou moins sombré, pendant d’autres n’ont jamais vraiment réussi à faire leur place malgré leurs qualités (Inspectah Deck, encore une fois), Ghostface, bien entouré pour ce dixième album studio officiel que la version d’Apollo Brown permet de redécouvrir sous un nouvel angle, frappe fort. Si la relative courte durée (moins de quarante minutes) de Twelve Reasons to Die est au premier abord un peu frustrante, elle sera en fait peut-être un facteur de longévité. “My plots are like movie scripts, they’re well planned.”
WKCR-FM est la radio de l’Université de Columbia, située à Manhattan. En octobre 1990, un DJ étudiant de son état, Adrian « Stretch Armstrong » Bartos, et son collègue ubiquiste Roberto « Bobbito » Garcia, commencèrent à y animer une émission hebdomadaire, « The Stretch Armstrong Show w/ Bobbito The Barber ». A l’époque, des artistes aussi prestigieux que Nas, Jay-Z, Big L, Big Pun ou le Wu-Tang Clan s’y révélèrent aux oreilles de New York et du monde entier, souvent à la force de freestyles mythiques. Le programme fût rapidement érigé au rang de monument d’une musique Hip-Hop en pleine ébullition. The Source le couronna ainsi meilleur show Hip-Hop de tous les temps.
En 1998, Stretch Armstrong décida de quitter le navire. Lord Sear le remplaça. L’émission poursuivit alors sur la lancée entamée quelques années plus tôt, contribuant à faire décoller la carrière de quelques grands noms de la scène indépendante de la fin des années 1990. Parmi ceux-là, citons Cage, Mhz, Non Phixion, Arsonists ou Company Flow. En marge du show, désormais baptisé « CM Famalam Show », Bobbito gérait le label Fondle’em Records, où sortirent de 1996 à 2001 quelques maxis mythiques de l’époque.
En 2003, Bobbito et Lord Sear renoncèrent à animer le programme. Présent dans l’équipe depuis plusieurs années, Sucio Smash prit la relève. La scène Hip-Hop de New York perdait en vigueur, mais le désormais « Squeeze Radio Show » demeurait une référence, bien que nettement moins suivi que par le passé. Torae, Roc Marciano ou Eternia y gagnèrent une précieuse attention.
2010 sonne malheureusement le glas de ce bout d’histoire de la musique Hip-Hop. Les responsables de WKCR-FM ont annoncé que les émissions programmées devaient désormais être présentées par des étudiants de l’université. Depuis le départ de Stretch Armstrong, cela n’avait plus été le cas. Malgré une pétition très largement signée, la décision de supprimer « The Squeeze Radio Show » est apparue irrévocable.
Totale coïncidence, le couperet est tombé vingt ans presque jour pour jour après le lancement du « Stretch Armstrong Radio Show ». Une émission spéciale célébrant cet anniversaire avait été programmée de longue date pour le 22 octobre, animée par Stretch, Bobbito et Lord Sear. Ponctuée de fous rires et d’anecdotes plus que de musique, elle sera donc la dernière, le point final d’une page importante de l’histoire du Hip-Hop. Après la fermeture du magasin Fat Beats, c’est un nouveau symbole du rap new-yorkais qui s’efface pour peut-être, on l’espère, mieux réapparaître plus tard, sous quelque forme que ce soit.
Quelques extraits vidéo du show
Sorti en 1997, The Psycho-Social, Chemical, Biological, and Electro-Magnetic Manipulation of Human Consciousness (plus communément appellé The Psycho-Social LP) de Jedi Mind Tricks est, comme son nom l’indiquerait presque, un OVNI sonore et textuel. Stoupe y propose des beats lents et étranges, plantant une atmosphère oppressante et lugubre à souhait. Ikon the Verbal Hologram, lui, jongle avec conviction entre toute une panoplie de sujets ésotériques, paraissant totalement habité par ses délires hallucinés et hallucinants.
Dans le livret de la réédition CD de l’album, les différentes influences du groupe sont citées (de Mao à EPMD en passant par Charles Bukowski), et on apprend que le disque a été enregistré sous l’influence d’immenses quantités d’alcool. Les principaux acteurs rechignant aujourd’hui à revenir sur la conception de cette œuvre et sur cette époque, il est dur d’en savoir plus sur la genèse de ce véritable classique de la scène Hip-Hop indépendante. On aurait pourtant aimé en savoir plus sur le processus de création de morceaux aussi atypiques, et, par rebond, sur la mutation qui s’opérera dans le groupe à la fin des années 1990, avant la sortie de « Violent By Design ».
.A défaut de disposer de la parole des protagonistes, l’analyse d’un élément mésestimé du travail du groupe peut fournir un nouvel éclairage. On a beaucoup dit sur les paroles brumeuses d’Ikon et sur les productions baroques de Stoupe. Les scratchs de l’album et de ses bonus tracks ont en revanche été bien moins évoqués. Pourtant, ils s’avèrent révélateurs et constituent de véritables actes de filiation. Avec les ténors du rap hardcore new-yorkais d’alors (Wu-Tang Clan, Boot Camp Click), les aînés de Philadelphie (The Roots, Bahamadia), et les tenants d’un rap plus complexe (Organized Konfusion, The Pharcyde). Ce tryptique résume parfaitement l’essence du « Pyscho-Social LP » et des morceaux du groupe antérieurs à celui-ci, baladant l’auditeur entre les rues glaciales de Philadelphie et l’esprit mystique torturé de Vinnie Paz. Retour donc sur les titres d’où sont tirées les phrases scratchées.
« I use Jedi mind tricks to find tricks »
Del The Funky Homosapien - « No More Worries » (1993)
Posse-cut tiré du second album de Del The Funky Homosapien, et l’une des premières apparitions du collectif Hieroglyphics en tant que tel. Le lien entre Del et Jedi Mind Tricks paraît relativement évident : le goût pour la science-fiction. La phrase scratchée et le blaze même de JMT ne laissent planer aucun doute. Le cousin d’Ice Cube associera d’ailleurs cette passion avec le rap, pour le fabuleux et futuriste « Deltron 3030 », en collaboration avec Dan The Automator et Kid Koala.
« Giving sight to the blind, the dumb are mostly intrigued by the drum »
Wu-Tang Clan - « Triumph » (1997)
Début 1997, le Wu sort d’un parcours sans faute, et veut bouffer la planète entière toute crue. RZA raconte à qui veut l’entendre qu’à terme, tous les groupes de rap se revendiqueront du Wu-Tang Clan. Symbole de cette époque dorée, ‘Triumph’ respire la démesure à plein nez : un clip magnifique, un instru monumental, des paroles grandiloquentes. Et l’un des meilleurs couplets de l’histoire du rap, posé par Inspectah Deck. JMT a pourtant fait le choix de s’arrêter sur des mots prononcés par Masta Killah, pleins d’un mysticisme parfaitement dans le prolongement des textes d’Ikon.
« And my basement’s an arrangement of different torture devices »
Street Smartz - « Metal Thangz » (1996)
Les aficionados de “Faites entrer l’Accusé” se redresseront dans leur fauteuil : la sample utilisé dans le morceau est également employé comme musique d’ambiance dans le show de Christophe Hondelatte. Du reste, on sait peu de chose de Street Smartz. Tout juste que F.T., son MC principal n’avait même pas 17 ans à l’époque de ‘Metal Thangz’, et qu’il poursuit aujourd’hui une carrière tout à fait décente. JMT s’attarde plutôt sur le couplet de Pharaohe Monch, influence visiblement importante pour le groupe, qui lâche une phrase tout à fait dans l’esprit du titre « Chinese Water Torture ».
« Suffer Chinese water torture, my word is water »
Jedi Mind Tricks - « Neva Antiquated » (1996)
On n’est jamais aussi bien servi que par soi-même. Le scratché ici est Ikon lui-même, sur « The Amber Probe EP », toute première sortie du groupe. On y trouve la version originale de ‘Neva Antiquated’ : du Jedi Mind Tricks première époque, dans toute son étrangeté. Le sample ressemble un peu à la musique pour entrer en contact avec les extra-terrestres dans « Rencontre du troisième type », les backs sont déformés, et Ikon lâche un texte difficilement compréhensible, criblé de référence en tous genres : à « WarGames », à la mythologie égyptienne, à la physique nucléaire. Et donc à ce procédé de torture chinois, dont le principe était de laisser tomber de l’eau, une goutte à la fois et de façon régulière, sur le front d’un supplicié, conduisant lentement celui-ci à la folie.
« I am in fact lacking confusion as to what’s real, and what’s illusion »
DJ Krush ft. Black Thought - « Meiso » (1996)
‘Meiso’, un morceau comme on n’en fait plus vraiment. Un break de batterie, deux notes de piano et une ligne de basse. Finalement, une bonne prod ne tient pas à tant que ça. Avant de pencher vers une musique Hip-Hop beaucoup plus expérimentale, le Japonais DJ Krush l’avait parfaitement compris. Et puisqu’il ne s’entourait pas des plus mauvais, ses œuvres de l’époque méritent vraiment attention. Ici, ce sont Black Thought de The Roots et Malik B. qui sont conviés. Jedi Mind Tricks utilise ici une phrase obscure et mystique du premier, bien dans le ton de ‘The Three Immortals’.
« My perception of poetical injection is ejaculation, the Immaculate Conception »
Organized Konfusion - « Stress » (1994)
A l’écoute de « The Psycho-Social LP », Pharaohe Monch apparaît un peu comme l’aîné naturel et spirituel d’Ikon the Verbal Hologram. Par la richesse de son vocabulaire, la complexité des structures utilisées (dont la phrase scratchée ici est un exemple), les thématiques et les références audacieuses pour un rap des années 1990 finalement assez frileux dans ce domaine. Monch (époque Organized Konfusion) était également un adepte des allers-retours textuels entre la réalité de la rue et ses pensées les plus torturées ou profondes, point qui contribuera grandement au succès d’Ikon, puis de Vinnie Paz.
« Non-conceptional, non-exceptional (…) ya whole aura is plexi-glass »
O.C. - « Time’s Up » (1994)
A l’instar de ‘Shook Ones pt.II’, une part non-négligeable des rimes de ‘Time’s Up’ ont été scratchées, même si ce fut par des artistes moins célèbres que ceux ayant fait référence aux mots d’Havoc et de Prodigy. Les formules chocs se succèdent, et le discours, volontiers moralisateur, prend vite l’allure d’un manifeste underground. Le morceau peut à bien des égards être vu comme le point culminant de la carrière d’O.C., qui, de par la qualité de ses premiers albums et ses affiliations (Organized Konfusion, D.I.T.C.), reste considéré comme un artiste majeur des mid-1990’s. Pas étonnant à ce titre que JMT fasse référence à son travail.
« There comes a time in every man’s life, when he’s gotta handle shit up on his own »
The Pharcyde - « Runnin » (1995)
‘Runnin’ est un titre phare des années 1990, auquel beaucoup d’entre nous associent des souvenirs inoubliables. Si à l’époque c’était surtout la prod de Jay Dee qui retenait notre attention, le message du morceau a depuis pris tout son sens : arrivé à l’âge adulte, on se doit de faire face à ses problèmes et d’arrêter de fuir la réalité. Du grown-man rap avant l’heure. La phrase scratchée intervient au terme du morceau ‘I Who Have Nothing’, comme un conseil à Ikon pour affronter les démons évoqués dans son texte.
« 1-2-3, let me know if you’re ready for me, lawd »
Black Moon - « U da Man » (1993)
Le posse-cut légendaire qui clôt le classique de Black Moon, « Enta da Stage ». Un morceau purement dans le style de la future-Boot Camp Click : break de batterie lourdissime, ligne de basse à faire se fissurer les murs les plus épais, quelques petits effets ça et là. Et bien évidemment, des MCs efficaces et menaçants. Smif’n’Wessun apparaissent pour l’une des premières fois, Dru Ha lâche l’unique couplet de sa carrière de MC. Et Buckshot achève la démonstration par une prestation très empreinte de ragga, au sein de laquelle JMT piochera la phrase faisant office de refrain dans ‘Onetwothree’.
« Soul’s from the streets of the Ill-a-delphiadaic insane »
The Roots - « The Lesson Part I » (1995)
Au milieu des années 1990, Schoolly D avait ses plus belles années derrière lui, et Jazzy Jeff & The Fresh Prince étaient passés à d’autres activités, plus rémunératrices que le rap. The Roots constituaient donc plus que jamais la figure de proue du rap de Philadelphie. Pas étonnant donc que Jedi Mind Tricks, à l’époque de ses balbutiements, ait tant fait référence à la discographie de la bande à Black Thought. Celui-ci a même collaboré avec Jus Allah et Vinnie Paz, pour l’un des tous premiers titres de JMT, ‘Get This Low’.
« Rhyme be coming from an illadelph state of mind »
The Roots ft. Bahamadia - « Proceed III » (1994)
Un titre jazzy, laid-back et agréable, comme The Roots en ont tant produit au cours de leur brillante carrière. Y apparaît Bahamadia, autre citoyenne de Philly, alors en passe d’être adoubée par la Gang Starr Foundation, et devenir ainsi l’une des female MCs les plus respectées du milieu. Quelques années plus tard, une fois la vague du succès passée, Bahamadia intégrera le premier roster de Army of the Pharaohs, pour le premier single du crew créé par Vinnie Paz. Comme pour The Roots, Jedi Mind Tricks a cherché dans le répertoire de la BB Queen une référence à Philadelphie, pour constituer le refrain de ‘Souls from the Streets’, hymne à la ville de l’amour fraternel.
« Yes yes y’all and you don’t stop, to the beat y’all and ya don’t stop »
Common Sense - « I Used to Love H.E.R. » (1994)
Le titre par lequel le scandale arrive. Sous couvert d’une personnification du Hip-Hop, Common y dénonce de façon plutôt subtile les dérives du rap et attaque le gangsta-rap. Ce qui lui vaudra des réponses plus frontales, notamment de la part de la Westside Connection. Ce beef aura toutefois beaucoup fait pour la popularité et la suite de la carrière du rappeur de Chicago. Jedi Mind Tricks utilisera les phrases d’ambiance de début et de fin de morceau, pour le refrain de ‘Last Straw’.
« And I get busy over unknown traps »
Main Source - « Just Hangin’ Out » (1991)
L’ancien groupe de Large Pro’ reste surtout dans les mémoires pour avoir permis à Nas de faire sa première apparition sur disque. Mais avec son premier album, « Breaking Atoms », Main Source a également influencé une bonne partie de ceux qui allaient devenir les plus grands artistes Hip-Hop des années 1990. Jedi Mind Tricks pioche ici dans ‘Just Hangin’ Out’, l’un des singles de « Breaking Atoms », dont le sample principal (Sister Nancy – ‘Bam Bam’) sera également utilisé par NTM et Raggasonic (‘Aiguisé comme une lame’).
« Jacques Cousteau could never get this low »
Wu-Tang Clan - « Da Mystery of Chessboxin’ » (1993)
Les ambiances poisseuses et hypnotiques de « The Psycho-Social LP » rappellent inévitablement certains aspects du travail de RZA, en particulier sur des albums comme « Liquid Swords » ou « Ironman ». On peut affirmer sans prendre trop de risques que le Wu a été l’une des influences majeures de Jedi Mind Tricks. GZA collaborera d’ailleurs avec Vinnie Paz et Stoupe à l’occasion de « Legacy of Blood ». Là, la phrase est empruntée au regretté O.D.B., et donne son titre au morceau ‘Get This Low ‘, collaboration entre Black Thought et des MCs de Jedi Mind Tricks encore adolescents.
« And I’ma get mad deep like a threat »
Wu-Tang Clan - « Protect Ya Neck » (1993)
Le morceau qui lancera la carrière du Wu-Tang Clan. Instru nerveuse et lo-fi, flows déchaînés, paroles acérées. Un clip mythique en noir et blanc, complètement cheap, qui posera les bases de l’imagerie du crew de Staten Island. Le Wu époque rap des caves, dans toute sa splendeur. Il n’y avait vraiment que RZA pour voir en cette formule complètement archaïque la clé du succès commercial. En tout cas, près de vingt ans après, le pouvoir de fascination est intact.
Les cérémonies crématoires sont rarement joyeuses. Particulièrement quand elles viennent mettre un terme à une dynastie marquante. Attendu avec un mélange de curiosité et d’inquiétude, le cinquième album du collectif new-yorkais le plus influent des années quatre-vingt dix concède finalement peu de place aux alternatives et à l’interprétation. Passé quelques écoutes, il laisse tomber brutalement et sans équivoque un couperet qu’on savait tristement proche. 8 Diagrams ou la froide confirmation de la fin.
Alors évidemment, RZA, bien entouré pour l’occasion, n’est pas devenu brutalement un piètre producteur et les huit membres actifs du groupe d’obscurs seconds couteaux (exception faite de U-God, qui l’a finalement toujours été). 8 Diagrams n’est pas non plus le pire album de l’année écoulée ; on y retrouve quand même par instants quelques motifs de réjouissances. Method Man y rappelle qu’il n’est pas encore tout à fait cuit, Ghostface se fait rare mais reste tranchant à chacune de ses apparitions, et RZA, toujours charismatique micro en main, envoie aussi quelques productions loin d’être dégueulasses (‘Weak spot’, ‘The heart gently weeps’, ‘Windmill’). Mais quand on a atteint, défini et dépassé les sommets, on entretient une toute autre attente. Les miettes ne suffisent plus.
Il manque indéniablement beaucoup de choses à cet album pour rallumer la mèche et ressusciter la flamme perdue. A commencer par un minimum d’unité et d’émulation. Les sérieuses dissensions internes, querelles d’égo, et autres excès d’individualismes relayés publiquement depuis plusieurs mois, transparaissent tout au long de cette cinquième galette un peu moisie. Les arrangements, musicaux et humains, de RZA ne peuvent de toute façon tout corriger.
Des abeilles tueuses, aux extraits de films d’arts martiaux, affiliés habituels (Cappadonna, Streetlife), et autres gros samples de soul – ‘Nautilus’ (Bob James) sur ‘Take it back’, ‘There’s a riot goin’ on’ (Sly and the family stone) sur ‘Windwill’ – on retrouve bien quelques unes des références qui ont fait l’identité du Wu. Clin d’œil ultime à ces références, la participation posthume d’Ol’ Dirty sur un ’16th chamber’ sorti d’outre-tombe.
Mais le manque d’alchimie domine un ensemble qui se traine sur la longueur, plombé de surcroit par une surabondance de (mauvais) refrains chantés. En somme, les têtes de proue du Wu-Tang Clan ont, individuellement, de la réserve. C’est bien collectivement que le groupe ne fait plus front.
8 Diagrams n’est pas seulement un pétard mouillé hors de son époque. Il fait également état de l’érosion du temps tout en rappelant combien il peut être difficile de tourner définitivement la page. Il s’agit probablement du dernier album du Wu-Tang, et c’est finalement mieux comme ça.
2001. Entre les errements divers de Method Man, l’incarcération prolongée du sale vieux bâtard Russell Jones et le catastrophique deuxième volet Bobby Digital, la sortie d' »Iron Flag », à peine un an après le mitigé The W, avait de quoi laisser sceptique. Le mauvais ‘Uzi (Pinky Ring)’ disponible avant en maxi semblait même annoncer le naufrage du navire de Staten Island.
Mais si le Wu-Tang Clan a été ses dernières années atteint par le virus de la surproduction, il n’en reste pas moins un collectif immensément talentueux, souvent imité, jamais égalé. Rza, tête pensante et baromètre du groupe, produit huit des treize morceaux de cet opus, alternant, à l’image de l’album, passages brillants (‘In the hood’, ‘The W’) et d’autres plus obscurs, (‘Soul Power’, ‘Uzi)’. Il est soutenu dans son œuvre par le fidèle Mathematics, auteur de l’excellent ‘Rules’, Trumaster pour le très efficace ‘Y’all been warned’, Nick Loftin et le duo Poke & Tone, respectivement auteurs de ‘One of these days’ et ‘Back in the game’ (deux morceaux plutôt décevants.)
Musicalement cohérent, Iron Flag ne s’avère pas pour autant monocorde. Au carrefour des émotions et des atmosphères, entre colère, apaisement et pure provocation, il dévoile différentes facettes du groupe tout en offrant finalement peu de surprises. L’influence Soul, propre aux productions estampillées Wu-Tang Clan, est une nouvelle fois présente, et les passages chantés étonnamment fréquents. Ron Isley, icône Soul dès le début des années 1960, (et membre des fameux Isley Brothers) se charge notamment du refrain de ‘Back in the game’.
Apparemment désireux de ne pas répéter les erreurs passées, le collectif de Staten Island s’est appliqué à réduire à la portion congrue le nombre d’invités. Exit les Snoop Doggy Dogg, Nas et autres Busta Rhymes dont les apparitions respectives sur The W avaient peu convaincu et plutôt nuies à la cohérence d’un album particulièrement inégal. Le mythique Flavor Flav’ est donc cette fois-ci le seul MC invité ; le temps d’un ‘Soul Power’ à la fois brut et tout à fait convaincant.
En terme d’emceeing, Genius, Method Man et Ghostface Killah alternent tout au long de cet album le bon et le moins bon. Désormais tête de file d’un collectif historique, Tony Starks, le tueur à la tête de fantôme, y déroule un phrasé parfois larmoyant absolument fascinant et unique. Si Raekwon s’avère particulièrement discret, il est justement suppléé par un Masta Killa décidément brillant. Véritable mosaïque de styles aux influences (relativement) communes, le collectif mené par son chef de file Rza rappelle par moments, et non sans une certaine nostalgie, un passé récent. Mention spéciale au tueur au visage de fantôme Tony Starks pour cette rime tombée en pleine actualité « Who the fuck knocked our buildings down ? Who the man behind the World Trade massacres step up now. » L’avenir répondra à cette question brûlante…
Si Iron Flag n’a rien à voir avec le mythique Enter the Wu-tang ; les temps ont changé, les acteurs et les enjeux aussi; ce nouvel opus s’inscrit dignement dans la lignée de la dynastie du groupe New-Yorkais. Un album efficace à défaut d’être surprenant. Wu-Tang saga continues…