Tag Archives: rza
Le rap et le cinéma, c’est une histoire qui dure. Depuis plus de trente ans, le second a infusé le premier par toutes les entrées créatives : la référence textuelle à un titre de film, à un personnage ou à une phrase particulière, le sample musical, l’extrait de dialogue, la répétition de scènes cultes, le visuel d’un clip… Rares aujourd’hui sont les albums à ne pas contenir au moins un échantillon de cinéma, peu importe sa forme. Et si ces références tiennent la plupart du temps du simple clin d’œil ou du bon mot (ou, parfois, du running gag), certains artistes ont pris le temps de décortiquer et de comprendre les œuvres qu’ils citent, d’en tirer la substantifique moelle pour soit les intégrer à leur univers, soit se fondre entièrement dans le leur. Généralement, cet exercice est réalisé à l’échelle d’un visuel qui annonce l’ambiance, d’un morceau thématique ou d’un clip plus chiadé que les autres. Mais il arrive que des albums entiers soient pensés et construits autour d’une référence cinématographique en particulier, travaillée pour donner au projet une certaine ambiance, une épaisseur visuelle, une autre dimension. Ce sont ces derniers que cet article, inscrit dans une série intitulée le contre-champ, va s’échiner à analyser. Après Liquid Swords et Shogun Assassin, plongée dans un autre grand classique du Wu-Tang Clan : Only Built 4 Cuban Linx…, premier solo de Raekwon largement influencé par le style John Woo et son magnum opus, le film culte The Killer.

LE FILM : THE KILLER (John Woo, Hong-Kong, 1989)
Lorsqu’il réalise The Killer en 1989, John Woo a déjà seize réalisations à son actif. Passé par la société de production Shaw Brothers puis par la Golden Harvest (la maison de Bruce Lee et de Jackie Chan, qui a importé aux États-Unis le cinéma hongkongais), il est rompu aux films d’action et d’arts martiaux. En 1983, il rejoint le réalisateur Tsui Hark chez Cinema City, qui lui permet de tourner son premier classique, Le Syndicat du crime. Avec cette histoire de frères ennemis, il donne naissance au sous-genre de l’heroic bloodshed, qui définit un film d’action à l’arme à feu, très violent et très stylisée, tournant autour des thèmes de la rédemption, de l’honneur et de la fraternité. Dans l’esprit occidental, si The Killer est donc le « premier », le film qui a révélé John Woo, il est en réalité une œuvre somme, celle où se rencontrent les grands thèmes d’un cinéaste fasciné par la violence visuelle du cinéma américain des années 70 et par la sobriété du polar à la française.
The Killer, c’est l’histoire de Ah Jong (interprété par Chow Yun-fat), un tueur à gage qui opère pour les Triades de Hong-Kong. Lors de la fusillade qui suit l’exécution d’un contrat, il blesse une chanteuse de nightclub, Jennie, rendue aveugle par un flash de bouche. Épris de sa victime collatérale, Ah Jong décide d’accepter un dernier job pour lui payer l’opération qui lui fera retrouver la vue, tout en étant traqué à la fois par l’inspecteur Li et ses commanditaires qui se retournent contre lui. Si pléthore de références viennent nourrir le film (la violence graphique de Scorsese, Leone et Peckinpah, l’esthétisation et certains motifs de Michael Mann dans Le Solitaire ou Le sixième sens) le pitch évoque surtout une matrice principale, à savoir Le Samouraï de Melville, sommet du polar français froid et épuré. Comme Jef Costello interprété par Alain Delon, Ah Jong (qui en version française est renommé… Jeff Chow), est un assassin solitaire, félin, élégant, quasi-mutique. Ils sont tous deux traqués, à la fois par leurs pairs et par les autorités. Leurs âmes tourmentées se ressourcent dans le calme (une église pour Ah Jong, son appartement pour Jef Costello). Ils cherchent la rédemption en sauvant une jeune femme (une chanteuse pour Ah Jong, une pianiste Jef Costello) rencontrée lors de l’exécution d’un contrat. Enfin, tous deux connaitront inévitablement une fin violente au bout de la route qu’ils se sont tracée à coup de flingues. Fort heureusement, ces nombreux emprunts et inspirations de John Woo ne prennent jamais le pas sur ce qui fait le sel de son cinéma : sa forme outrancière et son fond profondément chevaleresque.
The Killer, comme les autres grands films de John Woo, raconte avant tout une histoire de fraternité – au sens propre ou figuré de camaraderie virile. La relation entre le tueur et le policier, entre Chow Yun-fat et Danny Lee (qui joue l’inspecteur Li), est pétrie de respect et de considération. Loin des figures unilatérales de Jef Costello ou de Frank (Le Solitaire), dont les relations avec les autorités sont purement conflictuelles, Ah Jong devient pour son poursuivant un objet d’admiration. Li est fasciné par la noblesse de ses actions (en plus de vouloir rendre la vue à Jennie, lors de sa deuxième mission, Ah Jong se met en danger pour sauver une petite fille pendant une fusillade) qui entre en contradiction avec son métier d’assassin. Cette admiration lui sera rendue, et Ah Jong finira par voir en Li un véritable ami, un allié précieux qui pourra l’aider à échapper aux Triades et à pouvoir, enfin, se ranger.
Ces thèmes très orthodoxes, le respect, le code de l’honneur, le devoir, constituent le cœur du cinéma de John Woo. Mais ils n’auraient pas le même impact s’ils n’entraient pas en opposition avec une forme aussi démesurée. Mille fois copiée jusqu’à la parodie (y compris par John Woo lui-même dans certains de ses films américains), la mise en scène débridée de ses heroic bloodshed reste un modèle indépassé du genre. Gunfights orgiaques, chorégraphies délirantes, effets pyrotechniques à foison : jamais de tels accès de violence n’avaient été filmés avec autant de lyrisme et de poésie. La grâce des mouvements de caméra, l’irréalisme des cascades, la sécheresse des coupes, tout concourt à faire des fusillades de vrais ballets macabres. De ce point de vue, The Killer est un film en état de grâce constant, dont le rythme ultra-nerveux des scènes d’action ressort d’autant plus qu’il est tempéré par la quiétude des moments plus intimes, entre Ah Jong et Jennie ou Ah Jong et Li. C’est principalement cette dynamique qui inspirera nombre de cinéastes – Tarantino, Besson, Rodriguez, parmi d’autres. Mais au moment de produire le Only Built 4 Cuban Linx… de Raekwon, c’est autre chose que RZA, tête pensante du Wu-Tang Clan, a à l’esprit.

L’ALBUM : ONLY BUILT 4 CUBAN LINX… (Raekwon ft. Ghost Face Killer, 1995)
Après Method Man et Ol’ Dirty Bastard, Raekwon est le troisième membre du Wu-Tang a sortir, le 1er août 1995, son album solo produit par RZA. Alors que Tical et Return to the 36th Chamber : The Dirty Version, malgré des identités bien marquées, prolongent d’une certaine manière le son martial et dépouillé d’Enter the Wu-Tang (36 Chambers), Only Built 4 Cuban Linx… s’engage dans une autre direction. Plus cinématographique, plus narratif, plus dense, il relaie le kung-fu au second plan pour mettre en scène des histoires violentes de gangsters, de trafics de drogue, d’amitiés et de trahisons. Si l’influence du séminal Live and Let Die de Kool G Rap – qui n’a pas son pareil pour raconter des affaires de bandits – est bel et bien présente, OB4CL demeure un album pionnier du mafioso-rap. Juste après lui Jay-Z, AZ ou encore Nas s’inventeront eux-aussi des personnages et raconteront des histoires sordides de crime organisé, de contrats honorés entre deux flûtes de champagne et un trajet en limousine.
Sur OB4CL, les rappeurs présents ont tous de nouveaux alias : Raekwon est Lou Diamond, Ghostface Killah est Tony Starks, Inspektah Deck est Rollie Fingers, Masta Killah et GZA sont Noodle et Maximilian (un clin d’œil aux gangsters joués par Robert de Niro et James Wood dans Il était une fois en Amérique) … Même Nas, qui pourtant ne sortira It Was Written que l’année suivante, est déjà crédité en tant que Nas Escobar. Une manière d’ajouter à la texture cinématographique du disque, mais aussi un renvoi direct à The Killer dans lequel les deux protagonistes se surnomment Butthead et Numbnuts (Mickey Mouse et Dumbo en VF). Cette dualité entre Ah Jong et l’inspecteur Li, forcés de s’allier pour survivre, va servir de modèle à celle qui existe entre Raekwon et Ghostface Killah. Crédité en tant que featuring sur l’album, présent sur quatorze pistes, GKF est l’autre prodige de OB4CL, et la relation entre les deux MC’s constitue l’un des centres névralgiques du disque.
RZA a souvent raconté qu’il a souhaité mettre en avant deux rivaux, originaires de deux quartiers de New York – Stapleton pour GFK, Park Hill pour Raekwon – et qui avant l’aventure Wu ne se connaissaient qu’à travers lui. L’alchimie fonctionne à plein pot. C’est une harmonie magnétique sur « Criminology », une manière de se tirer vers le haut sur « Rainy Dayz », des réminiscences partagées sur « Can It Be All So Simple (Remix) ». Raekwon est la star, Ghostface le partner in crime idéal, et le duo renvoie la même énergie que celui du film : au-delà de leurs origines dissonantes, un amour fraternel, un profond respect empreint d’admiration et un but commun vient les réunir.
À l’origine de cette collaboration entre les deux artistes, RZA va prolonger la parallèle avec le film de John Woo et en infuser l’architecture de l’album. Comme il le fera avec Liquid Swords et Shogun Assassin, il choisit d’introduire OB4CL avec la musique qui introduit The Killer. Le vibraphone du thème principal, composé par Lowell Lo, distille immédiatement une atmosphère envoûtante, à la fois angoissante, onirique et mélancolique. Il reviendra plusieurs fois, comme une ritournelle, pour appuyer les récits criminels et introspectifs des interprètes. Tout comme Ah Jong, Lou Diamond arrive au bout de sa vie de bandit. Il compte se ranger, non sans réussir un dernier coup juteux avant de partir, et devra compter sur le soutien de son rival et acolyte pour y parvenir.
Sur « Striving for Perfection », Raekwon et Ghostface discutent de ce plan de sortie avec l’énergie du désespoir : « Yeah, word up, I’m tired of doing this shit ». Cette manière peu conventionnelle de se présenter installe une ambiance résolument sombre et sinistre, à l’image de l’église vide dans laquelle débute le film. En reprenant ces différents motifs, RZA va tisser une toile de fond passionnante, qui aura – chose assez peu commune pour être signalée – l’aval de John Woo lui-même. Ainsi raconte-t-il à XXL : « Mostly everything [of the spoken interludes] is from The Killer on that album, that or personal talking. I met John Woo that same year. He sent me a letter. He’s honored that we did it. I felt confident we could settle anything that came up. You can usually settle that shit. It’s part of the budget, man. But John Woo didn’t want nothing, never no money for that. We actually became friends, he took me and Ghost to lunch and dinner many times. He gave me a lot of mentoring in film1 ».

LES SAMPLES « We’re not supposed to trust anyone in our profession anyway »
The Killer est samplé à quatre reprises dans OB4CL. Cela peut paraître peu sur un album de dix-huit titres, mais le séquençage de RZA est suffisamment bien pensé pour rendre l’impression que le film y est omniprésent. Sur le thème principal de Lowell Lo, « Striving for Perfection » met en place des enjeux clairs dès le départ. Raekwon et Ghostface Killah y sont présentés comme deux bandits au bout du rouleau. Le projet : faire un dernier coup, un gros, pour sortir de New York, emmener sa famille loin d’ici et un jour pouvoir faire sauter ses petits-enfants sur ses genoux. Pendant cet échange de près de deux minutes, le thème principal de The Killer instaure, avec son vibraphone entêtant, une ambiance funèbre et anxiogène, mais aussi très aérienne, à la limite de l’imaginaire. C’est cette tonalité double, entre les baskets collées au bitume de la grosse pomme et les rêves de grandeurs, qui rend compte de l’état d’esprit de Lou Diamond et Tony Starks. Si le parallèle avec Ah Jong et ses velléités de retraite est évident, cet état d’esprit est aussi celui de Raekwon et de Ghostface : à ce moment de leur carrière, leur musique doit marcher coûte que coûte s’ils ne veulent pas rester des dealers de shit toute leur vie.
Ces multiples niveaux de lecture – réaliste, cinématographique, romanesque – se recoupent à d’autres moments du disque. Dans « Rainy Dayz », la chanteuse Blue Raspberry joue le rôle d’une femme de gangster, amoureuse et prisonnière d’un homme qu’elle reconnait de moins en moins, rongé par le grand banditisme et ses dangers. Sur un beat strident et atmosphérique de RZA, entrecoupé d’éclats de tonnerre et hanté par la pluie qui tombe à verse, Rae et Ghost narrent la décadence de la vie de rue tandis que le refrain met en évidence ses plus grands dommages collatéraux. Un échange extrait de The Killer rend explicite le parallèle avec Jenny, la chanteuse qui subit les affres du métier d’Ah Jong : « You sang beautifully just now / I sing for him and he isn’t here2 ». Comme elle, Blue Raspberry chante à perte l’absence d’un homme qui peu à peu devient fou, trop occuper à faire des affaires, à chercher sa voie hors de la criminalité tout en s’y enfonçant davantage un peu plus chaque jour. Là encore, c’est une situation qui résonne dans la vie des artistes, comme RZA l’explique, à XXL toujours : « This was too emotional and too real for me, too close to my personal situation. This was the life we was living, just talking and rapping and hoping. Record royalties take too long to come. We had a platinum album, but we waiting on the check to come fast, like babies wanting they food3».
Mais comme dit précédemment, le point névralgique d’OB4CL n’est pas tant le gangstérisme que l’amour qui unit les membres d’une grande famille. Un amour viril et fraternel digne du Parrain, dont la fragilité est à la hauteur de la force. Dans un milieu où les enjeux sont si élevés, les valeurs familiales ne tiennent pas toujours la dragée haute aux ambitions et les trahisons sont légion. À ce titre, la relation entre Raekwon et Ghostface apparait tout au long du disque comme une force pure et impérissable, pétrie de respect et d’admiration. Là, il faut s’attarder sur l’introduction d’« Incarcerated Scarfaces », l’un des rares solos de Raekwon, dédié aux proches et aux moins proches incarcérés. Un long monologue de l’inspecteur Li, en train de dresser un profil passionné de Ah Jong, fait démarrer le morceau : « He looks determined without being ruthless. Something heroic in his manners. There’s a courage about him, doesn’t look like a killer. Comes across so calm. Acts like he has a dream. Full of passion4 ». L’utilisation du singulier et du terme “killer” n’interdit pas de penser qu’il s’agit là d’un hommage direct de Raekwon à son acolyte Ghostface Killah.
Raekwon n’a d’ailleurs jamais caché l’amour véritable qu’il lui porte : « That’s my heart right there. We think so much alike. Like I’ll say something and he’ll be like, « Yo, I was just getting’ ready to say that, son5»», disait-il à Ego Trip, en 1995, au sujet de leur relation. Dans The Killer, l’inspecteur Li ne trahit jamais son amitié naissante avec Ah Jong. La tension qui monte avant leur face à face est en partie désamorcée par une scène au ton résolument humoristique, et très vite, leurs échanges ressemblent à ceux de deux vieux amis. Le doute sera plutôt instauré par l’homme qui fait parvenir à Ah Jong les contrats des Triades. Ainsi juste avant que « Incarcerated Scarfaces » ne débute, un second extrait est samplé à la suite du premier, sans coupure apparente alors qu’il s’agit dans le film de deux scènes différentes : « You don’t trust me huh ? / Well you know why / I do, we’re not supposed to trust anyone in our profession anyway6». Ce dialogue entre Ah Jong et son entremetteur s’impose comme une manière de rappeler que sur OB4CL, Rae et Ghostface sont aussi deux professionnels au travail dans un milieu où la méfiance reste de mise.
Le lien fraternel, quasi-romantique qui unit les deux protagonistes de l’album est donc, comme dans le film, immédiatement palpable et au-delà de toute suspicion. Mieux, il finira par s’étendre à l’ensemble de la Wu-family. « Wu-Gambinos » (en référence à l’une des cinq familles mafieuses de New York), posse cut énervé et point culminant du disque où chaque invité endosse son alias le temps d’un couplet dévastateur, est là pour rappeler que le Wu-Tang réussira ensemble ou ne réussira pas. L’introduction de cette seizième piste, qui contient le dernier sample de The Killer, vient faire écho aux tout premiers mots du disque : « And in our line of work, we need all the help we can get. Tony Wing’s the name. He works for a drug ring in Central America / Who wants to kill him ? / No information. Say yes or no / One-point-five million / All right, you’ll get what you want. Money is no object. They’re all clean. No serial numbers. Untraceable. And they’re explosive-heads bullets, your favorite / I felt like someone walk over my grave / You want to change your mind ?7 ».
Lorsque Rae et Ghost discutaient leur plan de sortie sur la musique envoûtante de Lowell Lo dans « Striving for Perfection », ils évoquaient l’idée d’un dernier coup qui rapporterait gros. Juste avant un final en apothéose (le diptyque céleste « Heaven & Hell » et « North Star (Jewels) », qui n’est pas sans évoquer les envols de colombes chers à John Woo), « Wu-Gambinos » est la concrétisation de cet ultime contrat. Un banger sauvage dont le beat sec et percutant, et les couplets surexcités de ses cinq interprètes armés jusqu’aux dents (« It’s the two holster, six-shots smoker », « Double-breasted, bulletproof vested, well protected »), n’est pas sans rappeler le gunfight apocalyptique qui clôt The Killer (« And watch your ass get thrown to a sea of fire and brimestone »). Cette image volcanique du feu et de la pierre n’est pas fortuite, tant c’est une fusion à plusieurs niveaux qui s’opère dans Only Built 4 Cuban Linx… Celle de Raekwon avec Ghostface Killah. Celle de RZA avec ses paroliers. Celle des paroliers avec leurs personnages fictifs. Et celle, bien sûr, d’un long-métrage et d’un long-playing. RZA l’avait sans doute compris avant les autres, lui qui signe dans le livret de l’album : « Special thanks to John Wu ».
1 « Pratiquement tous les interludes parlés viennent de The Killer sur cet album, ça ou des conversations personnelles. J’ai rencontré John Woo la même année. Il m’a envoyé une lettre. Il est honoré qu’on l’ait fait. J’étais certain qu’on pourrait régler tous les problèmes qui se poseraient. On peut, la plupart du temps. Ça fait partie du budget, mec. Mais John Woo ne voulait rien en échange, pas d’argent. Nous sommes même devenus amis, il nous a emmené, Ghost et moi, déjeuner et dîner de nombreuses fois. Il m’a donné beaucoup de mentorat dans le cinéma. »
2 « Vous venez de chanter merveilleusement / Je chante pour lui et il n’est pas là ».
3 « C’était trop émotionnel et trop réel pour moi, trop proche de ma situation personnelle. C’était la vie qu’on vivait, on parlait, on rappait et on espérait. Les royalties des disques mettent trop de temps à arriver. On avait un disque de platine, mais on attendait que le chèque arrive vite, comme des bébés qui réclament leur nourriture »
4 « Il a l’air déterminé sans être impitoyable. Quelque chose d’héroïque dans ses manières. Il y a du courage en lui, il n’a pas l’air d’un tueur. Il est si calme. Il agit comme s’il avait un rêve. Plein de passion »
5 « C’est mon cœur, juste là. On pense tellement pareil. Je dis quelque chose et il me dit : « Yo, je m’apprêtais à dire ça, fils » »
6 « Tu ne me fais pas confiance, hein ? / Tu sais pourquoi… / Je sais oui, on n’est pas censé faire confiance à qui que ce soit dans notre profession de toute façon…
7 « Et dans notre métier, on a besoin de toute l’aide possible. Son nom est Tony Wing. Il travaille pour un réseau de drogue en Amérique Centrale / Qui veut le tuer ? / Pas d’information. Dis oui ou non / Un million cinq cent mille / D’accord, tu auras ce que tu veux. L’argent n’est pas un problème. Ils sont tous clean. Pas de numéros de série. Intraçables. Et ce sont des balles à tête explosive, tes préférées / J’en ai des frissons / Tu veux changer d’avis ? »
Le rap et le cinéma, c’est une histoire qui dure. Depuis plus de trente ans, le second a infusé le premier par toutes les entrées créatives : la référence textuelle à un titre de film, à un personnage ou à une phrase particulière, le sample musical, l’extrait de dialogue, la répétition de scènes cultes, le visuel d’un clip… Rares aujourd’hui sont les albums à ne pas contenir au moins un échantillon de cinéma, peu importe sa forme. Et si ces références tiennent la plupart du temps du simple clin d’œil ou du bon mot (ou, parfois, du running gag), certains artistes ont pris le temps de décortiquer et de comprendre les œuvres qu’ils citent, d’en tirer la substantifique moelle pour soit les intégrer à leur univers, soit se fondre entièrement dans le leur. Généralement, cet exercice est réalisé à l’échelle d’un visuel qui annonce l’ambiance, d’un morceau thématique ou d’un clip plus chiadé que les autres. Mais il arrive que des albums entiers soient pensés et construits autour d’une référence cinématographique en particulier, travaillée pour donner au projet une certaine ambiance, une épaisseur visuelle, une autre dimension. Ce sont ces derniers que cet article, inscrit dans une série intitulée le contre-champ, va s’échiner à analyser. Cas d’école pour ce premier volet, avec l’album Liquid Swords de GZA et le film Shogun Assassin de Robert Houston.

Le film : Shogun Assassin (Robert Houston, USA-Japon, 1980)
Au départ il y a Lone Wolf and Cub, un manga écrit par Kazuo Koike et dessiné par Goseki Kojima, publié en 28 volumes entre septembre 1970 et avril 1976. Ce seinen raconte l’histoire d’un samouraï qui, trahi par le clan Yagyū qui convoite son poste privilégié de bourreau du Shogun (un terme signifiant « général » et désignant le plus souvent le dirigeant du Japon), est contraint de s’enfuir avec son fils de trois ans et d’engager une vengeance sanglante. Prisé pour sa violence graphique, sa narration enlevée et sa peinture âpre sans concession de l’ère Edo, le succès est retentissant et conduit rapidement à la mise en chantier d’une adaptation cinématographique. En 1972, Baby Cart : Le Sabre de la vengeance sort sur les écrans. Dirigé par Kenji Misumi (déjà connu pour avoir livré quelques-uns des meilleurs films de la saga Zatoichi, autre série B culte de samouraïs), ce premier volet impressionne par sa mise en scène expérimentale, entre le baroque des planches de manga et le classicisme des films de sabre de Kurosawa. Avec ses couleurs vibrantes, son montage hypnotique et ses plans pittoresques (une décapitation sauvage sur fond de soleil couchant, notamment, reste en mémoire), le film est un véritable enchantement macabre. Toujours en 1972, Kenji Misumi pousse le curseur encore plus loin dans Baby Cart : L’Enfant massacre qui multiplie les morts loufoques et les plans gores à base de geysers de sang, d’amputations et autres visages découpés dans la largeur. Au total, il réalisera quatre des six longs-métrages adaptés du manga Lone Wolf and Cub. La saga, que vient clôturer en 1974 le délirant Baby Cart : Le Paradis blanc de l’enfer et son body count à 3 chiffres, se révélera particulièrement influente jusqu’à l’international.
Évidemment, qui dit succès à l’étranger dit adaptation pour le marché américain, et les films de samouraïs ne dérogent pas à la règle. Ainsi Shogun Assassin voit le jour en 1980. Produit par David Weisman, distribué par Roger Corman (une légende de la série B qui a mis le pied à l’étrier de la quasi-totalité des actrices, acteurs et réalisateurs les plus influent.e.s du nouvel Hollywood) et réalisé par Robert Houston, Shogun Assassin est un remontage des deux premiers opus de Kenji Misumi, affublé d’un doublage anglais et d’une nouvelle bande originale. On y retrouve donc Ogami Itto, son landau de bois et son fils de trois ans, Daigorō, forcés de s’engager sur le chemin de la vengeance (« the Demon Way in Hell » tel qu’il est appelé dans le film) après la trahison du clan Yagyū et le meurtre de leur femme et mère. Le premier volet, dont seulement douze minutes sont réutilisées, sert de pitch tandis que le second volet constitue la structure principale de ce montage américain. Plus encore que dans la version japonaise, la construction du film rappelle que l’histoire est prétexte à un enchainement de scènes d’actions toutes plus violentes les unes que les autres. À la manière d’un jeu vidéo, des opposants de plus en plus forts défilent sur les routes empruntées par Itto et se font charcuter jusqu’à l’apparition du boss de fin, les Masters of Death, synonyme de combat épique.
Bien sûr, pour qui a vu la saga japonaise originale, Shogun Assassin tient plus de la curiosité qu’autre chose. Le doublage anglais est aussi soigné que kitsch, la narration resserrée ne sert pas l’intrigue et les considérations introspectives du personnage d’Itto, en pleine lutte intérieure avec les codes du Bushido, sont largement éludées. Le film est néanmoins d’une efficacité à toute épreuve et traite le matériau de base avec respect, n’hésitant pas à conserver les innovations formelles de Misumi au niveau de l’image, du son et du montage. En cela il constitue pour le public occidental une excellente porte d’entrée dans le genre série B de samouraï. Et surtout, difficile de nier son influence sur le cinéma de genre et la culture populaire – dont la saga s’est elle-même largement nourrie par ailleurs, empruntant régulièrement aux westerns de Leone ou aux films de la Shaw Brothers. Ainsi John Carpenter fera un clin d’œil aux trois Masters of Death dans Les aventures de Jack Burton dans les griffes du Mandarin. Quentin Tarantino reprendra de nombreux motifs du film dans Kill Bill (le sang projeté de la lame de l’épée sur le sol, le poing qui vient cogner le manche du sabre, les amputations et autres geysers de sang…), allant jusqu’à le faire visionner à ses personnages. Enfin, Shogun Assassin sera donc l’épine dorsale de Liquid Swords, le chef-d’œuvre de GZA.
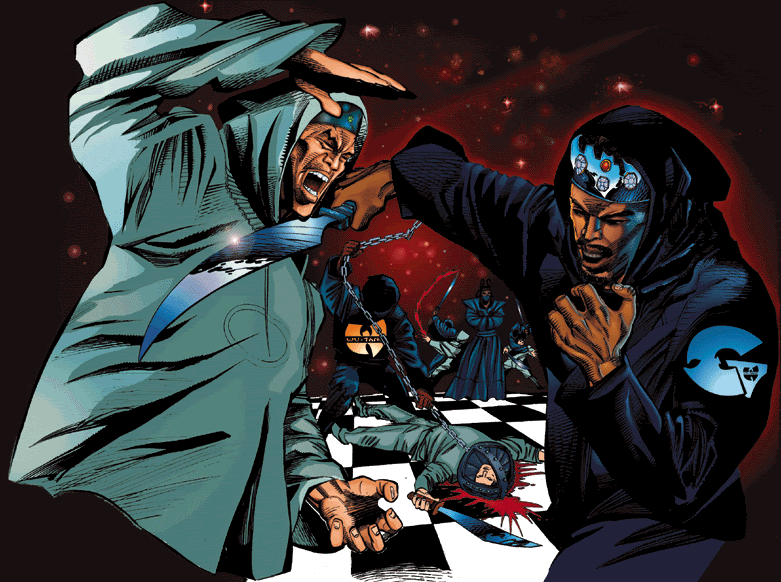
L’album : Liquid Swords (The Genius/GZA, 1995)
Produit d’une main de maitre par RZA, le grand manitou du Wu-Tang Clan (qui, surprise, réalisera plus tard la bande originale de Kill Bill), Liquid Swords est le second album de GZA sorti le 7 novembre 1995. Parmi les grands classiques parus dans la foulée du séminal Enter the Wu-Tang (36 Chambers), Liquid Swords est sans doute le disque le plus fondamentalement Wu. C’est à dire celui qui s’ancre le plus dans la tradition du groupe : arts martiaux, mysticisme, références cinématographiques, violence graphique, jeu d’échecs et commentaire social. Tical est l’album d’un fumeur invétéré ; OB4CL est l’album d’un parrain de la drogue, Ironman est l’album d’un soul crooner et Return to the 36 Chambers, malgré son titre, est l’album d’une rockstar. Liquid Swords, lui, est bien l’album d’un samouraï avec ses combats sanglants, ses auto-réflexions philosophiques et son regard acéré sur le monde environnant régi par une lutte des classes sans merci. Ces caractéristiques, qui sont aussi celles de beaucoup des grands films de sabre des années 60 et 70 (voir Sanjuro, Les Trois Samouraïs hors-la-loi ou encore les films de la saga Zatoichi), se retrouvent en filigrane tout au long des morceaux. « Duel of the Iron Mic », « Cold World », « Swordsman », « Living in the World Today », « Investigative Reports » : les titres parlent d’eux-mêmes, et pourraient tout à fait servir à nommer les chapitres des films de la saga Lone Wolf and Cub.
Il est difficile d’imaginer à quoi aurait ressemblé Liquid Swords sans Shogun Assassin. La production soul, noircie à la suie par RZA et l’écriture à la fois imagée, abyssale et brillamment interprétée de GZA suffiraient sans doute à assurer son statut de chef-d’œuvre. Mais le film de Robert Houston, omniprésent, l’emmène dans une autre dimension. C’est RZA qui eut l’idée, à la fin de l’enregistrement, d’utiliser Shogun Assassin comme une colonne vertébrale qui viendrait soutenir sa partition. Agissant comme un fil d’ariane dont on suit les saillies sinueuses de piste en piste, il confère à l’album une ambiance délétère unique en son genre. Choix intéressant, RZA ouvre le disque comme s’ouvre le film, traduisant une véritable ambition narrative qui participera largement à rendre les deux œuvres indissociables (et effectivement, il n’est pas aisé aujourd’hui de regarder Shogun Assassin sans penser à Liquid Swords, et vice-versa). Les différents extraits de dialogue qui suivront l’introduction, insérés de façon quasi-chronologique, vont dans ce sens et installent comme une intrigue parallèle : c’est bien l’impression d’écouter un conte étrange, cruel et sanglant, qui ressort de Liquid Swords.

Les samples « He cut off the heads of a hundred and thirty-one lords »
« When I was little, my father was famous. He was the greatest samurai in the Empire, and he was the Shogun’s decapitator…1 ». Une minute et vingt secondes. C’est une éternité, et le temps que dure l’introduction de Liquid Swords. Accompagnés de l’angoissant thème de W. Michael Lewis et Mark Lewis, « Legend of Lone Wolf », les mots de Daigorō, prononcés lentement – presque chuchotés – font tomber une chape de fumée épaisse et noire sur le premier morceau éponyme de l’album. Le ton est donné pour les douze titres à suivre, et les premières lignes parallèles se tracent entre le rappeur GZA et le samouraï Itto. Comme le personnage joué par Tomisaburō Wakayama, père et meurtrier sanguinaire trompé par ses pairs véreux, The Genius est à la fois un assassin sans pitié de wack MCs et un éveilleur de consciences (« I be the body dropper, the heartbeat stopper / Child educator plus head amputator »). Le parallèle est scellé par un nouvel extrait qui introduit le seconde piste, « Duel of the Iron Mic » : « Oh mad one, we see your trap. You can never escape your fate. Submit with honor to a duel with my son2 ». Comme Itto, GZA s’est engagé sur une voie tortueuse dont il ne peut s’écarter, mais qu’il compte parcourir avec panache.
Cette voie tortueuse, c’est une vie dure qui prend ses racines dans les ghettos des États-Unis, avec leurs trafics de drogue, leurs guerres des gangs et leurs morts violentes. Car si Liquid Swords baigne effectivement dans l’ambiance féroce et belliqueuse du japon militaire féodal de l’ère Edo, ce n’est que pour mieux retranscrire la réalité contemporaine des tours de Brooklyn telle qu’elle est décrite dans les lyrics de GZA. « Cold World » et son story-telling construit comme une spirale infernale de violence, est par exemple introduit par un autre sample de Shogun Assassin, cette fois-ci moins guerrier que philosophique : « I had a bad dream / Don’t be afraid, bad dreams are only dreams / What a time you chose to be born in3 ». Cette brusque incursion du réel, opérée par la voie cinématographique, tend à valider l’hypothèse d’une comparaison filée entre deux mondes qui se confondent par leur fureur et leur animosité, malgré les siècles et les kilomètres qui les séparent. Mais c’est encore l’extrait introduisant « 4th Chamber » (et sans doute le plus beau passage du film) qui demeure l’illustration la plus symbolique de ce parallèle. Un sabre dans la main gauche et un ballon dans la main droite, Itto demande à son jeune fils de choisir entre la vie à ses côtés (le sabre, symbole de la vengeance à mener) ou la mort aux côtés de sa mère (le ballon, symbole du jeu et donc de mort par le refus de la violence). « Choose the sword, and you will join me. Choose the ball, and you will join your mother in death. You don’t undertstand my words, but you must choose. So… Come boy. Choose life or death4 ». La scène est terrible, et l’écho qu’elle renvoi dans l’album l’est encore plus. Le choix du petit Daigorō – la vie par le sabre – est celui de toute une jeunesse désœuvrée, contrainte de mener une existence violente si elle veut pouvoir, in fine, simplement exister.
Avec son ambiance martiale, ses samples de baston à la pelle et l’émulation constante entre ses neuf membres, Enter the Wu-Tang (36 Chambers) tenait de la pure démonstration technique. Liquid Swords, tout inscrit dans cette veine orientale et guerrière, relève davantage d’une atmosphère ouatée et son approche est plus philosophique que militaire. En choisissant de structurer son album autour un chanbara (film de sabre) japonais plutôt que de réutiliser des films de kung-fu hongkongais (deux seulement sont brièvement cités : Dragon on Fire sur « Duel of the Iron Mic » et Shaolin vs Lama sur « Shadowboxin’ »), RZA modifie subtilement la portée du son Wu. Plus brutal, plus compact mais moins dans l’esbroufe. C’est autant une manière de coller aux écrits denses et référencés de GZA que de rendre justice à son style tranchant et définitif. « Most of our influence came from kung-fu movies. Sometimes there’s a lot of swinging, a lot of blocking. But in Japanese samurai movies, it’s one stroke kills. Bing, stroke ! Bing, stroke ! When it came time to incorporate a film into the Wu-Tang world, I chose this film to represent the GZA. His lyrics are straight to the point5 » raconte-t-il dans une interview pour Vanity Fair. Le dernier sample de Shogun Assassin, qui ferme « I Gotcha Back » peut ainsi être vu comme un hommage aux textes et au flow de GZA. « Your technique… is… magnificent. When cut across the neck, a sound like wailing winter wind is heard, they say. I’d always hoped to cut someone like that someday, to hear that sound… But to have it happen to my own neck is… ridiculous6 ». Cette mise aux nues de l’efficience pure est effectivement l’apanage des films de samouraï, dans lesquels les combats sont autrement plus expéditifs que les interminables duels des films de kung-fu. Un exemple séminal serait le duel final du Sanjuro de Kurosawa, attendu durant tout le film et pourtant expédié en un seul mouvement parfait, exquis de force et de dextérité. À la fin du film le personnage joué par Toshiro Mifune, dégouté de toutes les tueries auxquelles il a pris part, tient ces mots emprunts de bonté : « La meilleure épée doit rester dans son fourreau ». Il n’a, bien sûr, pas écouté Liquid Swords.
1 « Quand j’étais petit, mon père était célèbre. C’était le plus grand samouraï de l’Empire. Et c’était le bourreau du Shogun… »
2 « Oh fou, nous voyons ton piège. Tu ne pourras pas échapper à ton destin. Soumets-toi avec honneur à un duel avec mon fils »
3 « J’ai fait un mauvais rêve / N’aie pas peur, les mauvais rêves ne sont que des rêves / Quelle époque tu as choisi pour naître »
4 « Choisis l’épée, et tu me rejoindras. Choisis la balle, et tu rejoindras ta mère dans la mort. Tu ne comprends pas mes mots, mais tu dois choisir. Alors… Viens mon garçon. Choisis la vie ou la mort »
5 « L’essentiel de notre influence est venu des films de kung-fu. Parfois il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de blocages. Mais dans les films de samouraïs japonais, un coup suffit pour tuer. Bam, un coup ! Bam, un coup ! Quand il a fallu intégrer un film dans l’univers du Wu-Tang, j’ai choisi ce film pour représenter GZA. Ses textes vont droit au but »
6 « Ta technique… est… magnifique. Quand on te coupe en travers du cou, on entend un bruit comme celui du vent d’hiver qui gémit, qu’ils disent. J’ai toujours espéré arriver à couper quelqu’un comme ça un jour, pour entendre ce bruit… Mais que ça arrive à mon propre cou c’est… ridicule »
Le producteur Joe Vitterbo s’est fait remarquer avec l’album instrumental Sometimes You have to stick with the old school ways, sorti en 2012. Un album autoproduit, bourré de samples et de scratches, et pour lequel il a tout fait lui-même, jusqu’à la pochette. C’était son premier disque à faire l’objet d’une distribution digne de ce nom, mais l’homme n’en était pas à son coup d’essai. Il avait déjà réalisé un premier mini-LP en 2004, 7 ½ tries, puis Blind, en 2006, composé « avec l’aide de la nuit, du silence, de l’urgence, et d’un matériel défectueux », qui a circulé sous le sceau de la clandestinité. Joe Vitterbo — pseudo trouvé dans un classique de la série B injustement méconnu — est d’ailleurs un artiste-artisan touche à tout, qui, comme en témoigne son site, fait non seulement de la musique et pas seulement avec des machines, mais aussi dessine, fait de la photo… et au milieu de tout ça, se fait la main sur des remixes de morceaux de rap américain tout en préparant tranquillement son prochain album.
Abcdr Du Son : Tu as déjà eu l’occasion d’expliquer dans une interview d’où venait ton pseudo… Peux-tu nous dire maintenant d’où vient le sample du morceau « Gotta Stick with the Worst » qui donne son titre à l’album ? D’ailleurs, as-tu hésité entre plusieurs titres pour cet album ou bien celui-ci s’est imposé tout de suite ?
Joe Vitterbo : C’est un emprunt à Jim Jarmush, un extrait de Ghost Dog pendant lequel Forest Whitaker explique à Isaac de Bankolé qu’en certaines circonstances, il faut savoir se référer aux voies de l’ancienne école… C’est un film que je revois régulièrement avec plaisir, pour son rythme, sa galerie de personnages, l’ambiguïté que laisse planer le scénario sur le bien-fondé de la dévotion du « samouraï » à son « maître », avec tout ce que ça peut symboliser… Et puis il y a cette B.O. de RZA que je trouve parfaite et qui achève de donner toutes leurs dimensions aux images.
Il n’y a aucune revendication derrière le choix de ce titre. Je n’ai pas cherché consciemment à aller à l’encontre des sons dominants aujourd’hui. Je ne me suis pas posé ces questions-là, j’ai fait avec ce que je savais, ce que j’avais et ce que j’aimais. J’ai simplement trouvé que cette phrase résumait plutôt bien la façon dont la couleur et le son de ce disque s’étaient en quelque sorte imposés à moi… Ce que je veux dire c’est que si j’ai suivi les « codes » de ce qu’on appelle aujourd’hui la « old school » c’est simplement parce que ce sont ceux avec lesquels j’ai grandi dans les années 1990, ceux que je connais. Je n’avais pas forcément conscience que ça sonnait « old school » avant que des potes ne finissent par me le faire constater…
Ensuite, à un niveau plus personnel, ce titre exprimait aussi mon envie d’en revenir à certains fondamentaux de mon rapport à la musique pour retrouver l’énergie, l’inspiration et le plaisir… Aller vers mes « old school ways », c’est-à-dire rallumer le sampler sans enjeux ni idées préconçues, c’était en quelque sorte me ressourcer.
A : Comment fais-tu pour choisir les titres de certains morceaux ? Dans certains cas ils sont tirés ou directement adaptés de samples vocaux, mais dans d’autres, ça paraît moins évident…
JV : Choisir des titres, c’est un exercice que j’ai toujours trouvé hyper-compliqué… J’ai essayé de faire preuve d’un peu d’imagination, en fonction de ce que le beat m’inspirait. Mais au final effectivement, je m’inspire assez souvent d’une phrase samplée ou scratchée, parfois du titre ou du nom du compositeur du morceau original dont j’ai tiré une boucle. Je fais en sorte que ça ait une petite signification, au moins pour moi… Sans non plus me torturer l’esprit là-dessus. Il ne faut pas forcément chercher très loin : « Groovy Harry » se base sur des samples de la B.O. composé par Lalo Schifrin pour Dirty Harry, « Teenie Weenie Groovy » est construit entre autres autour d’échantillons de Teenie Weenie Boppie, que Gainsbourg a écrit pour France Gall à la fin des années 1960. Il est vachement bien ce morceau, un truc hyper cuivré qui raconte l’histoire d’une gamine qui fait une overdose de LSD !
A : Comment as-tu déterminé l’ordre des pistes ? Quelle est la part du hasard là-dedans : est-ce que dans certains cas tu as hésité (ou pas)… ?
JV : J’ai voulu construire un voyage, avec l’idée de choper l’auditeur dès le début du disque pour le balader pendant quarante-cinq minutes. J’ai cherché à mettre en place des tableaux, en articulant mes titres les plus courts et mes jingles autour des prod’ un peu plus longues. Il y a eu quelques hésitations, j’ai fait plusieurs tests, il y a certains morceaux qui ont disparu du tracklisting… Mais à partir du moment où je me suis décidé sur les grandes lignes, il n’y a plus eu de hasard, le puzzle s’est complété assez logiquement. C’est une étape à laquelle j’ai fait gaffe, je n’avais pas envie que mon album soit une simple succession de singles, sans liens ni transitions entre eux. J’avais envie qu’on puisse le considérer comme un tout, avec un début, une fin, et un parcours entre les deux. C’est pour la même raison que j’ai essayé de soigner l’emballage de la version CD, en sérigraphiant moi-même mes pochettes. J’avais envie d’un objet cohérent. Je ne sais pas si j‘ai réussi…
A : Comment as-tu concrètement appris le turntablism ? Quelqu’un t’a mis le pied à l’étrier ou bien ça a été du pur do it yourself depuis le début ? Et avec tes machines ?
JV : Je me souviens que quand j’étais mioche, j’essayais de scratcher sur la platine de mes parents avec le 45 tours de Break Machine ! Plus sérieusement, j’ai eu l’occasion de pouvoir approcher ma première MK2 et mon premier sampleur vers 1993-1994 je pense, par le biais de potes musiciens qui s’essayaient à la production rap et électro. L’un d’eux tenait aussi les machines et les platines dans un groupe de fusion dans lequel j’étais bassiste. C’est lui qui m’a d’abord montré les rudiments du beatmaking, sur son Atari 1040STf et son sampler S2000, que j’ai d’ailleurs fini par lui racheter à la fin des 1990. J’ai bricolé mes deux premiers disques avec ça, en utilisant uniquement les 52 secondes de mémoire disponibles dans mon sampler. L’Atari, avec sa souris défectueuse et ses 16 pistes maximum, me servait de séquenceur et de contrôleur midi… Ça c’était old school !
J’utilise encore le S2000 aujourd’hui, mais j’ai fini il y a quelques années par accepter ce bond en avant technologique majeur à mon échelle, qui a consisté à m’équiper enfin d’un ordinateur convenable et d’une carte son ! Et c’est entre autres pour cette raison que Sometimes… est le premier album sur lequel je fais apparaître du scratch, parce que cette fois mon matériel me le permettait, tout simplement. Du coup, c’est en bossant ce disque que je me suis mis à travailler un peu plus sérieusement, même si j’ai une platine et une mixette depuis des années et que je me suis toujours plus ou moins régulièrement amusé dessus. J’ai une approche totalement do it yourself du turntablism et sincèrement, j’ai encore énormément de choses à apprendre. En l’occurrence, sur l’album, j’ai fait pas mal d’édition, pour nettoyer mes cuts et recaler mes amorces… J’assume, dans le sens où je ne recherche pas la technique à tout prix. Je ne concours pas pour les DMC, j’utilise le scratch comme un instrument, au service de la musique, en l’employant comme soliste, comme pourrait par exemple l’être une voix ou une guitare…
« Je ne recherche pas la technique à tout prix. J’utilise le scratch comme un instrument, au service de la musique. »
A : Peux-tu nous dire un mot de ton label « Young & Green Records » ?
JV : Young & Green est une entité tout ce qu’il y a de plus officieuse. C’est le nom générique que j’emploie pour labelliser les différentes choses que je peux faire, quand j’organise un concert, quand je fais de la sérigraphie ou quand je sors un disque… Il n’y a rien de plus et je ne sais pas si ça a vocation à s’officialiser un jour. Je le ferai si je constate que ça peut m’être utile, mais pour l’instant, c’est juste un nom qui circule, une entité de plus derrière laquelle j’aime bien me camoufler. Young & Green parce que nous serons toujours jeunes d’esprit malgré l’inéluctable grisonnement des tempes…
A : Où en es-tu de la préparation de ton prochain album ?
JV : J’ai accumulé pas mal d’idées et de bouts de prods ces deux dernières années, que je commence doucement à trier. A priori j’ai suffisamment de matière, mais je préfère prendre mon temps. Pour Sometimes…, j’étais volontairement dans une certaine urgence, je voulais voir des choses se concrétiser rapidement et j’évitais assez soigneusement de me poser des questions. C’est d’ailleurs l’approche que je continue à avoir avec mes remixes, que je produis et sors dans la foulée, avec un mix un peu cheap et sans rien masteriser.
Mais pour le prochain album, j’ai envie de me laisser le temps du recul et de laisser mûrir. Et je me pose encore des questions sur la forme que je veux lui donner. Est-ce que par exemple je repars sur un disque totalement instrumental ou est-ce que j’essaie de convaincre quelques rappeurs pour des feats ? Ou bien est-ce qu’il ne serait pas plus pertinent de sortir des maxis plutôt qu’un long format ? J’aimerais faire ça bien, démarcher des partenaires au moins pour assurer une distribution correcte. Mais ça impliquerait en contrepartie de pouvoir consacrer plus de temps et d’énergie à Vitterbo, pour la promo et pour monter un live. Ce qui n’est pas forcément évident, car mes autres projets sont eux aussi plutôt chronophages.
En tout cas j’ai des prods qui s’entassent et je recommence à ressentir le besoin de concrétiser et de finaliser quelque chose assez rapidement. Alors je vais essayer de donner quelques nouvelles au printemps 2015, au moins avec quelques titres et une distribution numérique via Young & Green, en attendant…
A : Discutons de quelques disques. Dis-moi ce qu’ils t’inspirent…

RZA Ghost Dog – The Way of the Samurai
Joe Vitterbo : Comme je te le disais tout à l’heure, je trouve que cette B.O. remplit magnifiquement son rôle. Déconnectée des images, elle perd une partie de son charme, mais elle reste évocatrice. J’aime le son, son côté boiteux, l’aspect très brut du montage global. J’adore le fait qu’on puisse avoir le sentiment que RZA a fait ça en un quart d’heure… C’est quelque chose qui me plaît et qui revient régulièrement quand j’écoute son travail, cette impression de spontanéité et d’ « instinctivité » dans la façon dont il construit un groove.

DJ Shadow Endtroducing
JV : Difficile de ne pas le considérer comme un classique. Il a un vrai son, ce disque ; une prod’ à la fois millimétrée et crade, avec ses accumulations de samples et le groove bancal des grosses loops de rythmiques et du scratch. Je n’aime pas tout, mais je continue à beaucoup apprécier l’esprit et l’atmosphère qui se dégage de l’ensemble. J’aurais adoré pouvoir accompagner Shadow dans le sous-sol de ce disquaire où il est interviewé pour Scratch ! Je n’ai pas vraiment suivi sa discographie après Endtroducing, en tout cas pas suffisamment pour avoir un avis… J’ai écouté Unkle, posé une oreille à The Outsider, mais sans plus. Pendant les années 2000, j’avoue que j’ai eu moins de curiosité pour toute cette scène trip-hop/électro, je me suis peu à peu lassé de l’évolution du son, devenu trop « propre » à mon goût et qui pour moi conduisait trop souvent à privilégier la notion de production au détriment de la composition, de l’énergie ou de l’émotion…

Wax Tailor Tales of the Forgotten Melodies
JV : C’est marrant, je ne me suis rendu compte qu’après coup que j’avais comme lui samplé l’intro du « Feeling Good » de Nina Simone, pour le titre « (F)ever » que j’ai sorti en 2013 sur la compil’ JFXbits #06 de Jarring Effects. J’avais complètement oublié ce beat de Wax Tailor… Comme je viens de te le dire, je suis passé à côté d’un certain nombre de choses dans les années 2000. Ça a été le cas pour cet album, que j’ai entendu partout mais que je n’ai finalement écouté que d’une oreille. Je le trouve bien foutu, mais ce n’est pas vraiment une référence pour moi. J’aime bien ses rythmiques, je suis moins fan du côté mélodique et, pour en revenir à ce que je disais à l’instant, c’est déjà un peu trop « propre » pour moi… On parlait du boulot de RZA pour la B.O. de Ghost Dog : ce sont des boucles et une rythmique, mais ça lui suffit à poser une ambiance, parce que c’est plein de matière, ça transpire, ça boîte un peu… J’aime ça. Quoiqu’il en soit, il faudrait sûrement que je prenne le temps de plus me pencher sur ce que fait Wax Tailor…

Beastie Boys Check your Head
JV : Je cite systématiquement ce disque comme une référence pour moi. Il est sorti en 1992, j’avais 16 ans, j’étais jeune musicien, et je pense qu’il a eu un impact assez déterminant sur mon rapport à la musique, voire au-delà. Je sais pas, il est peut-être juste arrivé au bon moment, c’est tout. Ce qui est sûr, c’est qu’avec cet album, les Beastie m’ont totalement décomplexé. Ils m’ont autorisé à ne plus me soucier des questions de styles ou de tribus musicales, moi qui avait une affiche des Béru sur le mur de ma piaule, qui jouait de la basse dans un groupe de rock alterno et qui écoutait Authentik et Le Futur que nous réserve-t-il ? en boucle… Et puis il y a tout dans cet album, des milliards d’idées, un son de groupe incroyable, qui leur permet de passer du jazz funky au punk hardcore avec une évidence, un naturel et une décontraction qui personnellement m’impressionnent. C’est un des rares groupes dont je crois avoir tous les albums, mais la période qui m’a le plus marqué reste cette trilogie Paul’s Boutique, Check Your Head et Ill Communication. À partir de Hello Nasty, j’ai continué à les suivre mais avec moins de ferveur, j’ai été un peu moins attentif. Il faut sans doute que je me replonge dedans, j’en suis resté à l’impression que sur la longueur les Beastie avaient un peu de mal à renouveler la recette. Mais c’est un groupe dont je respecte énormément le parcours. Et mine de rien, la mort de MCA m’a mis une tarte…

Dilated Peoples The Platform
JV : Je n’aime pas toute la discographie des Dilated mais celui-là aussi est un classique pour moi. Dans le sens où je crois qu’il renferme tout ce que j’aime dans le rap : les prod’ sont groovy, DJ Babu n’est pas relégué à l’arrière-plan, Evidence et Rakaa sont dans l’équilibre, le tracklisting est réussi, le tempo est le bon, l’esprit aussi… À la même époque, je suivais aussi ce que pouvait sortir un label comme Rawkus : Black Star, Pharoahe Monch, le Home Field Advantage de High & Mighty… Ça faisait du bien. Et ça reste des albums que j’écoute régulièrement.
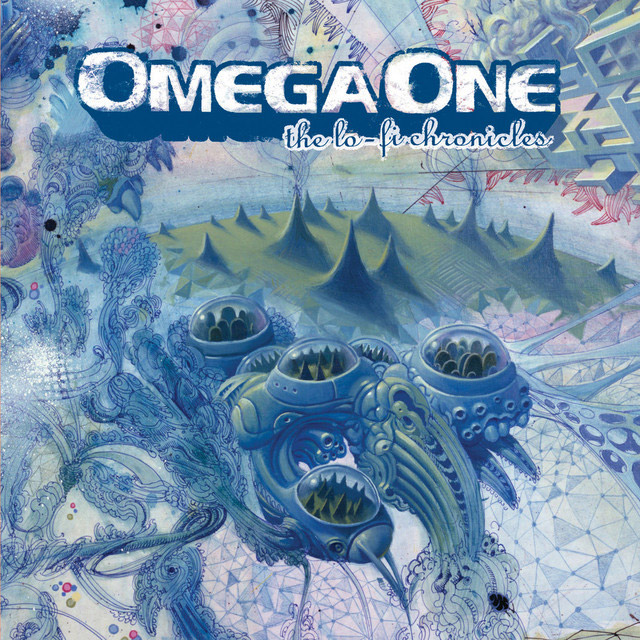
Omega One The Lo-Fi Chronicles
JV : Je ne connaissais pas cet album… J’ai réécouté pour l’occasion le morceau « Coma » qu’il a produit pour Aesop Rock, j’avais pas fait le rapprochement. Ce que j’ai entendu des Lo-Fi Chronicles sonne bien, mais je crois que je trouve les formats un peu longs. C’est pas évident sur des boucles hip-hop d’arriver à développer des idées sur plus de trois minutes sans justement finir par tourner un peu en rond… C’est un truc assez délicat, auquel j’ai fait attention pour Sometimes…, en essayant de ne pas étirer mes beats à outrance. J’en reviens à l’idée de voyage : j’ai cherché à faire en sorte que les paysages soient agréables mais évoluent suffisamment vite pour qu’on ne s’en lasse pas trop. C’est pour ça que j’ai beaucoup de morceaux qui ne dépassent pas les deux minutes trente.
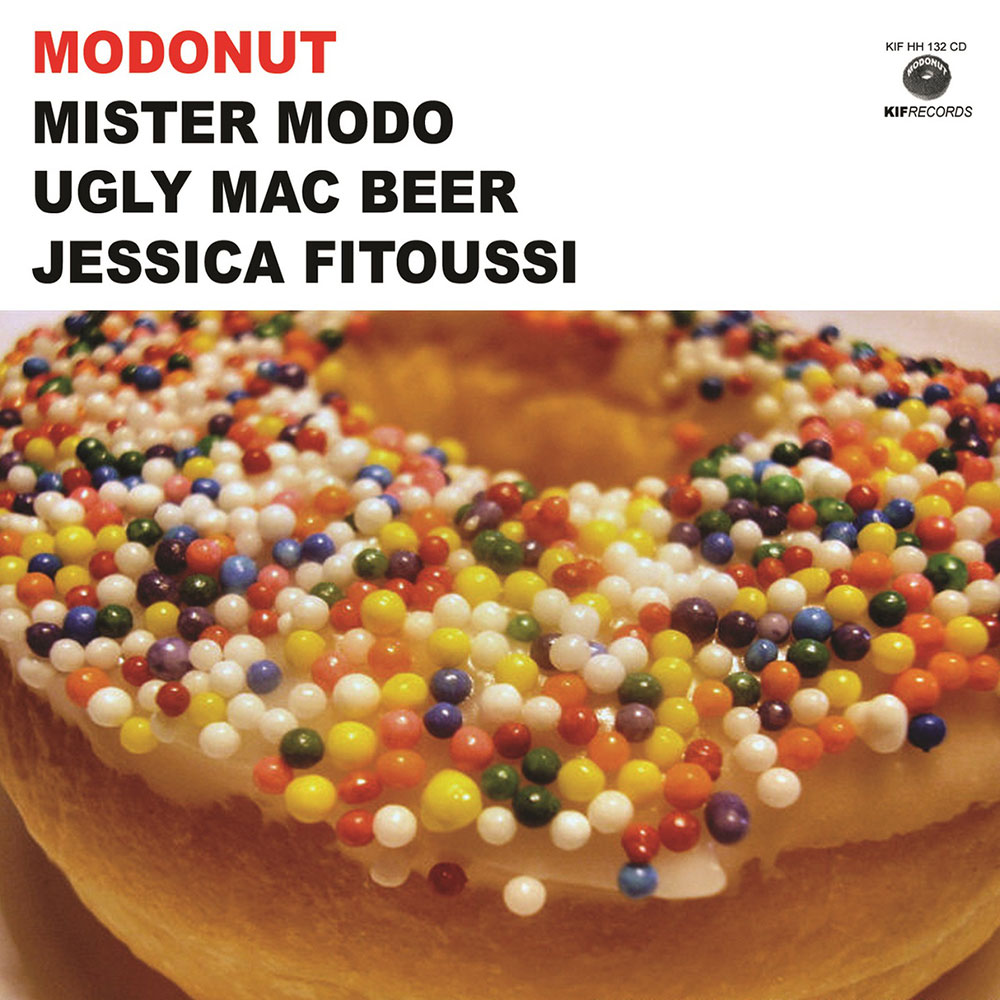
Mister Modo & Ugly Mac Beer Modonut
JV : J’apprécie l’état d’esprit qui se dégage de leurs prod’ et leur façon de bosser, le fait qu’ils revendiquent le diggin’ et l’usage du sample, les scratches, l’humour… La série des Modonut me fait un peu penser à ce que sortait un label comme MoWax, puisqu’on parlait de DJ Shadow. Ou à Kid Koala ou Scruff, sur Ninja Tune… Ceci dit, j’ai tendance à préférer leurs titres typiquement hip-hop, comme « Diggin’ in the crates » [sur Modonut 2] ou certaines ambiances de l’album Remi Domost. [EP sorti en 2010 et invitant notamment Mike Ladd sur un titre – NDLR.]

Suprême NTM Authentik
JV : Je me rends compte que ça fait une éternité que je ne l’ai pas écouté, mais à l’époque, comme je te le disais, la K7 a tourné en boucle dans le poste ! La première fois que j’ai entendu NTM, c’est sur Rapattitude, en 1990. Pour moi qui depuis ma province vivait l’essoufflement du rock alternatif, des groupes comme eux ou Assassin ont représenté la relève en débarquant à l’aube des 1990. Dans l’énergie, l’aspect revendicatif des propos, un certain côté do it yourself et hardcore… Et même dans le son finalement, il y avait beaucoup de similitudes avec ce qui pouvait m’attirer gamin dans le rock alterno. Mais c’est incontestablement Paris Sous Les Bombes qui restera pour moi leur album de référence. Je les ai vu plusieurs fois en live sur cette tournée en 1995, c’était quand même un duo de frontmen ahurissant.

Cypress Hill Black Sunday
JV : Entre le flow de B-Real et les prod’ de Muggs, on a l’impression d’être dans Freaks et de se balader la nuit dans les allées du cirque… C’est tout autant malsain et lourd que frais et entraînant. J’étais assez fan de DJ Muggs dans ces années-là, 1992-1994 en gros, entre ce qu’il faisait avec Cypress Hill et House Of Pain. Des morceaux parfaits pour que des rockers se pètent la nuque. Par contre, ça peut paraître paradoxal puisque je viens aussi du rock et de la fusion, mais je n’ai pas du tout accroché à Skull & Bones. Je respecte la démarche, simplement je n’ai pas trouvé ça réussi. Je suis pas sûr que ça vieillisse mieux que Body Count [groupe de métal fondé par Ice-T au moment de l’album Original Gangster – NDLR]. En fait j’ai arrêté d’écouter Cypress Hill après Temples Of Boom et le EP Unreleased and Revamped. Il faudrait que je réécoute IV et ce qu’ils ont fait depuis…

John Coltrane A Love Supreme
JV : Mon album de jazz préféré ? Je vais te dire A Love Supreme de Coltrane en quartet, je ne serais certainement pas le seul. Ça n’a pas directement à voir avec son aspect spirituel et mystique, mais c’est un album qui m’enveloppe par son intensité, l’émotion et l’énergie qui se dégagent de l’harmonie entre les musiciens. Et puis, même si j’en entendais gamin chez mes parents, c’est un peu ce disque qui m’a servi d’introduction au jazz. Et quand je l’ai écouté pour la première fois, au début des années 90, c’était avec un pote qui y cherchait d’éventuels samples. Finalement, c’est cet usage du sampler qui m’a ouvert à la musique, dans son sens assez global, en m’obligeant en quelque sorte à une certaine curiosité…
« I am the one and only Method Man, the master of the plan. »
Quand débute en 1993 l’épopée Shaolin et que le clan Wu–Tang débarque tout droit de la 36ème chambre, ses membres sont au nombre de neuf. De ce formidable essaim, une figure se démarque. Non pas qu’elle soit la seule car toutes, au détour d’une rime, d’un couplet ou d’un refrain passés à la postérité, auront déjà l’occasion de s’affirmer en tant qu’entité à part entière. Mais sur l’échiquier du Wu que déploie le roi RZA, Method Man est le seul fou à se voir offrir de poser sur un morceau avec son propre nom affiché sur l’étendard. Pièce de choix parmi les douze grands moments qui composent Enter the Wu, « Method Man » est autant un hymne à la débauche enfumée qu’une déclaration de guerre. Et le premier mouvement tactique de Prince Rakeem dans son plan de conquête du monde.
Le deuxième s’amorce dès l’année suivante. Poursuite logique des évènements, Method Man est le premier membre du groupe à sortir son album. En bonne tête pensante, RZA s’est alors débrouillé pour obtenir de Loud/RCA Records – label du groupe à l’époque – la possibilité de sortir chaque projet solo à venir librement chez d’autres maisons de disques, et garder la mainmise sur chacun d’eux. C’est ainsi que Tical, entièrement produit par RZA et paru chez Def Jam, ouvre en novembre 1994 la marche d’une première série de solos que fermera Ghostface avec la sortie d’Ironman en 1996.
Dans ce premier trauma post-36e chambre, il ne sera jamais question de dévier du chemin déjà tracé, mais plutôt de s’y enfoncer encapuché jusqu’aux yeux, les godasses pleines de boue sous la pleine lune et une pluie battante. Dans la crasse ambiante, les tâches de propre sont difficilement décelables. C’est à peine si l’on distinguera le sincère hommage à la gente féminine qu’est « All I Need » ou le chant entrainant de Blue Raspberry sur le tubesque « Release Yo’ Delf », seuls éléments qui tranchent avec la rudesse globale et la tradition killa bees dans laquelle s’inscrit Tical. Car si les préoccupations de Method Man – en premier plan la fumette et dérouiller du MC – sont omniprésentes, si sa voix rauque et son charisme éclaboussent l’album, l’univers du Wu-Tang y est aussi largement approfondi. Références multiples au premier opus du groupe, extraits cinématographiques kung-fuesques à foison et invités de marque se croisent pour frapper Tical du sceau de la chauve-souris. Exemple parfait avec « Meth vs Chef », sur lequel Raekwon vient donner la réplique à Johnny Blaze pour une joute verbale en forme de match de boxe particulièrement jouissive.
D’egotrips parfumés aux vapeurs d’herbes en chroniques urbaines d’un quotidien violent au pied des projects de Staten Island, les sommets s’enchainent sans possibilité de respirer autre chose qu’un air à la couleur verdâtre, pollué par toutes sortes de substances toxiques naturelles et industrielles. À tel point que la démence pointera à plusieurs reprises le bout de son nez, notamment le temps du supra-classique « Bring the Pain » et de son refrain imparable, d’un « Sub Crazy » aveuglément brutal ou du terrifiant « Mr. Sandman ». Posse-cut dans le pur style de l’école Wu-Tang, c’est un autre des points culminants de l’album, qui évoque volontiers une ruche d’abeilles tueuses malencontreusement bousculée d’où sortent, entre autres affiliés au clan, un Inspectah Deck à la verve affolante et un RZA littéralement possédé. Dans ces moments hallucinés, Tical fait immanquablement penser à Candyman, film horrifique paru en 1992, dont on est alors en droit de se demander s’il n’a pas eu une influence directe. Le métrage, qui en appelle aux légendes urbaines des ghettos et baigne dans un climat glauque proprement irréel, met en scène un boogeyman mystique des cités, armé d’un crochet de boucher et dont le corps est (dé)composé…d’abeilles !
« Dès le titre éponyme au beat ronflant et aux nappes stridentes, RZA plonge l’album dans une noirceur qui ne le quittera jamais. »
On disait le Rzarector possédé lors de son couplet sur « Mr. Sandman », il l’était tout autant au moment de produire l’intégralité de la mixture sonore de Tical. Dès le titre éponyme au beat ronflant et aux nappes stridentes sorties tout droit des enfers, il plonge l’album dans une noirceur qui ne le quittera jamais. Méconnaissables, les samples soul dont il est tant friand sont transformés en autant de ballades funèbres et brumeuses. Parfois terriblement oppressantes (« What the Blood Clot »), parfois empruntes d’un surréalisme éthéré (« Stimulation »), les ambiances s’entremêlent pour donner naissance à une atmosphère délétère unique, parsemée de cris d’outre-tombe et d’inspirations de fumées illicites, à pleins poumons forcément. Depuis l’inquiétante composition de « Bring the Pain » jusqu’au déchainement martial de « P.L.O. Style » en passant par le son crade et distordu de « Sub Crazy », RZA livre sans doute là l’œuvre la plus sale et lugubre de sa discographie.
Premier jet en solitaire – on l’a dit – de la maison de Shaolin, l’album n’aura cependant pas la résonance et la pérennité de projets aussi définitifs que Liquid Swords ou Only Built 4 Cuban Linx… Certes, Method Man est l’une des personnalités les plus en vue du groupe, comme le montrent rapidement ses excellentes collaborations extérieures (notamment avec la dualité sacrée Tupac et Biggie Small). C’est un monstre de charisme, une voix éraillée qui hypnotise comme peu et un beau bordel en prévision chaque fois qu’il attrape un micro. Mais il n’a pas l’habileté de Raekwon pour raconter des histoires, ni la densité d’écriture de GZA. Il n’a pas non plus la folie furieuse d’Ol’ Dirty Bastard, ni la versatilité de Ghostface Killah. Ainsi Tical se réclame d’une substance différente, plus vaporeuse même si bel et bien consistante. Un disque à part dans la mythologie dont il fait partie, au pouvoir de fascination aussi puissant que celui qu’aurait une plantation de 36 hectares de weed en face de son auteur. Pour beaucoup pourtant, il restera le plus faible de cette première fournée solo. C’est dire comme l’armée du Wu allait fumer la planète les deux années suivantes.
« Wu-Tang Clan forever, no we don’t die, we just multiply forever, and ever, and ever… »
La légende raconte que RZA s’était donné cinq ans pour amener le Wu-Tang Clan au sommet. C’était en 1992, à la sortie du maxi Protect Ya Neck. Un an plus tard sortait le classique Enter The Wu-Tang (36 Chambers). Et en 1997, la prophétie se réalisait : Wu-Tang Forever, le deuxième album du groupe, s’écoulait à 4 millions d’exemplaires, le point d’orgue de cinq années de conquêtes.
RZA voyait-il encore plus loin ? Récemment, le cerveau du Wu confiait avoir assuré son équipe qu’ils pourraient même viser la pérennité sur vingt ans. Mythologie de circonstance ou réalité ? Toujours est-il que nous sommes en 2013, Enter The Wu-Tang aura 20 ans demain, et le Wu-Tang est partout. Ou en tout cas, une certaine idée du Wu-Tang. 2013 a été l’année des clins d’œil au folklore shaolin, comme si le symbole Wu-Tang avait progressivement infusé dans l’inconscient collectif du rap et de la pop culture. Le groupe peut bien péricliter, son ombre n’a jamais été aussi nette. La preuve.
RZA dans Pacific Rim
Pacific Rim a l’ADN d’un film Wu-Tang. De la même façon que le Wu téléscope les folklores (rap, kung-fu, mafia…), le cinéaste Guillermo Del Toro a célébré dans ce gros blockbuster deux obsessions d’enfance : les films de monstres japonais et la culture du catch amateur au Mexique. La présence de RZA au générique est donc synchro avec son goût pour les assemblages d’influences et le cinéma de genre. Dans la grande lignée des superproductions-avec-un-morceau-de-rap-à-la-fin, le mentor du Wu rappe un couplet sur la chanson du générique, signée par une certaine Blake Perlman (accessoirement fille de Ron Perlman, acteur fétiche de Del Toro). Rien de bien mémorable, on vous l’accorde, mais cette apparition marque une continuité sympathique pour RZA : comme dans Ghost Dog ou Kill Bill, il semble créer un dialogue entre le Wu-Tang et Hollywood dans tous les films où il passe. — JB
Jay Z et RZA connectent (encore)

Question : parmi les nouveaux amis de Jay Z, qui a écouté Iron Flag ?
La relation entre Jay Z et le Wu-Tang a longtemps relevé de l’entente cordiale. Leur collaboration la plus concrète était restée la signature funeste d’ODB sur le label Roc-A-Fella en 2004, signature initiée par Damon Dash malgré les réticences de Jay Z. Tout arrive : depuis deux ans, la présence de RZA autour de Jay Z est plus apparente que jamais. Grâce à Kanye West, les deux s’étaient déjà croisés lors des sessions My Beautiful Dark Twisted Fantasy et Watch The Throne. Cette année, c’est un clin d’œil rare et explicite que Jay Z a adressé à RZA dans Magna Carta… Holy Grail. A croire que Shawn Carter écoutait Birth of a Prince en boucle avant d’entrer en studio, son premier couplet dans « Heaven » semble être tout droit sorti du bloc-notes de Robert Diggs : « Arm, leg, leg, arm, head – this is God body / Knowledge, wisdom, freedom, understanding, we just want our equality ». Le tout sur un instrumental plus Wu-Tang que le Wu, un sample-de-sample repris au producteur Adrian Younge, très influencé par RZA, qui a réalisé cette l’album Twelve Reasons to Die de Ghostface. « Heaven » fait donc office de mash up complétement improbable : Timbaland aux manettes, Justin Timberlake au refrain, Jay Z qui cite REM… et l’ombre tentaculaire du Wu-Tang sur chaque mesure. — JB
Les hommages de Drake
Depuis So Far Gone et ses hommages répétés à la scène texane en passant par sa déclaration d’amour faite à la Bay Area sur « The Motto », Drake s’est fait comme spécialité de rendre des hommages bien sentis à ses aînés. Nothing Was The Same, troisième album solo du Canadien, le voit lorgner du côté de Staten Island sur l’évident « Wu Tang Forever ». Plutôt romance que menace, le morceau est a priori à des kilomètres des légendaires productions rugueuses et désaccordées de RZA. C’est en fait au sample qu’il faut s’intéresser pour se rendre compte que Noah « 40 » Shebib, producteur du morceau et collaborateur privilégié de Drake, est allé piocher dans la dernière piste du premier CD issu du fameux double album du Wu-Tang, le bien nommé « Wu-Tang Forever ». Souvent jugé en comparaison d’Enter The Wu-Tang (36 chambers), Wu-Tang Forever est au groupe ce que It Was Written est à Nas. Et, à la manière de la deuxième galette de Nasir Jones, le disque est aujourd’hui en train de vivre une deuxième jeunesse. Tant mieux si Drake y est pour quelque chose. — Mehdi
The Man with the Iron Fists

Entre gros nanar et chef d’oeuvre.
Difficile d’avoir un avis franchement tranché sur The Man with the Iron fists, le premier long métrage réalisé par RZA. Accouché dans la douleur, il flirte parfois de près avec l’énorme nanar. Mais il faut prendre un peu de recul, le voir comme un hommage à ces films d’arts martiaux des années soixante-dix, aux sorties des Shaw Brothers et à cette esthétique hongkongaise régulièrement infusée dans la dynastie Wu-Tang Clan. Les personnages, les dialogues et la bande-son regorgent de clins d’œil plus ou moins explicites à cet héritage. Voir et revoir RZA en forgeron vengeur, c’est aussi se reprendre en pleine gueule Bobby Digital, « Shame on a nigga » et les parallèles entre les échecs et le combat au sabre. Forcément, quand on a eu le cerveau bouffé par l’équipée Shaolin, ça ressuscite des souvenirs. On porte du coup un regard à part sur un film pas franchement original… et pourtant tout sauf anodin. — Nicobbl
Danny Brown et le fantôme d’ODB
« Ol’ Dirty Bastard est la plus grande rock star de ces vingt dernières années ». Abcdrduson, 2007.
« I’mma die like a rockstar ». Danny Brown, 2011.
Dans un syllogisme foireux, la conclusion pourrait être : « Donc Danny Brown est Ol’Dirty Bastard ». Un rapprochement avec Russell Jones qu’a pourtant fait Brown lui-même sur « ODB », titre perché et finalement écarté de Old pour cause de droits sur le sample. S’il y a un rappeur qui rappelle Dirt McGirt, c’est bien Danny Brown : grimaces, dégaine d’épave sur une plage de cachetons, regard hagard, dentition hasardeuse, description étrange de leurs orgies sexuelles. Macklemore et Drake ont retenu de l’esprit Wu-Tang la débrouille pour fonder un empire ; Danny Brown, d’ODB, la capacité d’injecter dans l’énergie du rap une grosse dose d’absurde. « But in the end I’m just a dirty old man, with a pill in my mouth and my dick in my hand ». Le sale vieux bâtard n’aurait pas mieux postillonné. — Raphaël
RZA et Earl : le père et le fils
Ils n’ont aucun lien de parenté. Pourtant, Earl pourrait être le rejeton de RZA. Au moins son Jon Snow : un bâtard mis à l’écart, loin de tous, et revenu pour mieux récupérer son dû. Même timbre de voix rauque, mêmes affinités pour la boucle crade et brute, même vision sombre et embrumée. Doris, le premier album du sale gosse revenu des îles Samoa sonne comme une confirmation. La confirmation du test de paternité. Et si seul « Molasses » rassemble physiquement le père et le fils (caché), Doris porte le sceau de Prince Rakeem, avec un empilement lugubre et bordélique. Doris, c’est un appartement dévoré par les cafards, éclairé avec une minuscule bougie. Une succursale du Tical de Method Man – entièrement produit par RZA – avec une porte défoncée qui mène vers la trente-septième chambre. — Nicobbl
RZA, citoyen d’honneur britannique
En musique, il y a les collaborations dispensables, les collaborations un peu forcées, les collaborations prévisibles. Et puis, parfois, il y a une collaboration inattendue mais évidente, comme un petit miracle. La rencontre James Blake / RZA appartient à cette catégorie. RZA joue ici à la perfection son rôle d’ambassadeur mondial du Wu, à la croisée des genres et des continents. Lui et Blake n’ont ni le même âge, ni le même parcours, mais ils partagent un point commun : celui de célébrer la soul en la réduisant à une expression brute. Avec son clavier désaccordé et ce sample vocal transformé en cri, « Take A Fall for Me » fait une synthèse du son Wu-Tang tout en restant parfaitement cohérent avec le style James Blake. Si Danny Boyle décidait de faire un remake british de Ghost Dog, il saurait qui appeler pour la bande originale. — JB
RZA et Kid Cudi chassent les abeilles

Kid Cudi, probablement après que RZA lui ait proposé un polo Wu Wear
Indicud, troisième album solo de Kid Cudi, était un disque inégal. Dévoré par son ambition, Cudi ne parvenait pas à aller au bout de ses objectifs et à porter sur ses seules épaules – il a produit la totalité du disque – un projet qui, par ailleurs, ne manquait pas de belles idées. Laisser la part belle à RZA sur « Beez » en était évidemment une. Comme ce que fera Drake (décidément) un peu plus tard avec Jay Z sur « Pound Cake », Kid Cudi laisse deux couplets entiers au fondateur du Wu et n’intervient que pour un bref refrain. RZA, lui, rappe comme s’il était encore Prince Rakeem, avec la fougue et l’insolence d’un jeune rookie qui souhaite conquérir le monde et foutre la merde partout où il passe (« I does what the fuck I wanna do here, I splash that Gucci shit from the shirt to the shoewear »). Il est en tout cas rassurant de constater qu’entre deux projets audiovisuels, Robert Diggs prend le micro avec toujours autant de plaisir quand l’occasion se présente. Et qu’il n’hésite pas, à chaque fois, à brandir bien haut l’étendard du groupe new-yorkais. — Mehdi
Sur Revolutions per Minute et sa couverture écarlate, Talib Kweli la jouait visiblement révolutionnaire en herbe. Trois ans plus tard, il abat la carte de l’intello contrarié. Illustration : la première photo d’un livret soigné le montre seul, au musée, perplexe devant une œuvre d’art contemporain… Ah, c’est qu’il est tiraillé, le Talib. Tellement tiraillé que le jeu de mots du titre de son album est composé de forces contradictoires.
Le premier sens reprend un terme forgé en 1961 par le juriste anglais Peter Benenson, fondateur d’Amnesty International. Le disque, qui débute sur la fonction de porte-voix joué il y a peu par le rappeur pendant le mouvement Occupy Wall Street, se termine ainsi par un hommage aux prisonniers politiques. Hommage pas dénué de maladresse d’ailleurs : il est assez curieux d’entendre le perpète Mumia Abu-Jamal, trente ans de taule au compteur, gratifié d’un mignon « Whattup Mumia ? », surtout à la fin d’un morceau aussi ambigu que « Only Gets Better », qui pousse plus au fatalisme qu’à la révolte… En même temps, Talib Kweli est semble-t-il las de l’étiquette de rappeur « conscient » qui lui colle à la peau. C’est le deuxième sens, individuel, du titre. Cette étiquette, il aimerait s’en défaire et, pour ça, il ne lésine pas ici et là sur l’egotrip, avec des métaphores pas toujours heureuses (« I smoke these pork rappers so fast they call me charcuterie”, mmmh, comment dire…). Fils d’intellectuels qui en a marre de passer pour un intellectuel, la moitié de Black Star n’arrête donc pas de naviguer entre deux eaux. D’un côté, elle continue de truffer ses textes de commentaires politico-sociaux, d’inciter à la conscientisation (« Prisoner of conscious / Nonsense / Opposite of conscious is asleep« ), de consacrer des morceaux à, par exemple, la condition féminine, au risque d’en faire un peu trop (l’enchaînement du mièvre « Delicate Flowers », assez raté, après le plus malin « Hamster Wheel », guidé par une ligne de basse tendue et qui bénéficie d’instruments à cordes joués). De l’autre, comme pour compenser, elle en met plusieurs couches pour mettre le holà (« But music is emotion / That is lost to the intellectuals »).
La musique, parlons-en. Tout avait bien commencé avec l’enjoué « High Life », single parfait et temps fort de l’album. Album qui lui-même commence bien avec, dans la foulée de l’intro, le pugnace « Human Mic » et ses grands renforts de cordes. À la première écoute pourtant, Prisoner of Conscious dégage une impression d’ « attrape-tout » assez déplaisante. On y trouve une reprise en forme de clin d’œil à « Paid in Full » (« Turnt Up ») et des dédicaces à Raekwon, Q-Tip, Rakim, KRS One et Ice Cube (l’incisif « Hold It Now ») pour les vieux de la vieille. Une production signée Harry Fraud (« Upper Echelon ») pour se mettre au goût du jour. Des invitations qui piochent à la fois chez des vétérans incontournables de l’exercice (Busta Rhymes), des stars du moment (Kendrick Lamar et Curren$y) dont les voix ont été enregistrées à New York quand celle de Talib Kweli l’a été à Los Angeles (ça c’est de la collaboration de proximité…) et des présences plus improbables, qui vont du chanteur brésilien Seu Jorge à Nelly – sur un « Before He Walked » pourvu d’une ambiance prenante mais gâché par le coup régulier d’une snare en carton-pâte – en passant par Miguel et ses miaulements sur le très peu jouissif « Come Here » (Marvin, reviens!). Tout ça donne la désagréable impression que le MC en donne pour tous les goûts pour mieux appâter différents publics.
Plusieurs écoutes invitent ensuite à plus d’indulgence. D’abord parce que le revers de la médaille, c’est le risque de ne pas plaire à tout le monde. En ce sens, l’album est trop éclectique pour être vraiment consensuel. Et puis, si le natif de Brooklyn n’avait pas tenté plusieurs styles, on lui aurait reproché de faire toujours la même chose… Ensuite parce que Talib Kweli rappe vraiment bien, certainement mieux qu’à ses débuts. Il sait mieux que jamais dompter son flow dans le registre rapide. Ça suffit à rehausser nettement des morceaux pas franchement enthousiasmants musicalement et/ou plombés par des refrains lourdingues, ainsi ses accélérations sur « Only Gets Better ». Et c’est lui seul qui rend supportable un « Upper Echelon » repoussant et qui tombe comme un cheveu sur la soupe tant il tranche avec le reste du disque ; l’essai aurait mieux trouvé sa place dans la mixtape faite avec Z-Trip qui anticipait ce disque, Attack the Block. Malheureusement, ça ne suffit pas toujours, comme sur le pénible « Ready Set Go », avec sa ligne de synthé moche et son envahissante chanteuse.
L’impression finale est alors inévitablement mitigée. Prisoner of Conscious est certes tout à fait convenable et Talib Kweli est loin d’être le rappeur sur lequel on a envie de taper. Mais si les couvertures de ses albums se suivent sans se ressembler, celui-ci souffre grosso modo des mêmes défauts que les précédents. Entaché de quelques fautes de goût ou simplement de greffes ratées (« Favela Love », bof…), il est aussi trop disparate pour convaincre, même s’il contient de bons voire de très bons moments. Il y a des disques qui, bien que très variés, donnent une impression d’unité ; Prisoner of Conscious n’est pas de ceux-là. Et on ne peut s’empêcher de penser que c’est quand il reste dans son registre de prédilection, accompagné par Oh No, que le new-yorkais est le plus efficace, ou quand il est poussé à se montrer affûté (l’instru de RZA et un Busta Rhymes tout schuss sur « Rocketships »). Talib Kweli aurait sans doute gagné à mieux faire le tri entre la mixtape Attack the Block et cet album pour que ce dernier se distingue davantage.
En voilà une surprise qu’elle est bonne ! On a beau associer le nom de Ghostface Killah à d’excellents souvenirs, le considérer comme l’un des meilleurs storytellers du genre, on ne va pas se mentir : on le croyait condamné à sortir des albums jamais complètement convaincants parce que trop inégaux, accrocheurs sur le moment mais à la durée de vie limitée. Et voilà que Twelve Reasons to Die vient démentir cette prédiction. Comme le remarque justement Anthony Fantano dans sa chronique vidéo, ce nouvel opus rappelle Fishscale : Ghostface y joue à peu près le même personnage de boss du crime. Mais alors que Fishscale n’était encore qu’une collection de morceaux, Twelve Reasons to Die propose un récit unitaire. Sur ce plan au moins, là où son prédécesseur avait plus ou moins échoué, celui-ci réussit… peut-être pas totalement, mais on n’en est vraiment pas loin.
Pourquoi ne paraît-il pas complètement abouti, cet album aussi théâtral (le rôle des chœurs à l’antique, qui plantent le décor d’emblée) que cinématographique, nourri de films d’horreur de série B, de westerns spaghetti et de thrillers mafieux (l’histoire est censée de dérouler dans l’Italie de la fin des années 1960), et qui est en plus le pendant d’un comic book à son image ? À la limite pas tellement à cause du manque de complexité de l’intrigue, histoire de vengeance entre gangsters assez banale même si elle est post-mortem et passe par une phase de « vinylification » des cendres de Tony Starks alias Ghostface Killah. C’est surtout que la narration n’est pas toujours très bien distribuée. Les douze plages ne correspondent pas exactement à autant d’actes ou de chapitres bien distincts, d’où des redondances. On regrette d’ailleurs que les transitions entre les morceaux ne soient pas plus travaillées : certaines coupures sont regrettables, comme entre la réverb’ de la voix de Cappadonna sur ’The Center of Attraction’ (« She’s a set up chick !« ) et le début de « Enemies All Around Me ». Des réserves qui n’empêchent pas Twelve Reasons to Die de valoir sérieusement le détour.
Ghostface, c’est le genre de gars qui a besoin d’être cadré, sinon il se disperse. Ce cadre c’est, d’un côté, RZA, concepteur, narrateur et producteur exécutif, accessoirement proche de Tarantino, seul réalisateur nommément cité dans l’album ; de l’autre le compositeur Adrian Younge, compositeur de bandes originales remarquées avec son groupe Venice Dawn. Ses compositions, dans lesquelles on peut sentir aussi bien l’influence de la Blaxploitation que celle d’Ennio Morricone, créent une ambiance propice au conte. Faisant la part belle au clavier et aux cordes, ornées d’arrangements aussi simples qu’efficaces (mention spéciale à l’entrée en scène de la cloche et des cuivres au milieu du deuxième couplet de l’excellent « The Rise of the Ghostface Killah » et aux scratches qui suivent, hommage direct à feu ODB), elles possèdent deux atouts. D’une part, elles jouent abondamment sur la panoramique – à écouter au casque pour en profiter pleinement ! De l’autre, elles créent des variations dans les morceaux pour accompagner la narration. Après une ouverture venteuse-pluvieuse, « The Center of Attraction », dans lequel Cappadonna essaie en vain d’avertir son patron aveuglé par l’amour que sa chère et tendre est en réalité une traîtresse au service de ses ennemis jurés, est ainsi fait de variations sonores qui traduisent le désaccord entre les interlocuteurs et les états d’âme du personnage principal.
Mais c’est peut-être le dernier morceau rappé, « The Sure Shot » et ses deux parties, qui constitue le sommet du disque. Dans ce morceau plus encore que dans d’autres, le protagoniste change son flow selon les couplets : d’abord véloce pour accompagner les emballements de la batterie, il l’adoucit ensuite pour se caler sur le ralentissement du tempo, avant de mettre dans sa voix une pointe de repentir dans le couplet final. Immédiatement brillant quand les BPM s’accélèrent (« Blood on the Cobblestones », « The Rise of the Ghostface Killah », « Murder Spree » qui passe en revue diverses façons de tuer ou de mourir), Dennis Coles paraît, à la première écoute, moins à l’aise sur d’autres passages, dont son premier couplet sur « Beware of the Stare ». Cependant, outre les changements de ton les plus nets comme sur le soliloque implorant du deuxième couplet de « Enemies All Around Me », les inflexions qu’il donne à sa voix et son phrasé se manifestent plus clairement à mesure des écoutes. Nombreux, les comparses invités sont aussi convaincants et complémentaires, les prestations de Killa Sin et du toujours précis Inspectah Deck étant particulièrement notables.
En définitive, alors que certains membres du Wu-Tang ont plus ou moins sombré, pendant d’autres n’ont jamais vraiment réussi à faire leur place malgré leurs qualités (Inspectah Deck, encore une fois), Ghostface, bien entouré pour ce dixième album studio officiel que la version d’Apollo Brown permet de redécouvrir sous un nouvel angle, frappe fort. Si la relative courte durée (moins de quarante minutes) de Twelve Reasons to Die est au premier abord un peu frustrante, elle sera en fait peut-être un facteur de longévité. “My plots are like movie scripts, they’re well planned.”
« The game of chess, is like a sword fight. You must think first, before you move »
C’est un évènement Hip-Hop pas tout à fait comme les autres qui se déroulait le samedi 19 Mai au Omega Boys Club de San Francisco, une maison de quartier fondée, il y a 20 ans pour lutter contre la violence et la drogue dans les communautés pauvres de la ville et afin d’aider les jeunes en difficulté à entrer à l’université.
En ce jour ensoleillé, alors que les murs de ce petit immeuble arborent les portraits des héros de la communauté Africaine-Américaine, on peut croiser dans les couloirs quelques grands noms de la scène Hip-Hop locale et même nationale, à qui se mêle une foule multicolore et multi génération regroupant jeunes enfants et adultes aux cheveux plus que grisonnants.
L’attention de la foule ne se dirige pourtant pas vers une scène d’où beats, rimes et scratches surgiraient, mais plutôt vers des tables, de simple tables aux reflets noirs et blancs, où se déroulent ce qui, pour le lecteur non averti, n’aurait pas sa place dans le milieu Hip-Hop: des parties d’échecs.
Ils sont nombreux à avoir répondu présent à l’appel d’Adisa Banjoko, un journaliste et écrivain de la Bay Area, co-fondateur de la Hip-Hop Chess Federation, une association ayant pour but de mettre en avant les relations profondes qui existent entre la philosophie et la stratégie des échecs, des arts martiaux, et la culture Hip-Hop.
Attablé, en pleine réflexion, on trouve le rappeur Paris, producteur dernièrement de Public Enemy et qui, fut un temps, planqué derrière un arbre dans les jardins de la Maison Blanche, arme à la main, s’apprêtait à flinguer George H. W. Bush – pour finalement lancer après les évènements du 11 septembre 2001 un Sonic Jihad, son dernier album en date.
Dans la même veine de ce Hip-Hop engagé, Boots Riley du groupe The Coup est présent, accompagné par son ancien partenaire de rime T-Kash, désormais signé sur Guerilla Funk, le label de Paris sur lequel il a sorti l’album Turf War Syndrome.
Pas loin c’est DJ Q-Bert, reconnu internationalement (et même inter-planétairement) comme l’un des plus grands DJs, inventeur et génie musical, qui se prête à des parties d’échecs rapides d’une minute, sa spécialité. Q-Bert figure emblématique de la culture Hip-Hop est un personnage humble et d’une modestie qui touche aussi son jeu d’échec. Car s’il prétend ne pouvoir jouer qu’avec les noirs (et donc laisser à son adversaire le soin de bouger le premier pion blanc), Q est un redoutable joueur.
Le réalisateur Kevin Epps, qui réalisa notamment le film Straight out of Hunters Point documentant la vie de Bay View – Hunters Point, l’un des quartiers les plus durs de San Francisco, est aussi présent caméra au poing quand il ne s’assoit pas à une table pour jouer.
Beaucoup d’enfants sont attablés, des jeunes joueurs et passionnés de l’échiquier, qui ont l’occasion de se confronter à des acteurs de la scène Hip-Hop locale ainsi qu’à différents pratiquants d’arts martiaux.
On y croise même Chris Brown, un jeune espoir de la magie de rue, dans la lignée de David Blaine, qui est devenu populaire sur Youtube et qui ce jour ne rate pas une occasion pour faire des tours de cartes ou faire léviter une pièce de monnaie.
Petite pause dans l’organisation de la journée, Orrin Hudson prend le micro pour présenter brièvement son travail qui consiste à promouvoir les échecs auprès des jeunes des ghettos. En jouant verbalement avec le public il invite son auditoire à se lancer dans le « game »… le « chess game » évidemment. Son travail, en plus d’utiliser les échecs comme outil de réflexion, de stratégie et d’analyse, met l’accent sur les besoins de bien s’habiller, parler et de faire don de soi pour que la vie donne quelque chose en retour.
Mais l’après-midi n’est qu’à peine entamée, et sont attendus deux prestigieux invités, dont le nom rime, dans l’esprit des initiés, avec les disciplines qu’il est question de rassembler aujourd’hui: Josh Waitzkin et The RZA aka « Bouloulou » Bobby Digital.
Rien n’a synthétisé le rap, les échecs et les arts martiaux autant que le Wu-Tang Clan. Le groupe mythique de Staten Island, fondé par RZA et son cousin GZA, émergea au début des années 90 avec Enter the Wu-Tang: 36th Chambers et prit l’industrie du disque par surprise. Chacun des neuf membres du Clan et ses affiliés furent signés sur des maisons de disques différentes, les mettant ainsi en compétition pour les voir finalement travailler ensemble lors de la sortie du deuxième album du crew.
La venue de RZA, qui habite désormais à Los Angeles où il peaufine le travail de productions du nouvel album de Wu-Tang 8 Diagrams, est le symbole de la puissance que représente l’association des échecs et des arts martiaux avec la culture Hip-Hop.

« La venue de RZA est le symbole de la puissance que représente l’association des échecs et des arts martiaux avec la culture Hip-Hop. »
Josh Waitzkin, quant à lui, est un personnage bien connu du monde des échecs et même au delà puisqu’il est Maître International d’Echec, double Champion du Monde de Tai Chi Chuan, et un pratiquant assidu de Ju Jitsu Bresilien. Il fut le sujet du film Searching for Bobby Fischer, retraçant ses débuts aux échecs en tant que jeune gamin jouant face aux petits arnaqueurs et champions d’échecs de rue de Washington Square Park à New York.
Josh est également l’auteur de méthodes d’échecs et il collabore au fameux jeux vidéo dont il est la voix: Chessmaster. Son dernier ouvrage qui vient de paraître est intitulé The Art of Learning, et met en avant son expérience dans la voie de l’apprentissage des échecs, des arts martiaux et de toute autre discipline de vie.
C’est un vrai débat philosophique animé par Adisa Banjoko qui s’instaure entre RZA, Josh, Q-Bert et DJ Kevvy Kev, un DJ vétéran de la Bay Area et aficionado des échecs.
« Grandissant en Amérique – commence RZA, il y avait peu d’histoires, qui m’étaient apprises au delà de 400 ans, tu vois ce que je veux dire, quand j’étais jeune. Parfois on me parlait de mythologie Grecque, ou bien des colons, des cow-boys et des Indiens. Quand j’ai découvert les arts martiaux, j’ai découvert les dynasties Tang, Song, plus de 1500 ans d’histoire et toutes les luttes remarquables par lesquelles ils sont passés, ça a ouvert mon esprit à un tout nouveau monde. Il y avait un film, Enter the 36 Chambers qui est le premier film que j’ai vu et qui m’a ramené comme ça dans le passé. Quand je l’ai vu, yo… Ca a comme changé toute ma philosophie de vie. A un moment dans ce film, les moines bouddhistes sont assis ensembles dans la chambre la plus élevée, et l’un d’entre eux dit: « Les 5 tons assourdissent les oreilles, les 5 couleurs aveuglent la vision » et il continue comme ça… J’ai donc commencé à acheter des livres sur le bouddhisme, le taoïsme et j’étudiais le christianisme et l’Islam à la même époque, et tout ça c’est traduit dans ma musique. Les 36 chambres c’est un cercle complet, cela ramène aux « Questions et réponses » [NDLR: Rédigées par Fard Muhammad, le fondateur de la Nation of Islam].
Interrogé sur ce qui l’a amené aux arts martiaux, Josh poursuit: « C’est drôle la citation qu’a faite RZA, ça vient du Tao Te King et c’est le Tao Te King qui m’a amené aux arts martiaux. Vers la fin de ma carrière de joueur d’échec, le film sur ma vie était sorti et m’avait mis beaucoup de pression, et j’ai fini par ne plus jouer par amour du jeu, mais pour satisfaire l’attente des gens. Découvrir le Tao, m’a permis de revenir sur ce qui était important dans ma vie, sur les fondamentaux pour me détacher de mon ego, ne plus être en compétition pour la victoire, mais pour l’amour et pour en apprendre plus sur moi-même. Je faisais alors beaucoup de méditation, de Tai Chi Chuan et j’ai commencé à explorer les similarités entre les échecs et les arts martiaux. Toutes mes idées liées aux échecs se traduisaient dans les arts martiaux. Les principes bouddhistes et taoïstes que j’avais étudiés se manifestaient dans le fluide des arts martiaux. C’était une période stupéfiante pour moi, car tous les murs s’effondraient. Les gens regardent le Hip-Hop, les échecs et les arts martiaux et pensent que ce sont des mondes à part. Dans mon cas les échecs et les arts martiaux, pour moi c’est la même chose« .
RZA ajoute alors un mot sur ses relations entre les échecs et les arts martiaux. « Un échiquier est composé de carreaux blancs et noirs et c’est le yin et le yang, l’échiquier est composé de 64 carreaux et c’est les 64 trigrammes du I-Ching, le livre des changements. C’est la méthode avec laquelle les taoïstes autrefois prédisaient le futur et ce qui se passe dans la vie. Si l’on regarde la biologie, une cellule humaine, elle se divise d’abord en deux puis elle se divise en 64 pour devenir une cellule humaine complète. Si on fait le rapprochement avec le Hip-Hop, en 1964, après que le frère Malcolm X ait été assassiné, il y avait un autre frère, Clarence 13X Murphy, que les frères appelèrent Father Allah (NDR: fondateur des Five Percents aussi appelé Nation of Gods and Earths), qui amena le savoir de la Nation of Islam dans la rue et l’enseigna aux jeunes, aux voyous, aux dealers, et ses enseignements sont pour ainsi dire devenus la fondation du Hip-Hop. Le vocabulaire qu’on utilise « Peace », « Word is Bond », etc. Et cela s’est passé en 1964. Donc 64 est la corrélation entre le Hip-Hop, les échecs et les arts martiaux. »
Kevvy Kev, interrogé pour conclure la discussion, signale que la chose la plus importante que les échecs lui aient appris est de rester ouvert, « Tu comprends rapidement qu’il faut être attentif à tout et que dès qu’il se passe quelque chose, il faut tout analyser à nouveau, un seul mouvement change l’échiquier entier« .
A RZA d’avoir le dernier mot, signalant qu’avec toutes ses tribulations quotidiennes la seule chose qui libère son esprit sont les échecs « et parfois la musique ; je travaille sur l’album du Wu Tang actuellement, je suis dans mon studio où tu verras ma MPC, ma NV8000 et un échiquier. A une époque je vivais un divorce difficile, je m’énervais et j’étais sous tension, mais dès que je suis en face d’un échiquier, plus rien ne m’importe« .
Quand le panel de discussion se termine et que les jeux reprennent, c’est Kevvy Kev et RZA qui s’attablent, tandis que Monk, un disciple de RZA, démarre des parties controversées face à Casual, le rappeur du crew Hieroglyphics, et un passionné d’échec. Alors que la tension monte autour de leur plateau, comme s’il s’agissait d’une battle de MC, Josh Waitzkin qui a entamé des parties simultanées avec de jeunes joueurs, garde un oeil sur toutes les parties aux alentours.
Quand Casual quitte les lieux, un sourire aux lèvres, RZA suggère que lui et Monk poursuivent des parties sur Internet, ce à quoi Casual réplique que Monk risque de tricher en ayant Chessmaster ouvert sur un autre écran… Fou rire général dans la salle.
La chaise est libre, Josh entame une série de parties avec Monk, à qui il propose une analyse psychologique de son jeu. Il lui fait remarquer que Casual lui faisait commettre des erreurs à chaque fois que ce dernier accélérait son jeu et que Monk se sentait obliger d’accélérer aussi.
« « C’est comme ça que joue GZA » s’écrie Monk quand Josh attrape et dépose brutalement un pion sur l’échiquier. »
Il lui explique comment la façon dont un joueur pousse son pion (en le faisant glisser ou en le déposant plus violemment) influe sur la psychologie de l’adversaire. « C’est comme ça que joue GZA » s’écrie Monk quand Josh attrape et dépose brutalement un pion sur l’échiquier. Après quelques parties, un sourire en coin, Josh confie à Monk qu’il a un très bon jeu, tout en suggérant à ce dernier la lecture d’un ouvrage sur les échecs indiens qui lui permettra de perfectionner son style de jeu. Quand le fils d’Adisa, lui-même un jeune joueur d’échec émérite, vient à la table demander qui a gagné, Josh agit comme s’il n’avait pas entendu la question, trop humble, comme s’il ne pouvait prononcer sa victoire, victoire qui au fond est loin d’être le seul objectif dans le jeu d’échec ; en quelques parties Monk a gagné des conseils qui lui serviront à l’avenir, face à ses acolytes du Wu.
Les parties s’enchaînent et le Omega Boys Club va fermer… Sur le trottoir dehors dans la plus pure tradition Hip-Hop, un cipher se forme, des rappeurs y lancent leur rimes, avant que RZA ne sorte de son cerveau un couplet aussi tranchant qu’un sabre. [NDLR: voir l’impro’ de RZA ici.]
C’est le deuxième évènement de la sorte qui se déroule dans la Bay Area depuis le début de l’année ; en Mars à San José, la première édition avait rencontré du succès, mais avait tourné court après que les responsables de la bibliothèque Martin Luther King qui abritait l’évènement ne décident de fermer plus tôt que prévu.
A l’instar des arts martiaux et des échecs, les disciplines de la culture Hip-Hop réclament un entraînement acharné et une stratégie bien définie pour permettre d’atteindre ses objectifs. Il a fallu des séances d’entraînement draconiennes à Q-Bert pour devenir le Dj et champion qu’il est aujourd’hui. Il a fallu une stratégie efficace et sérieuse pour que Paris, en marge de l’industrie du disque, lance son label avec succès. Il a fallu une réflexion similaire à celle d’une partie d’échec pour que RZA organise sa carrière et celle du Wu dans une industrie du disque sans pitié pour les artistes. Dans tous les aspects de la vie, la réflexion et l’analyse sont le fondement de la stratégie qui conduit au succès. Que vous souhaitiez étudier la médecine, ou quitter la drogue, créer une entreprise ou sortir un disque de rap, progresser dans votre carrière ou ne pas repartir en taule six mois après en être sorti… La vie est comme un jeu d’échec qui est comme un combat au sabre, il faut réfléchir avant d’agir.
Cette journée, regroupant des artistes et champions du calibre de RZA, Josh Waitzkin et Q-Bert, autour des échecs, nous ramène aux sources du Hip-Hop, lorsque cette culture offrait aux jeunes, aux déshérités et aux laissés pour compte les outils pour se sortir du ghetto, devenir actif et contribuer en bien à la communauté.
Le discours et les échanges de cette journée tranchent fondamentalement avec l’image actuelle du Hip-Hop, celle qui rend glamour la vie dans le ghetto et la pauvreté. L’image qui, ici même dans la Bay Area et dans le mouvement Hyphy, parle de « thiiize » (argot signifiant être high à l’ecstasy, le nouveau crack de la jeunesse de la Bay), s’amuse à agir « Dumb« , à ne penser qu’au diamètre de ses dubb (enjoliveurs), ou encore à ghost ridder (pour les non-initiés cela consiste à danser et faire le con à côté ou sur le capot d’une voiture qui roule au point mort ou en ‘neutral’ sur les boites automatique ; on dénombre quelques morts dus à cette pratique).
Raz-de-marée sonore déboulant au début des années quatre-vingt dix, la constellation des étoiles Shaolin gravitant autour de RZA s’est lentement- mais très sûrement- éteinte ; jusqu’à devenir aujourd’hui, à quelques exceptions près, aussi insipide qu’un discours de François Hollande. Oui, l’heure est grave. Mais si la fin de règne a été annoncée, validée et confirmée depuis belle lurette, on n’évacue pas un tel traumatisme aussi facilement (un esthète avisé me souffle également qu’on ne s’achète pas non plus une BM’ en livrant des pizzas). Comme guidée par des repères générationnels pas forcement rationnels, la pupille de l’auditeur fanatique continue néanmoins à s’agiter, parfois discrètement, à l’évocation d’une nouvelle sortie frappée du sceau Wu-Tang Clan. Ouvrons l’œil, donc, et le bon (le mauvais c’est déjà fait).
Membre de la cellule de producteurs Wu Elements– en compagnie de Mathematics, 4th Disciple et True Master- depuis ‘Blowgun’, pièce rapportée isolée à Detroit, Bronze Nazareth n’est ni excentrique ni excessivement volubile. A défaut d’être un phénomène de foire, il est à l’origine de(s) deux coups de semonce mémorables sur Birth of a prince, ‘A day to god is 1000 years’ et ‘The birth’ semblant célébrer la naissance d’un prince qui n’était pas celui qu’on attendait. Egalement sur le pétard mouillé Wu-Tang meets the indie culture, et acteur, avec bien moins de réussite, Bronze Nazareth entend franchir aujourd’hui une nouvelle étape avec son premier album solo The Great Migration.
Lecture. Les premiers tours de sillons confirment d’emblée nos attentes. Sans surprise, Bronze Nazareth récite la partition du producteur/MC affilié au grand Pope Bobby Digital. Mêmes envolées de Soul, mêmes abeilles tueuses, même imagerie empruntée aux arts martiaux, et même équilibre entre spiritualité et spontanéité. Il pousse même le mimétisme à revisiter certains hymnes du Wu-Tang, dont le fameux ‘C.R.E.A.M.’ sur le posse-cut de seconds couteaux ‘$ (a.k.a Cash Rule)’. Si ses inspirations lorgnent clairement vers les standards du genre, souffrant du coup de la comparaison, elles ne manquent pas d’agiter par instants notre électrocardiogramme. Difficile de ne pas détacher ‘Hear what I say’, ‘The Pain’ ou encore ‘$ (a.k.a Cash Rule)’ qui tirent indéniablement l’ensemble vers le haut.
Habité par une approche d’artisan, à contre courant des multinationales du rap, Nazareth sait déjà qu’il n’aura ni cinq micros dans The Source, ni une place confortable dans la rotation de Hot 97 (‘Hear what I say’). Et il le proclame non sans un certain humour sur ‘Hear what I say’: « I’m so underground I play beats on the bones of Medgar Evers » ou « I’ll probably never be as big as Slim Shady or Jay-Z, even though I write vivid like I’m Homer the Greek« . Plein centre. Habile manipulateur du sampler, Bronze Nazareth s’avère bien moins brillant micro en main. Mais à défaut de convaincre pleinement, il réussit à planter son lot de banderilles et ce tout particulièrement lorsqu’il injecte du sens dans ses samples.
Sans réinventer la roue ni même égaler les quelques monolithes des années quatre vingt-dix, ce premier essai réussit par instants à ressusciter les plus belles heures d’une époque aujourd’hui lointaine. Un peu juste pour transformer le bronze en platine ou en or, mais bien assez pour hanter nos oreilles pendant un bon moment.
« Sur le papier, cela n’avait l’air de rien… Une pulsation, basson, cor de basset, un bandonéon rouillé qui miaule. Et soudain, haut perché, un hautbois – une seule note, flottant comme suspendue, jusqu’à ce qu’une clarinette vienne la reprendre et l’adoucir en une phrase de pur délice… C’était une musique exceptionnelle, empreinte d’une telle tension, d’un tel inépuisable désir, qu’il me semblait entendre la voix de Dieu« .
Cette tirade, extraite du film Amadeus de Milos Forman (1984), est attribuée à un compositeur contemporain de Wolfgang Amadeus Mozart, impuissant face au génie de son jeune rival… Pour qui s’est un jour imprégné de ce film, cette tirade est la première qui vient à l’esprit à l’écoute de ‘The birth’, pénultième morceau extrait de Birth of a Prince, de RZA. Certes, les ingrédients musicaux ont considérablement évolué depuis le siècle de Mozart – le synthétique supplantant peu à peu l’organique – mais l’impression d’assister à un miracle demeure la même… Miracle Wu-Tang, tout d’abord, inédit depuis l’indépassable ‘Rainy Dayz’ (1995) où, à la voix caverneuse de Blue Raspberry répondait une symphonie antédiluvienne mêlant orage menaçant, chant funèbre, croassements sinistres et extraits du film The Killer de John Woo (1989), symphonie sur laquelle Ghostface Killah puis Raekwon n’avaient plus qu’à déposer leurs couplets – vénéneux, forcément vénéneux -, l’ensemble s’achevant sur une pluie bienfaitrice longtemps attendue… Miracle Wu-Tang, encore, parce que cette boucle d’anthologie est produite par Bronze Nazareth, fils spirituel de celui qui se fait aujourd’hui appeler le Prince Ruler Zig-zag-zig Allah (« Arm-Leg-Leg-Arm-Head »). Mais surtout miracle RZA, enfin, tant le destin de ce dernier semble marqué du sceau de la prophétie de l’oracle.
Le titre Birth of a Prince n’est aucunement anodin. Il est la résultante de quinze années étonnantes, qui peuvent se découper par cycles de cinq.
Premier cycle de cinq années : 1988-1993. Impliqué dans une fusillade, le jeune Robert Diggs Jr. échappe par miracle – il est le premier surpris, parce qu’il se sait coupable – à une lourde peine de prison. Il vit son acquittement comme une seconde chance, qu’il ne laissera pas passer. Visionnaire, il consacre ces cinq années à poser les jalons d’un vaste plan de conquête du monde depuis son quartier-général de Staten Island, NYC, qu’il rebaptise Shaolin.
Le plan élaboré, débute alors le deuxième cycle de cinq années. 1993-1998 : Robert Diggs Jr. est devenu RZA, a.k.a. Prince Rakeem Zig-zag-zig Allah. Il est le cerveau, le Wolfgang Amadeus, le gourou du Wu-Tang Clan, mystérieuse entité d’une dizaine de MC new-yorkais alliant vécu asphaltique et passion commune pour les films d’arts martiaux underground. Leur rap martial étonne, bétonne et détonne. Alternant savamment opus collectifs et projets plus personnels, les autoproclamées « abeilles tueuses » quadrillent la planète. C’est là le deuxième miracle de RZA.
1998-2003 : à son tour RZA tente l’aventure solo. Cependant, fin stratège, il prend soin auparavant de faire courir le bruit d’un monumental album solo en gestation. Le foetus s’intitule The Cure, et ne verra le jour qu’une fois que lui, Robert Diggs Jr., en aura fini avec les démons qui l’habitent. Pour ce faire, il sort ses deux projets solos sous le pseudo de Bobby Digital, Bobby émergeant sous Robert, Digital sous Diggs… Bobby Digital-le-terrien incarne tout le côté hédoniste, matérialiste et lubrique que RZA-l’aérien (qui se fait aussi appeler Rzarector, les jours de grand beau temps, ou encore The Abbott, les soirs d’orage) refoule… Parallèlement à cette cure psychanalytique de schizophrène assumé, et tandis que l’aventure Wu-Tang continue, RZA poursuit son destin miraculeux : il signe en quelques jours la B.O. du lévitatif Ghost Dog, The Way of The Samuraï de Jim Jarmusch (1999), qui lui vaut une pluie de louanges dépassant largement le cadre de la communauté hip-hop ; forme de jeunes producteurs au « son Wu-Tang« , faisant d’eux des disciples loyaux et inventifs (cf. l’instru de folie de Allah Mathematics sur ‘Fam (members only’, en 2002) ; entame un tour d’Europe du rap dont il revient avec un projet démiurgique, The world according to RZA, premier volet d’une série devant le conduire à terme aux quatre coins de la planète.
C’est au sortir de ce troisième cycle que paraît Birth of a Prince. Enregistré en catimini entre juin et septembre 2003 – alors que RZA était attendu du côté de chez Quentin Tarantino -, annoncé seulement quinze jours avant sa sortie, cet album de seize titres paraît à maints égards augurer d’une nouvelle ère. En effet, outre un changement de maison de disques, il s’agit d’abord du premier projet solo que Robert Diggs Jr. signe sous son nom de RZA ; ensuite, c’est la première fois que les lyrics apparaissent dans un livret du Wu, ce qui peut être interprété comme une volonté de transmission, de compréhension ; enfin, la liste de remerciements en fin de livret a quelque chose de testamentaire et d’oecuménique – y sont mentionnés, entre autres, Dr. Dre, les magazines Source et XXL, ainsi qu’un certain Sifu Shi Yam Ming, remercié pour lui avoir « révélé l’approche martiale de (ses) principes mentaux« … Le tout indépendamment du fait que The Cure y soit à nouveau annoncé comme étant imminent.
Dès l’ouverture de l’album, le ton est donné. Une voix soul inocule, une minute durant, une énergie positive similaire à celle que Louis Armstrong dégageait avec son ‘What a wonderful world’ : « You know how I feel… Sun in the sky (…) It’s a new day, it’s a new life… « … La naissance du Prince va bien nous être narrée. Il faudra cependant s’armer de patience, car il est très vite visible que RZA n’en a pas encore tout à fait terminé avec son turbulent alter-égo Bobby Digital. Celui-ci vient d’ailleurs brutalement coller un bâillon à la voix soul du début, dégager à coups de batte de base-ball les chaises, tables et ronds-de-cuir qui entravent ses mouvements épileptiques pour venir mettre le feu à la piste en un ‘Bob n’I’ diaboliquement efficace produit par José « Choco » Reynoso, qui résonne comme un lointain écho au fameux ‘B.O.B.B.Y.’ qui ouvrait le Bobby Digital in Stereo de 1998, de faux-airs de ‘Protect Ya Neck (The jump off)’ (2000) en plus.
Dans la liste de remerciements qui clôt le livret joint au disque apparaît également le nom du cinéaste John Woo… Rien d’étonnant, tant il y a du Castor Troy en RZA-Bobby durant les premiers tracks de l’album, véritable succession de volte-faces. Depuis l’atmosphère starskyethutchienne de ‘The Grunge’ – ou, au passage, deux producteurs bien connus se font littéralement tagger leur jet privé avec un assassin « Y’all floss like y’all was Jay Z’s and Puffies » -, qui n’est pas sans rappeler le sauvage ‘In the hood’ (2001), jusqu’aux plus dispensables ‘Drink, smoke + fcuk’ ou ‘Fast cars’, produit par Truemaster. Dans ce dernier titre, Ghostface Killah effectue d’ailleurs une prestation très en deçà de ses récents faits d’armes.
A sa décharge, il convient de mentionner que le tueur au visage fantôme était peut-être encore sous le choc du pillage pur et simple du concept de son oedipien ‘All that I got is you’ (1996) par son mentor et ami dans ‘Grits’ (featuring Masta Killa, toujours impeccable). Le Wu-Tang Clan a ses codes, et ces codes sont parfois bien mystérieux. Le copier-coller en ferait-il partie ? Jugez plutôt… En 1996, Ghost se souvenait avec émotion de son enfance : « Four in the bed, two at the foot, two at the head. I didn’t like to sleep with Jon-Jon he peed the bed. Seven o’clock, pluckin roaches out the cereal box ; some shared the same spoon, watchin saturday cartoons« . Que dit RZA en 2003 ? « Four seeds to a bed, eight seeds to a room. Afternoon cartoons, we was fightin’ for the spoon« … Les voies du Wu sont définitivement impénétrables… Toujours est-il que le ‘Grits’ de RZA n’atteint pas l’incandescence déchirante de l’ode filiale de Ghost. Peut-être est-ce là le prix à payer pour la seule véritable faute de goût de l’album.
Au chapitre expérimental, RZA poursuit ici encore ses excursions extra-new-yorkaises, avec un son gras et festif très West Coast sur ‘We pop’ (featuring Division et Dirt Mc Girt, a.k.a. ce bon vieux Ol’Dirty Bastard) produit par Megahertz et qui s’inscrit dans la lignée de ses récentes collaborations avec les Black Knights sur le Killa Beez vol. 2 (2002)… L’influence Timbaland se fait quant à elle ressentir sur le ‘You’ll never know’ (featuring Cilvaringz), véritable déclaration d’amour au mouvement hip-hop. Plus étonnant – mais déjà entrevu sur le ‘Today’s Mathematics’ des Gravediggaz (2002) -, la distillation d’un son très « console Sega Megadrive » (big-up aux claviers Bontempi !) sur l’une des perles de ‘The drop off’, qui voit – M.L.F. s’abstenir – la femelle gémir sous le Bobby, et le Bobby, de joie, enchaîner avec un couplet de folie… La façon dont RZA-Bobby cale sa voix sur le beat au début du second couplet devrait définitivement clouer le bec à ses derniers détracteurs. Il reproduit ici une technique martiale qu’il avait déjà utilisée sur ‘Glocko-pop’ (2001), technique consistant à rebondir sur les mots comme le pied d’un moine Shaolin rebondit sur le visage de ses adversaires… Pour l’anecdote, les Saïan Supa Crew-addicts ne manqueront pas ici de relever l’influence de la construction de leur morceau ‘Polices’ (2001), que RZA n’aura certainement pas manqué de ramener dans ses valises à la suite de leur fructueuse collaboration…
S’agissant du New-York intra-muros, nul ne pourra affirmer que Birth of a Prince est un disque loin du béton. Tous les bruits de la ville sont là en effet : des crissements de pneus au rotor d’hélico, des sirènes bleutées au métro aérien, des klaxons aux sifflets des agents de la circulation, des rafales d’Uzi aux gémissements de la voisine, de la sonnerie du téléphone au vomissement furtif entendu sur ‘Chi Kung’… ‘Chi Kung’, justement. Avec ‘Koto Chotan’ (contraction de Koto, sorte de guitare traditionnelle japonaise, et de Chotan, qui est le mode d’enseignement le plus connu du karaté), ‘Chi Kung’ est l’un des deux morceaux au titre se référant ouvertement aux arts martiaux : le Chi-Kung chinois est la version interne du Kung-Fu, par laquelle le pratiquant tend à maîtriser les flux d’énergie qui l’habitent, le traversent et parfois le consument. C’est surtout l’une des plus belles réussites de l’album, en dépit d’un thème auto-destructeur, sorte de ‘Passe-passe le oinj’ transposé à Shaolin. Sur une production tout droit tirée de la scène-du-boss-de-fin-de-tout-bon-film-de-savate-qui-se-respecte et signée Barracuda – production au-dessus de laquelle plane l’ombre de ‘I can’t go to sleep’ (2000), notamment dans les interstices -, RZA y reprend sa vieille recette de la voix cassée, oubliée depuis l’’Outro’ du second album des Gravediggaz (1997). Beretta 9, Featherz et surtout Cilvaringz, décidément bien en cour, viennent lui prêter main forte, comme au bon vieux temps d’’Holocaust (Silkworm)’ (1998). Le tout forme un magma à la consistance étrange, ambigüe. Envoûtante.
Envoûtant, l’album le devient à un degré rarement atteint à partir de ‘A day to God is 1.000 years’, produit par le décidément très prometteur Bronze Nazareth… Alliant flûte caressante, sample d’une voix féminine délicatement accéléré jusqu’à obtenir un quasi-miaulement (« I wanna stay with you forever… »), ainsi qu’un bref clin d’oeil à Gwladys Knight & The Pips – catapultant l’auditeur dix ans en arrière, à l’époque veloutée de ‘Can it be all so simple’ -, RZA y enfile sa toge de grand Pope, expédie Bobby Digital au confessionnal le temps de grimper tout en haut de sa chaire fétiche, et d’entonner sa prêche miraculeuse. Il s’agit de loin du plus beau texte de l’album, le plus inspiré depuis ‘Sunshower’ et ‘Twelve Jewelz’ (1997) à l’image de sa conclusion : « Trust me, son, it’s dear in between your ears, a day to God is a thousand years. Men walk around with a thousand fears. The truest joy of love bring a thousand tears. In the world of desire there’s a thousand snares« …
En fin connaisseur des écrits de Sun Tzu et de Lao Tseu (« Si les Fleuves et les Océans sont rois des Cent Rivières, c’est parce qu’ils savent se tenir en dessous d’eux« , disait l’auteur du Tao Te King), RZA accorde un dernier bon de sortie à Bobby Digital, le temps d’un volontairement léger ‘Cherry Range’, qui sent bon l’antichambre, la salle d’attente, le ‘Basic Instructions Before Living Earth 2003’ et semble répondre ton pour ton au très doux ‘Wherever I go’ – ce dernier track recelant un morceau caché dont la mélodie rappelle furieusement les premières notes du ‘Pull bleu-marine’ d’Isabelle Adjani… Il est temps alors de clore « Birth of a Prince » par deux morceaux appelés à être recouverts par les neiges éternelles tant ils surplombent tout ce qui sort actuellement : ‘The birth (broken hearts)’ et ‘See the joy’.
Outre l’instru quasi-séminale de Bronze Nazareth, ‘The birth (broken hearts)’ sonne comme l’achèvement d’une trilogie entamée en 1997 avec feu Poetic et Fruikwan des Gravediggaz sur le dantesque ‘The night the earth cried’, et prolongée en 2000 aux côtés de Ghostface Killah et Junior Reid avec le sergioleonien ‘Jah world’… Dès l’interlude qui ouvre le morceau, RZA assène : « Don’t call me Bobby no more, man. My name is Prince Rakeem« . En deux phrases, c’est un pan entier de l’histoire du rap qui vient de basculer.
Balayant les siècles, inventant des métaphores alibabesques (« As a life can be slowed down 20 frames per second seen through Panavision, the inner light inside my mind’s shines expands the prism« ), RZA appuie une nouvelle fois sur la conscience de l’Occident, lui renvoyant au visage un demi-millénaire d’inconséquences, inconséquences qui lui reviennent dans les gencives aujourd’hui. « Modern-day Flinstone », RZA s’affirme le fruit de cette histoire – en décodé : tous les chemins mènent à RZA. Il le dit haut et clair: « No man could stop my flow, because I know what I speak, and I speak what I know« . Et va même jusqu’à le chanter, en un couplet poignant : « What becomes of a broken family, dreams are crushed and there’s no more family… Ever since my birth I’ve had no one to care »
Ayant planté sa Wu-Tang sword à équidistance de notre tête et de notre coeur, RZA nous l’enfonce jusqu’à la garde avec un inouï ‘See the joy’. Jamais encore il n’était allé aussi loin dans l’introspection… Salvador Dali disait que ses souvenirs remontaient jusqu’à l’époque où il était dans le ventre de sa mère. RZA le prend au mot, et chante le parcours du spermatozoïde qui féconda l’ovule maternel, accompagné pour la première fois par un authentique orchestre. Il chante ce combat, en tire une morale – « Life is the struggle » (et non « life is a struggle« , la nuance est de taille), et clôt l’ensemble par sa venue au monde sur un chant de félicité : « See the joy of life beginning… Oh, sweet joy, a brand new baby’s born« …
L’album se clôt sur ces mots. La fin de l’album rejoint le chant d’ouverture. C’est simple, sobre, zen. Et en même temps incroyablement fouillé. Nous en restons là, pantelants. Conscients d’avoir eu l’immense privilège de pénétrer l’une des oeuvres artistiques les plus complexes de l’année 2003. Un disque qui ne s’adresse ni à l’oreille droite, ni à l’oreille gauche. Un disque qui atteint directement l’oreille interne, celle qui conditionne l’équilibre. Un disque labyrinthique, abyssal, lynchien. Un « unorthodox paradox« , pour reprendre les mots qu’utilisait le même Prince six ans plus tôt – époque chrysalide -, dans le sculptural ‘Dangerous Mindz’, des Gravediggaz.
Parfois pompeur, parfois pompeux… Parfois vénal, parfois génial… Parfois futal, parfois futile… Parfois utile, parfois brutal… Parfois mi-racoleur, parfois miraculeux… Parfois Yin, parfois Yang… Parfois Zig, parfois Zag… Parfois Docteur Zig-zag-zig, parfois Mister Digital… « Sur le papier, cela n’avait l’air de rien… Une pulsation, basson, cor de basset, un bandonéon rouillé qui miaule. Et soudain, haut perché, un hautbois – une seule note, flottant comme suspendue, jusqu’à ce qu’une clarinette vienne la reprendre et l’adoucir en une phrase de pur délice… C’était une musique exceptionnelle, empreinte d’une telle tension, d’un tel inépuisable désir, qu’il me semblait entendre la voix de Dieu« .
…ou la naissance d’un Prince.