
Mourad Mahdjoubi, les autres chroniques de Mars
Reconnu au début des années 90 dans le milieu rap marseillais, le groupe Uptown passera du statut de nouvelle sensation à celui de groupe oublié. Mourad Mahdjoubi, alias Numéro 7, aujourd’hui avocat au Barreau de Marseille, dévoile l’histoire de l’ombre à la lumière, puis de la lumière à l’ombre du premier groupe de rap issu des quartiers Nord.
S’il connaît un regain d’intérêt ces dernières années grâce à sa nouvelle garde, le rap marseillais a traversé un désert qui s’étend du milieu des années 2000 à la fin des années 2010. Hormis Soprano qui entamera un virage pop, la lumière dégagée par la galaxie IAM et leur opus magnum L’École du micro d’argent s’est peu à peu éteinte. Et bien que le rap marseillais post-1997 soit assez bien documenté, il y a quelques zones d’ombres et oublis sur son histoire antérieure. Au début des années 1990, le rap de la cité Phocéenne est dans sa première effervescence. Dès 1990, les premiers clips sur M6 arrivent. Parmi eux « Concept » d’IAM et, moins connu, « Was A Brother » de Soul Swing & Radical. Dans ce dernier, tapi dans l’ombre, derrière Malek Sultan, et bague trois doigts au poing, Numéro 7 – Mourad Mahdjoubi au civil – fait son apparition. Ce sont les débuts d’Uptown, premier groupe originaire des quartiers Nord, entre la cité Saint Joseph et celle des Micocouliers où un local de hall d’immeuble deviendra le studio La Kave. Stabe, Le Funkestaim, Mounir Belkhir et Azeex complètent la formation. Si le nom Uptown apparaît parfois dans les crédits des disques locaux (Fonky Family et Prodige Namor), l’histoire du groupe est restée dans le côté obscur. A l’occasion de la réédition numérique de Kartier de fous, Mourad, avocat aujourd’hui, revient avec nous sur le parcours et l’héritage de son groupe pour éclairer un peu plus l’histoire du rap marseillais et comme le disait Gang Starr en 1991, donner du crédit à qui de droit.
« If the next man deserves it, earns it, it should be law
So let him pass right through
Because you got to give the credit y’all where it is due »
A : Revenons tout d’abord quelques années en arrière, avant que le virus du rap ne te contamine. D’où viens-tu ?
Mourad Mahdjoubi : Je suis né à Marseille. Mon père est Algérien, il est arrivé à sa vingtaine du côté de Roubaix à l’époque où les immigrés étaient recherchés pour de la main-d’œuvre industrielle. Auparavant il travaillait en mécanique moto à Alger dans une boîte qui s’occupait des cascades sur les films de Belmondo. En s’intéressant à la mécanique bateau, de fil en aiguille, il est arrivé à Marseille. Ma mère d’origine française avait encore son accent ch’ti. S’adapter à l’accent local lui a valu quelques plaisanteries de la part de ses sœurs. [Rires] Une histoire française quoi.
A : A quoi ressemble ta scolarité ?
M : À la base, j’ai fait une scolarité publique. Ma mère voulait que je prenne Allemand en première langue. Je me suis retrouvé dans des classes où les règles étaient assez strictes. Jusqu’au lycée, j’ai souvent été le seul maghrébin et ça pouvait m’attirer pas mal d’ennuis. Dès qu’il y avait une connerie c’était moi… Bon parfois c’était vraiment moi, j’avoue. [Rires] Mais la plupart du temps, je ne faisais que suivre. J’en parle d’ailleurs dans un morceau. [« Quand j’avais 16 ans », NDLR] Mais effectivement je me suis retrouvé dans des situations où les petites copines disaient aux profs, même au lycée : « Mais pourquoi vous vous en prenez toujours à lui ? C’est parce qu’il s’appelle Mourad ? » Je devais intervenir en disant que je pouvais prendre ma défense tout seul et que parfois c’était vraiment moi. Je retiens quand même de cette école-là le fait d’avoir des professeurs qui nous apprenaient le débat, qui nous laissaient nous exprimer et formuler nos pensées. Quitte à nous laisser parfois faire les cons et à nous couvrir derrière. Aujourd’hui, ayant des enfants, je trouve que l’école a glissé vers un endroit où l’on dispense du savoir transcendantal. Des garde-à-vue d’élèves, parce qu’ils sortent du cadre de la pensée unique, je trouve ça triste et déplorable. Par la suite, j’ai fait des études scientifiques même si j’adorais le français. Je me suis retrouvé à la fac où c’était carrément l’usine. A ce moment-là, j’ai un peu déchanté de l’image républicaine. C’est aussi à cette période que je mets un pied dans le rap. En première année, je m’inscris au fanzine de la fac et j’écris un petit article sur le rap marseillais à la fin de l’année 1991. En même temps avec un pote de lycée, on amenait des cassettes de Bell Div Devoe à notre professeur d’anglais. Ce pote venait de Belsunce et il a également fait partie des débuts d’Uptown. A la base c’était une bande de copains, c’était un posse à la manière de la Fonky Family quelques années plus tard. Après j’ai un peu décroché des études scientifiques et on a commencé un peu à tourner avec le groupe. Ça coïncide avec la période où on peut dire qu’on était dans « la réserve » du rap marseillais.
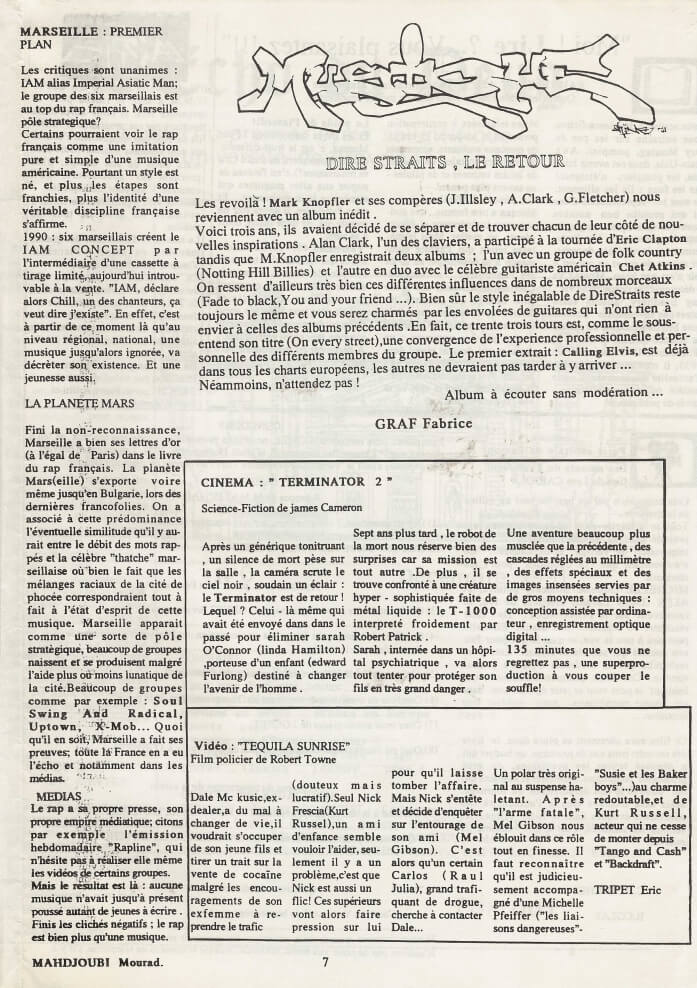
L’article écrit par Mourad Mahdjoubi dans le journal de la faculté de droit
A : Justement, comment le rap vient à toi ?
M : Un petit peu comme tout le monde, avec l’émission de Sidney, H.I.P.H.O.P., par rapport à la danse. Pour une fois tu voyais un noir à la télé, on s’est senti représentés par des gars et une activité qui nous transcendait. Dans la foulée, il y a eu « The Message » de Grandmaster Flash & The Furious Five qui au départ a été vécu comme une ambiance, un truc dansant qui petit à petit s’est transformé en quelque chose de plus profond. En étudiant l’anglais et en s’intéressant aux paroles, je me suis rendu compte qu’il y avait plus que la danse et qu’ils nous parlaient de leur condition sociale. C’est comme ça que je suis passé des poèmes en mode « j’ai le spleen », la rime pour la rime, à des textes sur nos conditions. Je crois que mon premier texte devait s’appeler quelque chose comme « Quartier Zone Rap » ! En gros : on zonait, on avait rien à faire au quartier, il n’y avait pas de commerces, on mettait une heure pour aller en centre-ville, etc.
A : Effectivement j’ai l’impression qu’il y a toujours eu une différence assez importante entre ce que vous appelez les quartiers Nord et le centre-ville de Marseille, et que les deux ne fonctionnaient pas à la même vitesse. Comment se manifestait ce décalage ?
M : Je suis originaire de St Joseph, un quartier du quatorzième arrondissement. Dans les statistiques, c’est l’arrondissement le plus bétonné en France. Lors de la phase de rapatriement des « nouveaux immigrés » dans les années soixante, la ville a fait construire un peu partout des cités et des HLM pour les loger. Ceci dit, il y avait déjà des disparités sur certaines cités, y compris St Joseph, qui sont passées de bidonvilles à du préfabriqué et d’autres qui étaient plutôt des cités de copropriétaires qui se sont dégradées plus tard dans les années quatre-vingt-dix. C’était assez disparate. De notre côté on avait l’habitude de se classer par quartiers, un peu comme un classement CSP si tu préfères ! « Ah, t’es de cette cité, t’es un « bourgeois » ! » Mais finalement, on fréquentait tous le même collège, le même lycée, on a tous appris à se connaître. Et c’est vrai que dans les quartiers Nord, qui représentent quand même un tiers de la ville, il y a une forte identité. Parce qu’on avait l’impression qu’on n’avait pas du tout la même vie que d’autres adolescents de quartiers différents : la discrimination pour rentrer dans les boîtes à la fin des années quatre-vingt, des mecs qui se faisaient tabasser, la BAC et ses ripoux, toutes ces choses ne datent pas d’hier. A côté de ça quand je suis arrivé au lycée, sur une vingtaine d’élèves en classe de seconde, on était une dizaine de copains qui se disaient : « mais ils n’ont pas vécu les mêmes choses que nous. »
« Je me suis dit : putain, je vais être le premier MC des quartiers Nord, je vais ramener du hardcore ! »
A : Vous arriviez à vous mélanger, ou ça restait compliqué ?
M : C’était rigolo parce qu’à un moment on s’est retrouvé, genre plutôt en mode « bad boys », à se connecter avec des mecs qui étaient à fond O.M. dont un qui après est devenu un supporter mythique de Marseille et l’emblème des MTP. [Depé, de son vrai nom Patrice de Peretti, fondateur du club de supporters « Marseille Trop Puissant » décédé en 2000, NDLR] Il est rapidement venu traîner avec nous, il appréciait notre côté bon délire, et même le côté un peu sauvage et castagne. D’un autre côté, j’avais un pote qui n’avait pas eu la chance d’avoir fait des hautes études comme nous. À force de se faire virer de deux ou trois lycées, il avait atterri dans un institut privé à Marseille. Tu sentais que les parents étaient derrière pour faire le chèque et le scolariser. Ce n’était pas un mauvais garçon mais il avait un contexte difficile et ses parents divorçaient. Il était branché NBA et était un des premiers à avoir Canal +. On se tapait l’incruste chez lui pour voir les matchs de basket, on se cotisait pour acheter nos premiers disques de rap, genre le premier Jazzy Jeff & Fresh Prince. Par moments on achetait nos disques en commun à la FNAC. Et lui était en classe avec un autre gars qui s’appelait KayDee…
A : Le fameux Rahim KD ? [Rahim KD apparaît sur la face B du maxi Tam-Tam de l’Afrique “Fuit L.A.I.” en 1991 avec un style ragga, puis sur le morceau “Côté Obscur de la Planète” en 1992 sur Rapattitude 2, cette fois orthographié Raheem KD, NDLR]
M : Lui-même. Donc KayDee commence à lui parler de mecs en centre-ville, au Vieux Port devant le Free-Time [ancienne chaîne de fast-food rachetée par Quick en 1992, NDLR], qui avaient chacun leur blaze. Donc mon pote à la base, son blaze dans notre bande était Billy. La semaine d’après, il s’appelait Billy B. Encore la semaine suivante c’était MC Billy B, puis enfin la dernière semaine Professeur MC Billy B ! [Rires] On lui demandait d’où il sortait ça et nous expliquait que « professeur c’était pour affirmer que tu as une certaine science et que tu es là pour l’enseigner aux autres. » C’était KayDee qui lui apprenait tout ça ! Intrigué, j’en viens à descendre avec Billy sur le Vieux Port. Je prenais les derniers bus de la journée et je commençais à traîner avec tous ces gars, dont KayDee. Puis deux, trois fois après je rencontre un gars qui avait un blouson en cuir trois-quarts et des grillz aux dents. À cette période, on avait une petite embrouille avec des mecs qui voulaient savoir qui était Doctor Fink, mon nom de tagueur en référence au claviériste de Prince et avec lequel j’avais toyé [terme employé dans le monde du tag/graff désignant le fait de recouvrir une œuvre existante avec sa propre signature, NDLR] un graffiti en centre-ville. Et ce mec avec les grillz qui m’avait été présenté par KayDee me regarde et me dit : « T’inquiètes pas, s’il y a des embrouilles je monte, je vais chercher le 9 millimètres. » Et ce mec c’était Akhenaton. À l’époque on l’appelait Chill, et ma première discussion avec lui c’était ça ! Il revenait juste de New-York et était encore bien imprégné de l’état d’esprit de là-bas. À partir de là, on a commencé à se fréquenter et à sympathiser. Rapidement, je me suis retrouvé intégré au microcosme du rap marseillais par le biais de KayDee.
A : La cassette Concept d’IAM était-elle déjà sortie à ce moment-là ?
M : Oui, elle était sortie et ils travaillaient sur leur album… De la planète Mars.
A : On est donc au tout début des années quatre-vingt-dix. Uptown existe déjà ou es-tu encore en solo ?
Uptown existait déjà dans une certaine forme qui pouvait s’apparenter à un posse multidisciplinaire et débrouillard on va dire. Je taguais un peu sauvagement en centre-ville avec des potes dans un crew qui s’appelait Revolution Boys. De l’autre côté, on était aussi basketteurs dans un championnat et dans l’équipe il y avait un pote surnommé Azeex [Jacky qui s’occupera plus tard du management d’Uptown, NDLR] qui nous met sur la piste de Mounir. [Mounir Belkhir, futur producteur d’Uptown, NDLR] Azeex nous explique que Mounir a un sampler et qu’il fait des instrumentaux. On s’organise pour aller chez lui, il avait aménagé la cave de son immeuble en mini-home studio avec une salle pour danser. Avec ses potes Eric [lui aussi futur membre d’Uptown, rappeur sous le nom de Stabe, NDLR] et Tonino qui était boxeur, DJ et joyeux luron, il faisait des fêtes un peu sauvages là-dedans. Mounir travaillait sur un mini-sampler Casio de l’époque et sur des mini… [Cherchant ses mots] Tu sais, les phases avec la pause où il faisait tourner d’un côté…
A : Oui, les fameuses Pause-Tapes ! C’était du bricolage, mais beaucoup de groupes amateurs n’avaient pas d’autre choix à cette époque.
M : Voilà ! Il fallait que la pause s’arrête exactement à la bonne microseconde ! Et fin 1991, on commence à accoucher de démos. De mon côté j’avais déjà des textes d’avance, donc c’était assez rapide pour les adapter sur des squelettes d’instrus. Dans la foulée, Stabe a vu que ça commençait à prendre, qu’il y avait même des propositions pour faire des scènes, donc il s’est vite motivé à écrire lui aussi.
A : À partir de quel moment avez-vous considéré être prêts à partager votre travail avec le public ? La cassette Kartier de fous sort en 1995 mais y-a-t-il eu autre chose avant ?
M : Début 92, on était dans un style plutôt A Tribe Called Quest, un peu jazzy, avec des textes posés et réfléchis. Un des premiers morceaux que j’avais finalisé c’était « Tableau Noir ». J’y dépeignais Marseille avec un angle très sombre en racontant les discriminations que l’on pouvait vivre. Par exemple : pourquoi les meufs qu’on branchait en boîte n’avaient pas d’intérêt pour nous ? Parce que peut-être que l’on n’avait pas les bons habits ou les bonnes références que les autres lycéens dont je t’ai parlé plus tôt pouvaient avoir. Et ce morceau est un des premiers que je fais écouter à Chill. Chill commence à me dire que j’ai un style posé à la EPMD, que le morceau est bien, qu’il va en parler à Paris et le proposer à Delabel pour qu’il rentre sur la compilation Rapattitude 2. [Finalement, le morceau n’apparaît pas sur la compilation, NDLR]

Uptown dans le quartier de St Joseph (Crédit : Kamel Belkhir)
A : C’était fréquent de voir des gens des quartiers Nord se mêler à la scène rap du centre-ville ou tu étais un peu une exception à ce moment-là ?
M : Au début, j’étais un peu une exception. Ça fonctionnait quand même plutôt en vase clos. Mais bon j’avais des potes que je connaissais du Lycée, des gens de Porte d’Aix, Belsunce, La Belle de Mai, tous ces quartiers qui font partie un peu du centre-ville. Un mec comme Bouga, je le connais depuis 1992 par exemple. Quand il y avait les deux crews réunis, celui du centre-ville et celui des quartiers Nord, on a dû se trouver un nom de groupe. Prince, qu’on écoutait beaucoup, avait un morceau qui s’appelait « Uptown » et on s’est dit, autant par rapport au morceau qu’à la position géographique des quartiers Nord, que c’était une évidence. De toute façon, il était hors de question, quand tu vois les autres groupes de cette génération, que ce soit IAM ou Soul Swing, de ne pas avoir un blaze américain. À l’époque par exemple, il était impossible que l’on s’appelle Psy 4 De La Rime ! Ce n’était pas dans nos matrices.
A : La première trace discographique d’Uptown, après votre apparition sur « Bang bang » d’IAM (Ombre est Lumière, 1993), c’était bien sur la compilation pour la biennale de Lisbonne en 1994 ?
M : C’est bien le premier morceau officiel du groupe, même si avant il y a eu des participations à des mixtapes vendues sous le manteau. L’année précédente nous avions intégré la deuxième incarnation du collectif Côté Obscur, qui comptait en ses rangs IAM, Rahim KD, Art No, Dope Rhyme Sayer, Grand Organisateur D.E.F., [respectivement Faf Larage et Def Bond, NDLR] Moyen Age-1 qui étaient d’Agen, etc… J’avais même été invité sur scène par IAM pour un freestyle, juste avant la sortie d’Ombre est Lumière pour annoncer l’album. Je me suis retrouvé à faire un gros freestyle avec KayDee, Art No, Faf. J’avais mis le tee-shirt Eric B & Rakim en mode « je vais tous les défoncer » ! J’avais une mission, je me suis dit : « putain, je vais être le premier MC des quartiers Nord, je vais ramener du hardcore » !
Iam - « Bang Bang » feat. Numéro 7 & Stabe (Uptown)
A : Ce qui m’a immédiatement interpellé sur « Bang Bang », au delà du fait que je n’avais jamais entendu parler de vous avant, c’est ce côté très « gangster » dans le discours. C’était la première fois que j’entendais les membres d’IAM parler d’armes à feu ou menacer de tirer sur quelqu’un, et je me suis toujours demandé si c’était à votre initiative. C’était votre idée de débarquer avec un texte si frontal ?
M : Tout à l’heure, je te disais qu’on a commencé par faire des morceaux un peu plus posés. Mais à partir de juin 92, je m’amourache d’une fille de Chicago et je la suis aux États-Unis. J’y vais vraiment à l’arrache comme je l’avais fait une première fois à New-York à l’été 90 en mode « je vais découvrir un peu cette culture et la société qui va avec ». Sauf que Chicago, c’était plus dur que New-York. Là-bas, j’avais écrit des morceaux qu’ensuite j’ai enregistrés en septembre en disant à Mounir : « J’ai deux-trois morceaux, ils envoient la patate. » Parmi eux, il y avait « Uptown est armé » et « L’Undaground » où déjà, nous en tant que groupe, on était à fond dans la manière de les vivre et de les interpréter. Mais en plus, ceux à qui on les faisait écouter nous disaient : « C’est comme les ricains mais en français » ou « On a l’impression d’être à New-York avec vous ». Et ces morceaux rapidement, on a senti qu’ils influençaient jusqu’à IAM dans l’écriture. L’album Ombre est Lumière était sorti mais il y avait encore des faces B [Ombre est Lumière est sorti en 1993 en version double album. En 1994 sortaient la version Volume Unique avec des remixs et des faces B ainsi que le maxi Le Feu, NDLR] et le morceau « L’Undaground » a donné « Reste Underground » chez eux. Même dans ce morceau, ils nous dédicacent [Chill par deux fois en fin de morceau « Paix sur les caves des quartiers de St Joseph » puis « Comme l’a dit N°7 : le quartier passe avant tout », NDLR] parce que « L’Undaground » donnait vraiment le ton. Et « Uptown est armé » à mon sens c’est la première fois, à Marseille du moins, qu’il y a un truc de rue qui est fait en français. Ça parle de quartiers, ça parle de calibre, de trucs qu’on a toujours vécu de près ou de loin. Par exemple, tout à l’heure je te parlais du pote Tonino, pour nous il a été important mais c’est un mec qui a été orphelin parce que son père, qui était un boxeur proche du milieu, braquait des bars, a fini mort en prison… Il ne l’a jamais connu. Malheureusement, ce sont les histoires avec lesquelles on a grandies. Mais tout en se disant à côté : faisons quelque chose de positif de nos vies, ne faisons pas comme nos aînés à traficoter et terminer dans des règlements de comptes. Et c’est pour ça qu’ on a toujours essayé de préserver cette idée qu’il devait y avoir un message derrière, même quand on racontait des histoires dures. Par exemple, quand on disait « Uptown est armé », ce qu’on voulait dire derrière c’était : armé mais surtout intellectuellement. C’est une simple métaphore. Pareil pour « Dealers de rimes » qu’on a fait par la suite. On expliquait qu’on pouvait tout aussi bien gagner notre vie en dealant des rimes, de la littérature en réalité, qu’en faisant des trucs sales qui, de toute manière, te ramèneront toujours au même point. Comme le disait Kery James : « Entre quatre murs ou entre quatre planches, y’a que deux issues. »
« Je voyais Chill comme un grand frère, lui me voyait comme son petit frère. »
A : Tu parlais de « Dealers de rimes », c’était un peu une locomotive pour la cassette Kartier de fous. C’est le seul clip qui existe d’Uptown ?
M : À partir de 1994 on a décidé de ne plus attendre des promesses qui avaient du mal à se concrétiser. Pourtant de notre point de vue, elles auraient pu aboutir. Parce que déjà en 1993 pour IAM, après le succès et les retombées financières du « Mia », les promesses de monter un label, de sortir des groupes étaient possibles. Mais ce n’est jamais arrivé. Pendant l’hiver 93/94, étant jeunes et impatients par nature, on ne voyait rien venir et parallèlement, ils commençaient à parler d’un projet solo qui allait être Métèque et mat. Puis dans le même laps de temps, je croise par hasard leur premier manager Frankie Mallet [Mentionné dans les crédits vocaux de fin de « Pharaon Reviens », NDLR] dans une manifestation en ville. Je savais qu’il avait été lourdé par le groupe juste après le succès du « Mia », chose qui restera comme une énigme du rap Marseillais aussi bien d’un côté que de l’autre. Comme on était en train de s’émanciper et qu’il était disponible, je lui demande si ça l’intéresse de s’occuper de nous. On ne voulait plus être vus comme les petits frères et être sous la main mise d’IAM. À cette période-là, il faut savoir qu’on était vraiment les outsiders. Dès fois tu parlais dans Marseille, tu entendais : « Ouais moi en rap je suis plus Uptown » et d’autres disaient : « Ouais, non moi je suis plus IAM ». Soul Swing [groupe de Faf Larage, Def Bond, K-Rhyme Le Roi, DJ Rebel, DJ Majestic et DJ Ralph, NDLR] traversait une période compliquée, ils avaient plus ou moins mis la musique en suspens par la force des choses. Donc il ne restait plus que IAM et nous. C’était l’occasion de tenter le coup en totale indépendance avec Frankie. On a postulé pour certains évènements comme la biennale de Lisbonne. Et à Marseille, tu sentais qu’il y avait un regard politique positif vis-à-vis du hip-hop avec un adjoint à la culture assez ouvert d’esprit. Bon ça n’a pas duré bien longtemps, Gaudin est arrivé à la mairie en 1995 et les portes se sont aussitôt refermées ! Mais ceci dit, on a fait notre bout de chemin parce qu’en 1995 du coup, Frankie nous dit : « Bon en vérité, on va faire la même chose qu’avec IAM à l’époque, on va sortir des cassettes. » Et quand tu regardes Kartier de fous, tu peux constater qu’on a adopté exactement le même modèle : on enregistre au studio Le Petit Mas à Martigues, on sort sous format cassette et puis finalement c’est le quatrième album de l’histoire du rap marseillais. Le Retour de l’âme Soul [EP de Soul Swing, NDLR] arrive un peu plus tard, en 1996. On sort la cassette, on fait le café Julien à Marseille. En fin d’année, on organise une soirée qui s’appelle Hip-hop Christmas où Rockin Squat descend. Ideal J devait venir mais ils n’ont pas pu à cause d’une grève des trains. Il y avait une petite mayonnaise qui commençait à prendre autour de nous même au niveau national dans l’underground. Et à Marseille on peut dire qu’on avait pignon sur rue.
A : En parlant d’Ideal J, j’aimerais qu’on revienne sur l’apparition de Kery James dans Kartier de fous. À une époque où il faisait encore très peu de featurings, le voir poser sur la cassette d’un groupe marseillais encore relativement inconnu à l’échelon nationale semblait totalement surréaliste.
M : Je pense que vers 1993-1994, avec le bouche-à-oreille on était relativement connus du côté de la banlieue parisienne. Dans un sens, pour eux, on représentait plus le rap de quartier. Jusqu’au jour où Ideal J, avec leur manager, partent du côté de Cannes. Ils étaient en totale indépendance à l’époque. Et en revenant, ils se disent : « il faut qu’on passe par Marseille et qu’on aille voir Uptown. » Et finalement, ils ne connaissaient de nous que le quartier St Joseph. Ils arrivent avec leur fourgon huit places. C’est Souhil [leur manager et co-fondateur d’Alariana, NDLR] qui conduisait, et ils demandent à deux-trois gars dans la rue : « Ouais, il y a un groupe de rap ici qui s’appelle Uptown. Vous savez où est-ce qu’on peut les trouver ? » Et les gars du quartier finissent par appeler Azeex et c’est comme ça que les deux groupes se rencontrent et que nous devenons amis. On est aussi allé chez eux à Vitry, on y a même assisté à une des premières répétitions du 113 dans leur MJC. On nous disait : « ce sont les petits qui commencent à rapper, on va vous présenter. » C’était vraiment hip-hop et il n’y avait pas d’égo. À l’époque, on était les premiers à connecter avec Ideal J et Kery James. Après d’autres groupes ont continué dans la lancée et se sont un peu servi de nos connections. Mais bon, on partageait tout.
A : À ce moment-là quels sont vos liens avec IAM, et plus particulièrement avec Akhenaton ? Il te présentait souvent comme étant son « petit frère », à une époque où tu avais peut-être déjà des velléités d’émancipation légitimes.
M : Lors du débat qui a suivi le documentaire D’IAM à JuL, Marseille capitale rap !, Gilles Rof [le co-réalisateur du documentaire] dit qu’il y a quand même eu des tensions dans le rap marseillais. La première a été entre IAM et Uptown. Elle était exacerbée par les liens que l’on avait avec Chill : moi je le voyais comme un grand frère, lui me voyait comme son petit frère. On avait des discussions de la vie de tous les jours où on se prenait la tête sur plusieurs sujets. Par exemple : savoir s’il fallait inciter les jeunes à voter. Lui était contre, moi j’étais pour. Est-ce qu’on fait une guerre Marseille-Paris ? Lui était pour, moi j’étais contre. C’était vraiment des trucs où l’on discutait et qui dépassaient le cadre de la musique. Encore plus marrant, à son propre mariage, les gens ne connaissant pas son petit frère ont pensé que c’était moi.

A : C’est vrai que même physiquement, vous aviez des styles très proches.
M : Oui, on m’a souvent dit ça ! En vérité, dans les gars connus de nos générations, on m’a souvent dit que je ressemblais aussi à Zidane. Je ne sais pas trop à quoi attribuer ça.
A : D’où vient la rupture entre vous alors ?
M : Par moment, je commençais à avoir un regard un peu critique sur AKH. C’est bien plus tard, mais quand il se retrouve en débat face à Charles Pasqua [en 1999, NDLR], je les ai trouvés tous les deux dans le consensus voire dans l’emphase sur les sujets du débat. Alors que j’aurais aimé qu’il lui rentre dans le lard comme cela avait été fait deux ans plus tôt dans le morceau « 11’30 contre les lois racistes » [titre collectif du rap français sorti en 1997 en réplique aux lois sécuritaires et anti immigration du successeur de Charles Pasqua, Jean-Louis Debré, NDLR], car on est tous concernés par ces questions ! Devoir sortir des certificats de nationalité pour prouver qu’on était encore français au bout de vingt ans, c’est incompréhensible ! Je me suis dit : « Mais qu’est-ce qu’il attend ? Qu’est-ce qui l’empêche de lui dire ? » Alors qu’en parallèle, il y avait des mecs comme Joey Starr dans les premières émissions de télé en direct qui ne se gênaient pas dire les choses. Est-ce que fondamentalement on doit, quand on est en désaccord profonds sur des sujets, donner cette impression d’emphase des idées lors d’un débat, certes que l’on veut courtois ? Alors j’admets que Pasqua a « bien » joué ce jour-là, mais ça reste une illustration de questions que j’avais commencé à me poser quelques années plus tôt. Puis après, sur la forme, il est clair qu’on devenait les concurrents. De notre point de vue, je pense qu’on commençait à leur faire de l’ombre.
Puis il y a eu la tournée Ombre est lumière. On nous avait dit durant les mois qui la précédaient que nous serions la première partie. Mais au final, on s’aperçoit qu’on ne la fait pas. C’est Soul Swing qui ouvriront la quasi totalité des concerts, Uptown n’a fait qu’une seule date. C’était étrange, car la dynamique des deux groupes étaient opposées : Soul Swing était un peu en dilettante alors que nous on mettait le paquet. Puis IAM s’est fait voler du merchandising dans une voiture garée à Belsunce. Et très vite, des tee-shirts d’IAM volés quelques jours plus tôt ont commencé à être remis sur le marché par des semi-grossistes. Et là, un jeune danseur de notre groupe, qui était dans sa phase « je fais que des conneries » et qui venait de faire six mois de prison rachète une vingtaine de pièces et se fait attraper avec. Quelqu’un l’a identifié en disant : « C’est le danseur d’Uptown. Il vend les tee-shirts d’IAM, etc. » Ça a fait toute une histoire jusqu’à ce que la rumeur circule, accusant Uptown d’avoir fait le coup et braqué la voiture d’IAM. Peu après, j’entends par personnes interposées qu’IAM ont la haine envers nous. J’ai appelé Chill pour lui expliquer qu’on y était pour rien, on se voit, puis les deux groupes se voient ensemble. À l’issue de cette réunion, on s’est tous tapé dans la main : « C’est bon, c’est réglé. » Mais à partir de là, ça a été la guerre froide.
A : C’était la même réunion évoquée par Julien Valnet dans son livre M.A.R.S., histoires et légendes du hip-hop marseillais au cours de laquelle l’équipe du label Côté Obscur a expliqué qu’elle ne signerait ni Uptown ni Soul Swing ?
M : Non, l’histoire des tee-shirts volés c’était en 1994. La fameuse réunion présentée dans le livre de Valnet c’était un peu plus tard, je n’y ai pas participé. Je n’étais pas présent, tout simplement parce que nous n’avions pas été conviés à y assister. À ma connaissance, ça s’est passé entre IAM et Soul Swing. Et lors de cette réunion, deux personnes sont sorties relativement énervées du côté d’IAM : Kephren et Freeman. Suite à quoi ils ont tous les deux décidé de financer le futur EP du Soul Swing. [« Le retour de l’âme soul », sorti en 1996, NDLR] Les seules réunions, entre guillemets, du microcosme rap marseillais auxquelles j’ai assistées étaient en 1995, notamment lors de notre première apparition à un festival hip-hop local organisé par l’A.M.I. [Association d’Aide aux Musiques Innovatrices, NDLR] Cette réunion avait abouti à une plainte générale : « Le hip-hop ici manque de structures, faut faire ci, faut faire çà. On ne fait rien pour nous, etc. » Les artistes étaient en attente d’une aide extérieure. Je me rappelle m’être levé pour dire : « Les gars, à un moment donné, il faut que vous compreniez que c’est à nous de faire les choses. On ne doit pas attendre que Pierre, Paul, Jacques qui est sorti de telle école ou tel élu le fasse pour nous. C’est notre truc, c’est à nous de le structurer. Il nous faut des managers, des avocats et ainsi de suite. » Après sur le moment j’étais habité par la passion, je suis parti un peu en freestyle à l’oral. Chill s’était levé pour dire que j’avais raison. En l’espace d’un an et demi, c’était la première fois qu’il me rejoignait dans le discours.
A : Comment réalisez vous que la rupture avec IAM est consommée ?
M : Chacun est parti de son côté, c’est tout. Il y a eu un mot lors du concert Logique Hip-Hop. Ce soir-là on a vécu un moment d’anthologie et un de nos meilleurs concerts. Il nous a dit après le show en croisant Stabe : « Putain, vous m’avez fait kiffer ! C’était du vrai hip-hop ! » C’était des petits mots de temps en temps comme ça qui retombaient dans nos oreilles. Mais il était clair qu’on ne bossait plus ensemble. Puis de notre propre fait, la dynamique d’Uptown a progressivement ralenti. J’allais de plus en plus régulièrement aux États-Unis, donc j’étais moins présent. Vers 1996, Stabe a eu sa première fille. Notre activité a logiquement décliné.
A : Aux U.S.A, tu as l’occasion de rapper ?
M : Oui, j’ai commencé à traîner avec des mecs qui étaient en fait un crew du sud de Chicago nommé le Skunk Crew. Partout où on allait, on faisait des freestyles, c’était dans l’esprit hip-hop, très naturel. Ils ne se foutaient pas de ma gueule mais ils disaient : « Regardez Mourad, lui c’est un rappeur français, il va vous montrer quelle heure il est ! » Mon pote Kaseem, chambreur de première, était beaucoup dans le partage et connaissait tous les mecs des quartiers, du plus vieux au plus jeune. Il me disait : « Vas-y, envoies un freestyle ! » La plupart des mecs étaient des gros gangsters avec des blousons en cuir qui venaient me dire : « Oh ! Je ne savais pas qu’il y avait du hip-hop en France ! C’est trop bon ! » Tu vois, des gros nounours !
A : Du rap en France, c’était inimaginable pour eux ?
M : Ouais, carrément ! Je me rappelle une fois d’un freestyle que j’avais fait sur la radio d’un campus universitaire de Chicago, WHPK. Il y avait un créneau tous les dimanches soirs pour les freestyles et le Skunk Crew venait squatter. L’animateur et le DJ les connaissaient par cœur. Et donc la première fois où je freestyle, un mec appelle la radio : « Ouais, j’ai entendu MC Solaar ! » [Rires] Je lui ai dit : « Non, non, non ! MC Solaar est un autre rappeur ! Il n’y a pas que MC Solaar qui rappe en France ! »
A : Et pour les membres du groupe, comment gardez-vous les liens à distance, eux en France, toi aux USA ?
M : En 1996, je vivais pratiquement que là-bas et je me voyais y rester. J’ai dis aux potes d’Uptown que ce serait mortel qu’ils viennent pour enregistrer quelque chose. J’avais commencé à négocier des studios, toujours avec mon pote Kasseem. On en avait fait plein mais ils étaient très chers, celui de R. Kelly notamment. Puis on est tombé sur Streeterville, un studio tenu par des mecs un peu geek où les managers du lieu sont contents d’être démarchés par des français, ils veulent apprendre notre langue. Le groupe vient et on y enregistre les deux titres qu’on va ensuite sortir en maxi en 1996, dont « Pulsions » qui sera retenu un an plus tard dans le CD sampler du magazine Groove. Puis après une grosse déception sentimentale, je rentre en France et je fais mon service militaire. Quelques mois plus tard, L’École du micro d’argent sort, avec le succès phénoménal qu’on connaît.

Uptown
A : Comment vis-tu le succès phénoménal de cet album, après la déception que fut la fin de votre aventure commune avec IAM ?
M : Quand j’étais à Chicago, IAM était à New-York pour enregistrer l’album. C’est une époque où j’entretenais une correspondance avec Chill, je sais d’ailleurs qu’il a toujours les lettres que je lui avais envoyées quand j’étais à Chicago. Il me disait : « Viens-nous voir au studio à New-York ! » C’était compliqué, je n’étais pas sûr et en plus ça coûtait un bras. Je n’y suis jamais allé. Et quand l’album est sorti… Comment t’expliquer ? Je retrouve quand même une fierté avec L’École du micro d’argent parce que je me retrouve avec des mecs à l’armée, avec tout ce que ça comporte. Et le soir, le seul plaisir qu’on avait, avec deux-trois copains un petit peu racailleux des banlieues de Paris, Lyon et d’autres horizons, c’était de se mettre à travers le juke-box vidéo le clip de « L’Empire du Côté Obscur. » Il y avait aussi « Fu-Gee-La » qui passait beaucoup en même temps. On fumait nos cigares en mode « on vous emmerde ! » [Rires] Donc j’ai quand même vécu jusqu’à cette époque-là, entre guillemets, la fierté du succès d’IAM malgré les grosses tensions entre nos groupes.
A : Du coup, ça vous motive à retourner en studio ?
M : Quand j’étais à l’armée, Frankie bossait encore avec nous et me dit : « Il y a une D.A. à Paris qui veut vous signer mais il vous faut une quarantaine de titres. » On avait pratiquement tous faits nos services militaires ou étions en train de le faire, hormis Mounir qui était chargé de famille et qui fut donc exempté. On a profité de nos permissions pour écrire et enregistrer, avant d’aller voir cette directrice artistique l’année suivante, une fois les démos bouclées. Aller à Paris, c’était compliqué : il fallait payer les transports, l’hébergement, bref, c’était un vrai budget. Et lorsqu’on rencontre cette directrice actrice qui était chez Polygram, c’est la douche froide. Elle nous dit que son budget rap est épuisé pour l’année. Puis elle nous parle de l’industrie, nous demande notre avis sur des groupes. « Il y a un groupe qui a l’air pas mal : Expression Direkt. Vous connaissez ? Et puis vous avez vu le concert de Doc Gyneco ? » On s’est tous regardé en se disant qu’elle s’en foutait de nous. Ça faisait un an qu’on bossait sur cette démo, et la seule question nous concernant qui l’a intéressée, c’était qu’on lui dise quel était notre tube potentiel. On lui a répondu que c’était « Frère de Sang », un morceau qui raconte l’histoire d’un mec qui se fait abattre par les flics parce qu’il vole une moto, qu’il force un barrage, etc… « C’est ça le tube pour nous si tu veux », alors qu’en fait « Uptownium » tournait pas mal à Marseille, des petits frères l’écoutaient en boucle. Mais cette D.A était complètement allumée, elle voulait juste faire un coup en fait, et on en est resté là. Avec du recul, on s’est dit qu’on était arrivé peut-être un petit peu trop tôt. C’est de cette époque-là qu’est parti Psy 4 De La Rime, et la Fonky Family un petit peu avant.
A : Quitte à me faire l’avocat du diable, et avec le recul qu’on peut avoir aujourd’hui, je me dis que stratégiquement ce n’était pas innocent d’avoir misé plutôt sur la Fonky Family que sur Soul Swing ou Uptown. Vous étiez deux groupes qui, en termes de style, étaient relativement proches d’IAM. Tu ne penses pas que ces similarités auraient fini par vous porter préjudice ?
M : Au début des années 1990, il se disait qu’il ne pouvait y avoir qu’un seul groupe de rap marseillais en France. Peut-être que c’était un discours soutenu par les maisons de disques parisiennes, de la même manière qu’il ne pouvait pas y avoir plus d’un groupe de Toulouse, d’Agen, de Bordeaux ou de Montpellier. C’est comme si dans chaque ville du Sud, il ne pouvait y avoir qu’un seul élu possible. C’était une vision très parisianiste de l’industrie. IAM se présentait d’ailleurs en réaction contre ce parisianiasme : « on est des indépendantistes, on est anti-centralisation », le nom IAM à la base signifiait aussi Indépendantistes Autonomes Marseillais. On se retrouvait dans ce discours et on ne comprenait pas pourquoi il n’y avait pas aussi une place pour nous. C’est aussi pour ça que je leur en ai voulu. En plus, aussi bien Soul Swing que nous, on s’estimait prêts. À l’époque, personnellement j’avais une faim incommensurable. Et c’est vrai qu’à cette période, on a eu beaucoup d’incompréhensions vis-à-vis d’IAM. Alors après, le pourquoi du comment… ? Oui, peut-être qu’ils ont eu peur qu’on leur fasse de l’ombre. Mais c’est un sentiment humain que tout le monde peut avoir à un moment donné. Si j’ai vraiment des griefs à leur encontre, c’est plutôt sur des questions de plagiat. Vols d’idées ou vols de concepts, ce sont toujours des trucs sur lesquels je reviens. Après le parcours d’hommes et de femmes, personne n’est parfait. On a tous vécu une réalité différente et on réagit de façon subjective, on ne voit pas les situations dans leur globalité. Même si ce n’est pas seulement vis-à-vis d’IAM que je tiens ce discours, je considère qu’il y a des valeurs dans le hip-hop qui doivent être respectées.
A : À quelles valeurs penses-tu ?
M : L’héritage, le legacy comme disent les Américains. Chez eux c’est une constante, pratiquement une obligation. Dans le microcosme du rap Marseillais, on s’aperçoit qu’on est un peu oubliés. J’ai eu ce débat avec des affiliés de Puissance Nord qui me disaient que le premier groupe des quartiers Nord était Puissance Nord. J’ai dû leur dire que c’est faux et je peux d’autant plus leur dire qu’on l’a vécu. On l’a porté dans notre chair le truc de poser les quartiers Nord sur la carte du rap Marseillais à l’époque où tout le monde nous gonflait avec le centre-ville ! Même la première brève que nous avions eu dans un fanzine parlait de cela : « Uptown : quartiers Nord contre centre-ville », « le rap des quartiers Nord arrive. » C’est Squaaly qui avait écrit ça dans la rubrique Taktik. Dans le microcosme du rap Marseillais, mis à part Relo qui nous a étonné quand il a fait « Marseille en vrai », on s’aperçoit qu’on est un peu oubliés. Il faut toujours citer les pionniers ! Peu importe qu’ils aient connu le succès ou pas, il faut qu’ils soient mentionnés et reconnus pour ce qu’ils ont apporté.
A : On arrive au moment où le groupe commence à se dissoudre, vers 1997/1998. Votre producteur attitré Mounir Belkhir commence à travailler pour d’autres artistes, notamment Les Nubians et Positive Black Soul. Comment as-tu vécu le fait qu’il commence à rencontrer un certain succès en s’émancipant d’Uptown ?
M : À ce moment-là j’étais un des premiers à l’encourager à faire de la production pour des artistes extérieurs au groupe. Au départ, il ne se sentait pas, le fait que j’étais souvent aux USA l’avait aussi un peu inquiété pour la suite d’Uptown. Il a tout de même produit pour Prodige Namor sur leur maxi et sur leur album. Uptown a été invité sur « Traque Collective », la face B de leur maxi Bienvenue dans le traquenard et comme j’étais aux U.S.A je n’ai pas pu poser dessus. Et pour les mêmes raisons, je n’ai pas pu poser sur « Le Retour du Shit Squad » alors que Lassaad, qui travaillait avec Imhotep d’IAM, m’avait appelé pour Chroniques de Mars. Je devais poser dessus, mais je ne pouvais pas me permettre de faire un aller-retour depuis les États-Unis juste pour ça. Mounir, lui, a su se diversifier à l’international y compris avec Les Nubians. « Makeda » a été un carton quasi planétaire. Quand Mounir a fait écouter ses sons aux Nubians, elles ont retenu la production de « Makeda » et l’ont utilisée. Le plus drôle étant qu’en France, cet instru que je trouvais vraiment au-dessus du lot, je l’avais envoyé pour Mounir à un label qui cherchait des sons pour un girls band R&B. J’avais relancé la maison de disques pour savoir s’ils avaient bien écouté les sons. La réponse était toujours la même : « Oui, oui. On l’a reçu, on vous rappelle. » Ils n’ont jamais rappelé. Alors qu’ils avaient une pépite entre les mains, les Nubians l’ont prouvé. Les maisons de disques, tu peux leur envoyer des tubes en puissance comme ça et rien ne se passe, tu ne comprends pas.
Prodige Namor - « Traque collective » feat. Artno, Assassin, Boss 1, Kabal, MP , Soul Swing & Uptown
A : Le sempiternel bras de fer entre les aspirations artistiques et la réalité du business ?
M : À une période, on envoyait un peu partout des démos d’Uptown qui amenaient quelque chose de nouveau, on avait plus qu’à rentrer en studio, mettre au propre. On allait faire ce qu’on considérait comme étant du vrai rap français. Et eux nous répondaient : « Non mais ce n’est pas assez banlieue, pas assez racailleux. » … On se disait : « Mais qu’est-ce qu’ils veulent de plus ? » Alors qu’on avait l’impression de faire des trucs à la Geto Boys : raconter des histoires, tu vois ce style story-telling que Faf Larage par exemple a décliné avec brio par la suite. Je pensais : « Mais ils n’y comprennent rien en fait, c’est des vendeurs de yaourt ! » C’est aussi à ce moment-là qu’on a commencé à prendre conscience d’être arrivés peut-être trop tôt. Le milieu n’était pas encore assez organisé, contrairement à ce qu’on voyait aux États-Unis. Quand j’étais là-bas, il y avait des premières radios cent pour cent hip-hop, des émissions, des structures alors qu’en France ce n’était que balbutiant. C’est devenu comme ça après l’ère Skyrock où des passionnés ont réussi à investir ces places-là. Mais je crois que clairement, dans tout ce qui est artistique, il faut savoir sélectionner. C’est un peu le parti pris que j’ai fait il y a quelque temps : je vais essayer de me concentrer sur deux-trois artistes par an et vraiment les écouter. Et m’éloigner un peu de la hype du moment. Il y a des groupes de rap français que je n’ai jamais écoutés. Si le rap français m’avait démontré qu’il amenait une valeur ajoutée plutôt que suivre la tendance… En rap français, les dernières claques que j’ai reçu c’est La Cliqua, Les Sages Po et puis voilà ça s’arrête là. Ce sont des groupes pour lesquels je suis encore fidèle. Après tout ce qui se fait aujourd’hui, bon j’entends l’ambiance 13 Organisé, c’est sympa. La nouvelle génération, ils sont tous ensemble, ils sont solidaires… Sauf qu’après tu découvres les histoires entre eux qui sont à peu près du même acabit, voire pire, que ce qu’on a vécu à l’époque entre IAM, Soul Swing et Uptown. Tu te dis : « Ah ! Finalement c’est toujours la même histoire ! » Des histoires de fric et des histoires d’ego. Et puis finalement, quand on faisait « Le Kartier passe avant tout » et des scènes en micro ouvert où on invitait tout le monde, ces espèces de réunions un petit peu festives, on en a faites aussi !
Uptwon - « Le Kartier passe avant tout » feat. Kery James, Design, Toko Blaze, Sista Micky & Namor
A : Ce morceau est le premier qui réunit, on l’a vu plus tôt, des rappeurs marseillais et parisiens avec la présence d’ Ideal J mais aussi une nouvelle scène underground locale avec Namor, Sista Micky, Toko Blaze, Cella Men mais aussi Design de Montpellier. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce morceau ? Et plus généralement sur l’enregistrement de Kartier de fous ?
M : Sur “Le Kartier passe avant tout”, il y a une influence horrorcore. Il faudra lui demander mais Mounir avait dû s’inspirer de Gravediggaz et de leur album qui était sorti un peu avant. [6 Feet Deep, en 1994, NDLR] On sent l’inspiration chez Design aussi dans leur façon de poser. Faf La Rage devait aussi en être mais il n’a pas pu venir, et si tu écoutes bien, à la toute fin du morceau, il reste huit mesures après Kery James qu’on a rempli par des big up alors que c’est lui qui devait les rapper.

Uptown et Ideal J au Petit Mas
Sur ce titre, il y avait aussi Michaella que j’avais vu toaster à un micro ouvert sur une scène et qui m’avait fait forte impression. Vu qu’on se connaissait, elle est de Belsunce à la base et je la croisais souvent là-bas, je l’ai invitée à venir poser sur ce morceau avec une idée qu’elle complémente Toko Blaze. Si ma mémoire n’est pas défaillante, elle est la deuxième fille de l’histoire de Marseille à toaster après Rankin’Clarence de Massilia Sound System. Elle n’avait même pas de nom de scène. On a dû partir dans un brainstorming collectif pour lui trouver son nom à la dernière minute. J’ai finalement gagné avec Sista Micky dont l’inspiration me venait de Sista Souljah. Voilà comment est né un blaze ce soir-là ! Quant à l’album, on espérait que “Quand j’avais seize ans” en serait le single. C’était un clin d’œil au funk de notre enfance qui était la musique des quartiers Nord comme beaucoup d’autres quartiers. De Buretel nous avait fait faire un enregistrement studio exprès. C’était la tendance de mettre des chanteuse de RnB sur du hip-hop. Nos influences étaient plus Mary J Blige/Grand Puba. Alliance Ethnik, dont l’album sortait la même année, étaient plus De La Soul / « Saturday ». [« A Roller Skating Jam Named Saturdays », NDLR] Ils ont d’ailleurs Vinia Mojica sur deux singles. À l’époque, on n’avait pas l’impression de faire du commercial. On essayait de présenter une culture inconnue en France. Le R’n’B aussi. Je n’ai jamais fait de différence entre rap et R’n’B. Je trouve que certains morceaux de R’n’B sont plus hardcore que certains raps.
« Je n’ai jamais fait de différence entre rap et R’n’B. »
A : La fin de l’aventure Uptown en tant que groupe, ça s’est fait de manière progressive ?
M : En fait, on n’a pas arrêté le rap directement. On a eu une petite période de battement entre fin 1998/1999. Vers 1999, on se retrouve tous, le noyau dur d’Uptown, y compris un copain qui s’appelle Pepe qui était un copain-frère gitan avec qui on avait grandi. Il fréquentait La Kave, aujourd’hui il est pasteur. Il est premier pasteur dans le deuxième réseau des gitans de France. Déjà à l’époque où on était très jeunes, quand on rappait il nous disait : « Il ne faut pas dire ça… Ça, c’est un blasphème… » Tu vois, c’était un peu notre conscience. Il y avait aussi Tonino le boxeur dont je t’ai parlé, qui a pas mal inspiré dans le phrasé « L’Ultra Mia. » À lui tout seul, c’est un poème quand tu l’écoutes parler, tu es mort de rire de quatorze heures à vingt heures ! De mon côté, j’étais revenu des États-Unis. Après la fin de mon service militaire, j’y suis encore retourné mais je me suis dit que la société américaine ne me plaisait plus trop. Je rentrais dans une phase où ce qui m’intéressait était de fonder une famille, de me poser. Donc on s’est dit : « On va structurer. » Il y avait des jeunes derrière nous. On était toujours dans le quatorzième, quinzième, treizième arrondissement et en vérité à part les B.Vice [groupe auquel appartenait Ibrahim Ali, jeune français d’origine comorienne tué par un colleur d’affiches du FN, et qui avait un studio au quinzième arrondissement à La Savine, NDLR] qui avaient réussi à monter quelque chose d’intéressant, par ici il n’y avait rien. On s’est dit : « Voilà c’est bien beau d’être des rebelles de la société, de dire que ceci, cela ne va pas. Mais finalement qu’est-ce qu’on fait, qu’est-ce qu’on propose comme alternative ? » Dans nos paroles, j’étais le premier à gueuler qu’il ne fallait pas passer sa vie à attendre qu’on nous donne notre chance, qu’on devait être force de proposition. Donc on a commencé à structurer une activité associative et l’objectif était de transformer La Kave en véritable studio d’enregistrement. On a fait un petit peu comme ce qu’avait fait Zebda à Toulouse. Et on est arrivés à cette réflexion : « Bon les gars, on va arrêter de toujours tourner autour d’Uptown. C’est bon, la page est tournée. Proposons quelque chose de concret pour les jeunes générations qui arrivent. » Et on a monté le Phunkeestudio qui s’est implanté dans un ancien commissariat d’îlotiers en plein cœur de la cité des Micocouliers. Puis ensuite on a monté un studio assez bien équipé, avec à côté un cyber café pour tisser du lien social et initier un peu les jeunes à Internet qui commençait à émerger. Même si on voit les dégâts que cela fait aujourd’hui, à l’époque on croyait à l’aspect éducatif d’Internet.

Uptown
A : Concrètement, ça fonctionnait comment ?
M : Au studio, on recevait pleins de jeunes artistes qui venaient poser. Il y avait Keny Arkana, des mecs comme Bouga aussi, K-Rhyme Le Roi. Il y a même Imhotep qui est venu pour un projet. Faf aussi. Il ne manquait qu’AKH en fait. Mais c’était déjà le vaisseau de L’Adjoint en vérité. Sachant que L’Adjoint a bossé chez les B.Vice dans leur studio. Et avec les B.Vice on s’aidait beaucoup au niveau associatif sur des montages de dossiers, des demandes de subventions. On avait une « ingénierie partagée. » Là, on a connu quelques belles années. Jusqu’à l’arrivée de l’ère Sarkozy. L’État a arrêté de financer les contrats associatifs, on n’a plus pu payer notre unique salarié qui s’occupait d’accueillir le public au sein du cybercafé. Donc on a repris le flambeau en bénévoles. Idris, un autre membre d’Uptown sous le nom de F1kestaim, commence à s’occuper du Phunkeestudio. Tout ça dure encore quelques mois. Et puis arrive le moment où ça devient malheureusement la guerre avec un des réseaux de stupéfiants des Micocouliers. Idriss s’était fâché avec un petit guetteur à leur service. Il l’avait remis en place. En représailles, ils ont vandalisé le studio. Tout a été détruit. Il n’y a que la console qui a été subtilisée avant d’être revendue, mais tout le reste avait été fracassé. Après ça, il a fallu faire des espèces de médiations. Si tu veux moi au quartier, par rapport aux mecs dans le trafic de stups, ils me connaissaient. Je suis allé les voir, je leur ai dit : « Les gars, ce n’est pas sympa. Vous avez fait vos choix, vous avez fait votre vie. Mais nous cet outil, c’était un truc pour les plus jeunes, etc… » De leur côté, ils nous reprochaient certains comportements, et on entendait même des rumeurs, disant que si Idriss et même Stabe qui pourtant était originaire des Micocouliers se représentaient là, ils leur tireraient dessus. Donc je suis allé voir les gars pour essayer d’apaiser un peu la situation. Et là un des mecs du réseau m’explique qu’il me reconnaît, que je lui ai sauvé la peau une dizaine d’années plus tôt, en empêchant mes potes de le lyncher après un vol de blouson au studio. Et il enchaîne en me proposant une aide d’ordre financier pour relancer l’association, que j’ai immédiatement refusée. Il faut savoir que dès le début du groupe, il y avait déjà des mecs du quartier qui nous avaient proposé de blanchir de l’argent en nous finançant. Pour nous, ça a toujours été… [Mourad cherche ses mots] … Ça a toujours été la frontière. On a même eu des débats en interne à ce sujet, et notamment au moment où on vivotait.
A : C’est une question qui s’est souvent posée ?
M : Dans le groupe avec Mounir, on a toujours été très à cheval sur ce genre de trucs. Comme le fait de ne pas consommer de stupéfiants, d’être sportif. Surtout que ça a vraiment été des choses avec lesquelles on a grandi, parce qu’on a vu des grands frères se détruire à petit feu. Ils se torchaient au pastis pur dès huit heures du matin, certains se sont jetés du troisième étage de l’immeuble, des mecs qui étaient super musclés et qui sont devenus des loques à cause de l’héroïne. Nous, on a toujours eu cette réaction : « Notre vie ce n’est pas ça. Ce n’est pas ce qu’on veut faire ! » On a toujours été très à cheval sur ce genre de principes.
A : Les graines de ta deuxième carrière venaient donc d’être plantées ?
M : Le droit régit tout. On nous a éduqués en nous disant que ce sont les mathématiques qui régnent. Les maths pour moi, c’était une impasse. À part devenir professeur de maths, chose dont je n’avais pas forcément envie, il n’y avait pas trop d’autres possibilités. J’ai fait de la finance-comptabilité au moment où on enregistrait Kartier de fous. Je m’étais inscrit dans un IUT pour faire ce diplôme, avec l’idée de transformer les maths en comptabilité. Ce qui m’a permis de bosser à l’Adie. [Organisme de micro-crédit, CF plus bas, NDLR] Mais même la finance-compta, je me disais que ce n’était pas suffisant. Il y avait encore quelque chose derrière. Et effectivement, je suis arrivé en droit en m’inscrivant aux cours du soir. À partir de 2003, je crois, je prends la décision et en 2004, je commence les cours. J’étais avec des gens qui étaient salariés, des mères de famille, même un retraité qui faisait ça pour sa culture générale. Un ancien ingénieur de chez Danone, mort de rire ! Je me suis retrouvé là avec des professeurs en droit, comme à l’ancienne école, et des mecs qui connaissaient les régimes de France sur le bout des doigts. Ils faisaient leur cours sans regarder leurs notes. Et tous les sujets étaient passionnants. Tout était décortiquer sous des angles intéressants, en faisant appel à l’Histoire, à plein de disciplines. Je me disais : « Putain, mais c’est ce que j’aurai du faire depuis toujours ! »
A : Tu avais l’impression de te retrouver à nouveau dans ton élément ?
M : Complètement. Pendant les premières années, j’ai bu les paroles de pas mal de profs. Des profs qui étaient parfois bien plus subversifs que beaucoup de mecs dans le rap ou de gens que j’ai pu côtoyer. Tu vois Rockin’ Squat, pour moi, c’est un mec qui a peut-être eu accès à ce genre de connaissances bien avant nous. Parce qu’il a peut-être été initié par son environnement familial à ces sujets-là et sur la manière dont ils fonctionnent. Et puis après, de fil en aiguille, qu’est-ce que tu vas faire ? Au début c’était un peu pour évoluer professionnellement, passer un concours, entrer dans la fonction publique pour essayer de mettre la main dans l’exécution politique. Puis je me dis non, je vais continuer. Un jour, un pote me dit : « On prépare le concours d’avocat. » Moi, je n’y avais jamais vraiment pensé. « Parce que nous tous, dans les masters, on est tous là pour être avocat ! T’as pas compris ! C’est comme ça, t’as pas le choix ! Tu nous suis quoi ! » Sachant que j’avais dix ans de plus qu’eux ! La dernière année, je me suis retrouvé avec des jeunes de dix ans de moins que moi. Certains, notamment ce pote auquel je pense : Laurent, que j’ai retrouvé aujourd’hui. Lui était avocat dans un cabinet. On faisait plus de la fiscalité d’entreprise. Et moi dès le début, je me suis dit que j’allais m’installer. Je suis trop vieux pour aller sous les ordres de Pierre, Paul, Jacques. J’avais assez donné à l’Adie avec des chefs à la con qui t’expliquaient la vie. Alors ce qui me fait rire, c’est que maintenant ils découvrent mon passé. Des gens que je côtoie encore aujourd’hui : « Ah ! Tu ne nous avais pas dit que tu avais fait ci ! Tu avais fait ça ! »
Tu viens de reparler de l’ADIE. Peux-tu expliquer ce que c’est et ce que tu y faisais ?
M : C’est un organisme de micro-crédit. Saïd Ahamada qui apparaît dans le documentaire Marseille, capitale rap, y travaillait déjà quand j’y suis arrivé. Ensemble, on a essayé de booster des projets un peu plus personnalisés, qui nous parlaient et qui touchaient au hip-hop quand c’était possible. J’ai travaillé sur le Phunkeetstudio, Saïd a aidé au montage du journal Comores Mag et qui consacrait quelques pages au rap. On a aidé à financer le premier maxi de L’Algérino, Guentch, la marque de fringue de Stabe, celle de gars du 143, notamment Swali. On a aidé Matteo de Street Skillz qui avait été dépassé par le succès d’un street CD qu’il avait produit en ne déclarant rien du tout. C’était la mixtape Mains pleines de ciment [sortie en 2002, NDLR], et ils en avaient tellement vendus que pour un projet fait au noir, ça commençait à se voir. C’est l’effet Psy 4 de la rime et Soprano, qui faisaient partie du truc. Du coup, il voulait structurer le projet a posteriori. La seule solution, c’était de les envoyer en couveuse [terme qui désigne une entreprise naissante placée sous la responsabilité d’une structure de développement économique reconnue par les institutions, NDLR] le temps de tout mettre en place. C’est ce qu’on a fait, et six mois plus tard, ils ont pu monter une société et ça s’est signé dans mon bureau à l’époque où ils ont monté Street Skillz. En gros pour moi, j’ai toujours souhaité quelque part qu’il y ait un partage. Dans le sens où c’était à nous de les aider, ne serait-ce que parce qu’on savait faire : structurer. Pour qu’après, derrière, ils repassent le flambeau.
A : On en revient à cette notion d’héritage dont tu parlais un peu plus tôt, qui a toujours eu énormément d’importance pour toi.
M : Je l’ai vécu aux États-Unis. Un jour en plein été 1992, j’ai débarqué, les mecs ne me connaissaient ni d’Adam ni d’Eve. Il y avait juste un pote qui m’avait présenté et tout de suite j’étais avec des mecs de crew à faire des freestyles. Ils m’emmenaient partout. Ils me présentaient des OG’s de Chicago qui roulaient en Harley. Ces mecs-là te disaient : « On va t’expliquer le Chicago de l’époque, il y a eu ça, les bandes, etc… » J’ai toujours été accueilli comme ça en réalité. Quand je suis allé à New York pour la première fois, j’en parle dans le morceau « Quand j’avais seize ans », je me promenais dans les quartiers, tout de suite les mecs arrivaient, voyaient les baskets hip-hop, c’était parti, tu étais comme eux. Les mecs tu leur citais Three Times Dope, des groupes que même les Américains ne connaissaient pas, ils te regardaient et te disaient : « Putain ! Tu es avec nous ! » Puis par moments, je croise des gens ou même des discussions sur Facebook, tu sens qu’il y en a qui sont complètement déconnectés. Du genre : « Le hip-hop, il faut que ça vende », « C’est le dernier qui a parlé, ou celui qui passe à la télé, qui a raison. » Je caricature un peu mais c’est ça. Alors qu’inversement, nous, on a toujours été un peu plus critiques. Même dans d’autres sphères, y compris la sphère politique. Ce n’est pas parce qu’un flic, un élu ou le Président de la République va dire telle vérité que c’est forcément LA vérité. La vérité est que parfois ils disent beaucoup de conneries. Et ça, c’est un discours que nous aussi, on doit avoir dans le rap. C’est-à-dire qu’il faut qu’on fasse notre autocritique. Ça permet de te rappeler d’où tu viens et de comment les choses se sont mises en place. Parce que tu peux avoir l’impression d’être un peu grisé par deux-trois faits d’armes que tu vas faire une fois dans ta vie et qui vont te faire déconnecter de la réalité. Je ne suis pas un courtisan de nature. Je suis plutôt un mec capable de dire aux gens leurs quatre vérités en face. Et dès fois, c’est même un tort. On ne m’a pas appris à être un hypocrite. C’est un petit peu le côté brut de décoffrage qu’ont mes parents. Mais voilà, je préfère rester entier, peu importe les conséquences.
« Faire notre autocritique, c’est un discours que nous aussi, on doit avoir dans le rap. »
A : En 2007 sort un double CD rétrospectif nommé Bootlegz (1991-1997), sur lequel on retrouve le EP Kartier de fous dans son intégralité ainsi qu’un grand nombre d’inédits enregistrés à différentes époques. Qui en est à l’origine ?
M : En fait, on était dans le studio en train de monter l’association. On enregistrait des artistes comme Beretta ou Kalash l’Afro à cette période. On se disait : « Putain, on a quand même de la matière que l’on pourrait sortir aussi. Ce qu’on fait pour les autres, même tout ce qui est administratif, pourquoi on ne le fait pas pour nous ? » C’est à ce moment qu’on s’est dit, on va ressortir Kartier de fous. Parce que beaucoup de gens n’avaient pas la cassette. Elle était très rare. Alors je me suis dit : « Bon, déjà, il faut que l’on ressorte Kartier de fous parce que c’est le quatrième album de l’histoire du rap marseillais. » En plus c’est un truc qui pose les quartiers Nord sur la carte du rap français. Et vu l’historique de tout ce qui a été pioché dans nos premières démos, j’avais envie que ça se sache. Et les copains aussi. Par exemple le terme « Nique tout », Stabe en parlait encore hier soir ! Il fait le mec détaché, le mec père de quatre enfants, mais en fait à chaque fois que ça sort « Section Nique Tout », il devient fou ! [Il imite Stabe en prenant un ton énervé] « Ah mais non ! Ça c’est de moi ! » Ça le remue un peu ! Moi pareil avec le terme « chacal. » Je me suis demandé : « Si je n’avais pas posé le terme chacal sur la feuille, est-ce que ce mot serait sorti dans le rap ? » Donc l’idée était aussi de raconter notre histoire. Dans le livret qui accompagne le CD, on a raconté tout ça. Il fallait qu’on communique là-dessus parce que si on ne le faisait pas, l’histoire allait se perdre. Et quelque part, on encourageait tout le monde à faire la même chose : transmettre et communiquer cette histoire.
A : Parmi les inédits de ce double CD, on découvre notamment un personnage énigmatique nommé Edmondantesz. Qui est-il ?
M : Edmondantesz en fait, c’est l’alter ego de Numéro 7 qui a des projets qui datent de plus de dix ans en arrière. [Rires] Il veut reprendre sa place dans la société. Comme l’Edmond Dantès du roman. [Le Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas, NDLR] Dans le sens : « Ils ont tout fait pour l’annihiler. » Même si ça n’a pas forcément été voulu dans mon cas. Mais voilà, c’est le même gars qui, à l’époque, montait sur scène pour tout fracasser. Y compris les groupes pour lesquels il faisait la première partie. Et l’idée est qu’il revienne un jour pour reprendre ses galons. C’est un concept toujours en cours, j’ai des discussions à ce sujet avec quelques personnes. Après, il est clair que c’est une histoire de temps, d’investissements, de connexions aussi. En réalité, c’est plus l’amitié qui nous motive. Avant la musique. Finalement, on est toujours la même bande, Mounir y compris. On est toujours morts de rire sur des anecdotes.
A : C’est important pour toi de rire dans le hip-hop ?
M : En fait à cette époque-là, même quand le ton était dur, on avait malgré tout beaucoup d’autodérision. Et même dans la musique, tu vois les côtés délires d’Ombre est Lumière, les petits interludes ? Tu vois Sear de Get Busy ? Il le dit à Akhenaton : « Je regrette l’époque d’IAM où vous faisiez des espèces de sketchs en guise de skits ! » En fait à cette époque-là, même quand le ton était dur, on avait malgré tout beaucoup d’autodérision. On se voyait, nous, en tant que rappeurs dans la société ; les gens ne se rendent pas compte mais à l’époque, tu avais une casquette à l’envers, un baggy, même à Marseille, les gens t’interpellaient : « Oh les extraterrestres ! » Et nous on disait : « Ouais, on est des Martiens ! On est de Marseille mais on est des Martiens ! » Même nous, on se moquait de ça !
A : On l’a mentionné un peu plus tôt, en fin d’année dernière est sorti sur France 3 un documentaire réalisé par Gilles Rof : De IAM à JuL, Marseille Capitale Rap ! Quel regard portes-tu sur ce reportage ?
M : Je pensais que le documentaire allait enfin ramener une histoire objective du rap marseillais. Malheureusement, on est encore tombé dans des travers comme il y a quelques années dans des bouquins où on ne parle même pas de nous. Pourtant, tu prends les premières interviews de Soprano, quand on lui demande quelles sont ses influences en français, le premier nom qu’il cite est Uptown. Comme Djel de la FF. DJ Djel, quand il faisait ses soirées, s’il avait besoin d’une MK2, on lui filait. Du coup, de mon point de vue, il y a des manques dans ce documentaire. Y compris sur Soul Swing et aussi sur Freeman et K-Rhyme Le Roi. Les premières années qui sont les plus intéressantes d’un coté historique ne sont pas assez représentées. Gilles, et je lui ai dit, aurait dû plus insister sur la période où il y avait le trio de tête Soul Swing – IAM – Uptown. Il en parle trop peu. Il a un peu cédé à la hype du moment avec 13 Organisé. Soul Swing, on n’en entend presque pas parler dans le documentaire. Pourtant, ils sont arrivés avec « Was a brother » en 1990 presque en même temps qu’IAM. Des membres d’Uptown apparaissent d’ailleurs dans le clip. On se connaissait vraiment depuis le tout début. On allait ensemble dans des soirées à droite, à gauche. Faf, s’il y a vraiment un mec qui est vrai dans le hip-hop marseillais, c’est lui.
A : Que voudrais-tu que l’on retienne de ton parcours ?
M : Ne jamais oublier l’héritage. L’héritage des anciens. C’est peut-être la phrase de vieux con mais j’aurais plutôt tendance à dire qu’en ce moment, il y a plus à apprendre dans la littérature du dix-neuvième siècle, dans les changements de société et dans une multitude de domaines, que sur les réseaux sociaux. Les temps troubles que nous vivons, finalement, ce sont les mêmes que ceux qui émergeaient à la moitié du dix-neuvième. Où des personnes comme Victor Hugo, et autres, se sont dressées et ont commencé à raconter le quotidien d’une certaine classe de la société. Si je devais avoir une aspiration, ce serait que le rap serve à cela. Raconter la condition sociale. Comme à l’époque, on racontait la condition sociale des gars derrière la chaîne de production. Je pense qu’il ne faut jamais trop s’éloigner de ça au niveau de la musique et du hip-hop. Tout le reste, les paillettes, le succès,c’est éphémère. Il faut se concentrer sur l’essentiel. Dans le hip-hop, il y a des traditions et des valeurs. Il y a une culture, qui pour moi est une contre-culture de la culture dominante actuelle. Je ne parle pas forcément de la culture capitaliste. Mais voilà, de ce que l’on vit. Les rappeurs qui vendent des bouteilles de Coca-Cola ou de Sprite, je n’ai jamais trop adhéré. Pour moi le rap, si je dois en avoir une lecture politique, c’est plus du marxisme que du capitalisme social. A un moment, si on ne le comprend pas, ça va nous être imposé par l’Histoire. Il y a des sujets importants et qui sont trop urgents pour qu’on les oublie. Ce qu’il faut aussi que les plus jeunes comprennent, c’est qu’à l’heure actuelle le « je » a ses limites. Parce que le « je » a été conçu et pensé de sorte que le système puisse mieux le contrôler et mieux le manipuler. Il serait temps que le « nous » revienne un petit peu. Y compris dans la musique.
L’EP Kartier de fous est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming.
Les titres « Uptown est armé » et « Tableau noir » sont disponibles sur notre page Youtube. Merci à Mourad et au groupe d’avoir permis de les rendre disponibles.
Pas de commentaire