
Liquid Swords & Shogun Assassin
En musique et en images, le contre-champ analyse les albums pensés et construits autour de grandes références cinématographiques.
Le rap et le cinéma, c’est une histoire qui dure. Depuis plus de trente ans, le second a infusé le premier par toutes les entrées créatives : la référence textuelle à un titre de film, à un personnage ou à une phrase particulière, le sample musical, l’extrait de dialogue, la répétition de scènes cultes, le visuel d’un clip… Rares aujourd’hui sont les albums à ne pas contenir au moins un échantillon de cinéma, peu importe sa forme. Et si ces références tiennent la plupart du temps du simple clin d’œil ou du bon mot (ou, parfois, du running gag), certains artistes ont pris le temps de décortiquer et de comprendre les œuvres qu’ils citent, d’en tirer la substantifique moelle pour soit les intégrer à leur univers, soit se fondre entièrement dans le leur. Généralement, cet exercice est réalisé à l’échelle d’un visuel qui annonce l’ambiance, d’un morceau thématique ou d’un clip plus chiadé que les autres. Mais il arrive que des albums entiers soient pensés et construits autour d’une référence cinématographique en particulier, travaillée pour donner au projet une certaine ambiance, une épaisseur visuelle, une autre dimension. Ce sont ces derniers que cet article, inscrit dans une série intitulée le contre-champ, va s’échiner à analyser. Cas d’école pour ce premier volet, avec l’album Liquid Swords de GZA et le film Shogun Assassin de Robert Houston.

Le film : Shogun Assassin (Robert Houston, USA-Japon, 1980)
Au départ il y a Lone Wolf and Cub, un manga écrit par Kazuo Koike et dessiné par Goseki Kojima, publié en 28 volumes entre septembre 1970 et avril 1976. Ce seinen raconte l’histoire d’un samouraï qui, trahi par le clan Yagyū qui convoite son poste privilégié de bourreau du Shogun (un terme signifiant « général » et désignant le plus souvent le dirigeant du Japon), est contraint de s’enfuir avec son fils de trois ans et d’engager une vengeance sanglante. Prisé pour sa violence graphique, sa narration enlevée et sa peinture âpre sans concession de l’ère Edo, le succès est retentissant et conduit rapidement à la mise en chantier d’une adaptation cinématographique. En 1972, Baby Cart : Le Sabre de la vengeance sort sur les écrans. Dirigé par Kenji Misumi (déjà connu pour avoir livré quelques-uns des meilleurs films de la saga Zatoichi, autre série B culte de samouraïs), ce premier volet impressionne par sa mise en scène expérimentale, entre le baroque des planches de manga et le classicisme des films de sabre de Kurosawa. Avec ses couleurs vibrantes, son montage hypnotique et ses plans pittoresques (une décapitation sauvage sur fond de soleil couchant, notamment, reste en mémoire), le film est un véritable enchantement macabre. Toujours en 1972, Kenji Misumi pousse le curseur encore plus loin dans Baby Cart : L’Enfant massacre qui multiplie les morts loufoques et les plans gores à base de geysers de sang, d’amputations et autres visages découpés dans la largeur. Au total, il réalisera quatre des six longs-métrages adaptés du manga Lone Wolf and Cub. La saga, que vient clôturer en 1974 le délirant Baby Cart : Le Paradis blanc de l’enfer et son body count à 3 chiffres, se révélera particulièrement influente jusqu’à l’international.
Évidemment, qui dit succès à l’étranger dit adaptation pour le marché américain, et les films de samouraïs ne dérogent pas à la règle. Ainsi Shogun Assassin voit le jour en 1980. Produit par David Weisman, distribué par Roger Corman (une légende de la série B qui a mis le pied à l’étrier de la quasi-totalité des actrices, acteurs et réalisateurs les plus influent.e.s du nouvel Hollywood) et réalisé par Robert Houston, Shogun Assassin est un remontage des deux premiers opus de Kenji Misumi, affublé d’un doublage anglais et d’une nouvelle bande originale. On y retrouve donc Ogami Itto, son landau de bois et son fils de trois ans, Daigorō, forcés de s’engager sur le chemin de la vengeance (« the Demon Way in Hell » tel qu’il est appelé dans le film) après la trahison du clan Yagyū et le meurtre de leur femme et mère. Le premier volet, dont seulement douze minutes sont réutilisées, sert de pitch tandis que le second volet constitue la structure principale de ce montage américain. Plus encore que dans la version japonaise, la construction du film rappelle que l’histoire est prétexte à un enchainement de scènes d’actions toutes plus violentes les unes que les autres. À la manière d’un jeu vidéo, des opposants de plus en plus forts défilent sur les routes empruntées par Itto et se font charcuter jusqu’à l’apparition du boss de fin, les Masters of Death, synonyme de combat épique.
Bien sûr, pour qui a vu la saga japonaise originale, Shogun Assassin tient plus de la curiosité qu’autre chose. Le doublage anglais est aussi soigné que kitsch, la narration resserrée ne sert pas l’intrigue et les considérations introspectives du personnage d’Itto, en pleine lutte intérieure avec les codes du Bushido, sont largement éludées. Le film est néanmoins d’une efficacité à toute épreuve et traite le matériau de base avec respect, n’hésitant pas à conserver les innovations formelles de Misumi au niveau de l’image, du son et du montage. En cela il constitue pour le public occidental une excellente porte d’entrée dans le genre série B de samouraï. Et surtout, difficile de nier son influence sur le cinéma de genre et la culture populaire – dont la saga s’est elle-même largement nourrie par ailleurs, empruntant régulièrement aux westerns de Leone ou aux films de la Shaw Brothers. Ainsi John Carpenter fera un clin d’œil aux trois Masters of Death dans Les aventures de Jack Burton dans les griffes du Mandarin. Quentin Tarantino reprendra de nombreux motifs du film dans Kill Bill (le sang projeté de la lame de l’épée sur le sol, le poing qui vient cogner le manche du sabre, les amputations et autres geysers de sang…), allant jusqu’à le faire visionner à ses personnages. Enfin, Shogun Assassin sera donc l’épine dorsale de Liquid Swords, le chef-d’œuvre de GZA.
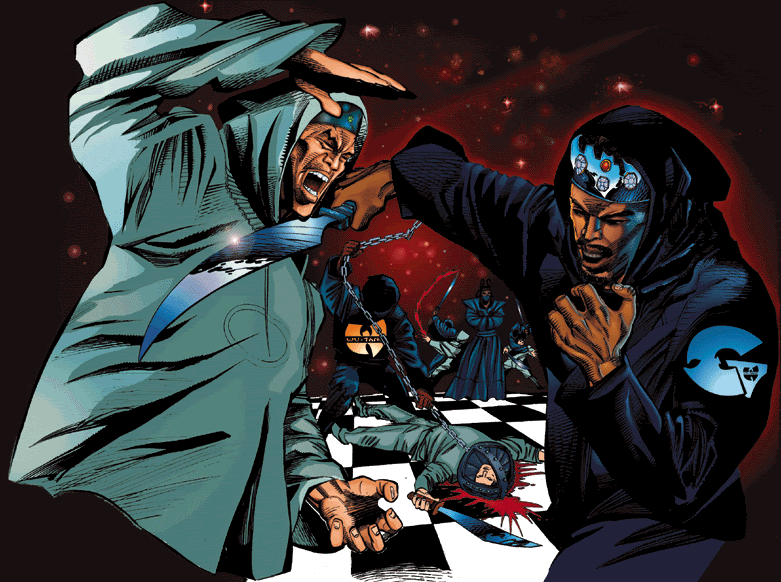
L’album : Liquid Swords (The Genius/GZA, 1995)
Produit d’une main de maitre par RZA, le grand manitou du Wu-Tang Clan (qui, surprise, réalisera plus tard la bande originale de Kill Bill), Liquid Swords est le second album de GZA sorti le 7 novembre 1995. Parmi les grands classiques parus dans la foulée du séminal Enter the Wu-Tang (36 Chambers), Liquid Swords est sans doute le disque le plus fondamentalement Wu. C’est à dire celui qui s’ancre le plus dans la tradition du groupe : arts martiaux, mysticisme, références cinématographiques, violence graphique, jeu d’échecs et commentaire social. Tical est l’album d’un fumeur invétéré ; OB4CL est l’album d’un parrain de la drogue, Ironman est l’album d’un soul crooner et Return to the 36 Chambers, malgré son titre, est l’album d’une rockstar. Liquid Swords, lui, est bien l’album d’un samouraï avec ses combats sanglants, ses auto-réflexions philosophiques et son regard acéré sur le monde environnant régi par une lutte des classes sans merci. Ces caractéristiques, qui sont aussi celles de beaucoup des grands films de sabre des années 60 et 70 (voir Sanjuro, Les Trois Samouraïs hors-la-loi ou encore les films de la saga Zatoichi), se retrouvent en filigrane tout au long des morceaux. « Duel of the Iron Mic », « Cold World », « Swordsman », « Living in the World Today », « Investigative Reports » : les titres parlent d’eux-mêmes, et pourraient tout à fait servir à nommer les chapitres des films de la saga Lone Wolf and Cub.
Il est difficile d’imaginer à quoi aurait ressemblé Liquid Swords sans Shogun Assassin. La production soul, noircie à la suie par RZA et l’écriture à la fois imagée, abyssale et brillamment interprétée de GZA suffiraient sans doute à assurer son statut de chef-d’œuvre. Mais le film de Robert Houston, omniprésent, l’emmène dans une autre dimension. C’est RZA qui eut l’idée, à la fin de l’enregistrement, d’utiliser Shogun Assassin comme une colonne vertébrale qui viendrait soutenir sa partition. Agissant comme un fil d’ariane dont on suit les saillies sinueuses de piste en piste, il confère à l’album une ambiance délétère unique en son genre. Choix intéressant, RZA ouvre le disque comme s’ouvre le film, traduisant une véritable ambition narrative qui participera largement à rendre les deux œuvres indissociables (et effectivement, il n’est pas aisé aujourd’hui de regarder Shogun Assassin sans penser à Liquid Swords, et vice-versa). Les différents extraits de dialogue qui suivront l’introduction, insérés de façon quasi-chronologique, vont dans ce sens et installent comme une intrigue parallèle : c’est bien l’impression d’écouter un conte étrange, cruel et sanglant, qui ressort de Liquid Swords.

Les samples « He cut off the heads of a hundred and thirty-one lords »
« When I was little, my father was famous. He was the greatest samurai in the Empire, and he was the Shogun’s decapitator…1 ». Une minute et vingt secondes. C’est une éternité, et le temps que dure l’introduction de Liquid Swords. Accompagnés de l’angoissant thème de W. Michael Lewis et Mark Lewis, « Legend of Lone Wolf », les mots de Daigorō, prononcés lentement – presque chuchotés – font tomber une chape de fumée épaisse et noire sur le premier morceau éponyme de l’album. Le ton est donné pour les douze titres à suivre, et les premières lignes parallèles se tracent entre le rappeur GZA et le samouraï Itto. Comme le personnage joué par Tomisaburō Wakayama, père et meurtrier sanguinaire trompé par ses pairs véreux, The Genius est à la fois un assassin sans pitié de wack MCs et un éveilleur de consciences (« I be the body dropper, the heartbeat stopper / Child educator plus head amputator »). Le parallèle est scellé par un nouvel extrait qui introduit le seconde piste, « Duel of the Iron Mic » : « Oh mad one, we see your trap. You can never escape your fate. Submit with honor to a duel with my son2 ». Comme Itto, GZA s’est engagé sur une voie tortueuse dont il ne peut s’écarter, mais qu’il compte parcourir avec panache.
Cette voie tortueuse, c’est une vie dure qui prend ses racines dans les ghettos des États-Unis, avec leurs trafics de drogue, leurs guerres des gangs et leurs morts violentes. Car si Liquid Swords baigne effectivement dans l’ambiance féroce et belliqueuse du japon militaire féodal de l’ère Edo, ce n’est que pour mieux retranscrire la réalité contemporaine des tours de Brooklyn telle qu’elle est décrite dans les lyrics de GZA. « Cold World » et son story-telling construit comme une spirale infernale de violence, est par exemple introduit par un autre sample de Shogun Assassin, cette fois-ci moins guerrier que philosophique : « I had a bad dream / Don’t be afraid, bad dreams are only dreams / What a time you chose to be born in3 ». Cette brusque incursion du réel, opérée par la voie cinématographique, tend à valider l’hypothèse d’une comparaison filée entre deux mondes qui se confondent par leur fureur et leur animosité, malgré les siècles et les kilomètres qui les séparent. Mais c’est encore l’extrait introduisant « 4th Chamber » (et sans doute le plus beau passage du film) qui demeure l’illustration la plus symbolique de ce parallèle. Un sabre dans la main gauche et un ballon dans la main droite, Itto demande à son jeune fils de choisir entre la vie à ses côtés (le sabre, symbole de la vengeance à mener) ou la mort aux côtés de sa mère (le ballon, symbole du jeu et donc de mort par le refus de la violence). « Choose the sword, and you will join me. Choose the ball, and you will join your mother in death. You don’t undertstand my words, but you must choose. So… Come boy. Choose life or death4 ». La scène est terrible, et l’écho qu’elle renvoi dans l’album l’est encore plus. Le choix du petit Daigorō – la vie par le sabre – est celui de toute une jeunesse désœuvrée, contrainte de mener une existence violente si elle veut pouvoir, in fine, simplement exister.
Avec son ambiance martiale, ses samples de baston à la pelle et l’émulation constante entre ses neuf membres, Enter the Wu-Tang (36 Chambers) tenait de la pure démonstration technique. Liquid Swords, tout inscrit dans cette veine orientale et guerrière, relève davantage d’une atmosphère ouatée et son approche est plus philosophique que militaire. En choisissant de structurer son album autour un chanbara (film de sabre) japonais plutôt que de réutiliser des films de kung-fu hongkongais (deux seulement sont brièvement cités : Dragon on Fire sur « Duel of the Iron Mic » et Shaolin vs Lama sur « Shadowboxin’ »), RZA modifie subtilement la portée du son Wu. Plus brutal, plus compact mais moins dans l’esbroufe. C’est autant une manière de coller aux écrits denses et référencés de GZA que de rendre justice à son style tranchant et définitif. « Most of our influence came from kung-fu movies. Sometimes there’s a lot of swinging, a lot of blocking. But in Japanese samurai movies, it’s one stroke kills. Bing, stroke ! Bing, stroke ! When it came time to incorporate a film into the Wu-Tang world, I chose this film to represent the GZA. His lyrics are straight to the point5 » raconte-t-il dans une interview pour Vanity Fair. Le dernier sample de Shogun Assassin, qui ferme « I Gotcha Back » peut ainsi être vu comme un hommage aux textes et au flow de GZA. « Your technique… is… magnificent. When cut across the neck, a sound like wailing winter wind is heard, they say. I’d always hoped to cut someone like that someday, to hear that sound… But to have it happen to my own neck is… ridiculous6 ». Cette mise aux nues de l’efficience pure est effectivement l’apanage des films de samouraï, dans lesquels les combats sont autrement plus expéditifs que les interminables duels des films de kung-fu. Un exemple séminal serait le duel final du Sanjuro de Kurosawa, attendu durant tout le film et pourtant expédié en un seul mouvement parfait, exquis de force et de dextérité. À la fin du film le personnage joué par Toshiro Mifune, dégouté de toutes les tueries auxquelles il a pris part, tient ces mots emprunts de bonté : « La meilleure épée doit rester dans son fourreau ». Il n’a, bien sûr, pas écouté Liquid Swords.
1 « Quand j’étais petit, mon père était célèbre. C’était le plus grand samouraï de l’Empire. Et c’était le bourreau du Shogun… »
2 « Oh fou, nous voyons ton piège. Tu ne pourras pas échapper à ton destin. Soumets-toi avec honneur à un duel avec mon fils »
3 « J’ai fait un mauvais rêve / N’aie pas peur, les mauvais rêves ne sont que des rêves / Quelle époque tu as choisi pour naître »
4 « Choisis l’épée, et tu me rejoindras. Choisis la balle, et tu rejoindras ta mère dans la mort. Tu ne comprends pas mes mots, mais tu dois choisir. Alors… Viens mon garçon. Choisis la vie ou la mort »
5 « L’essentiel de notre influence est venu des films de kung-fu. Parfois il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de blocages. Mais dans les films de samouraïs japonais, un coup suffit pour tuer. Bam, un coup ! Bam, un coup ! Quand il a fallu intégrer un film dans l’univers du Wu-Tang, j’ai choisi ce film pour représenter GZA. Ses textes vont droit au but »
6 « Ta technique… est… magnifique. Quand on te coupe en travers du cou, on entend un bruit comme celui du vent d’hiver qui gémit, qu’ils disent. J’ai toujours espéré arriver à couper quelqu’un comme ça un jour, pour entendre ce bruit… Mais que ça arrive à mon propre cou c’est… ridicule »
Pas de commentaire